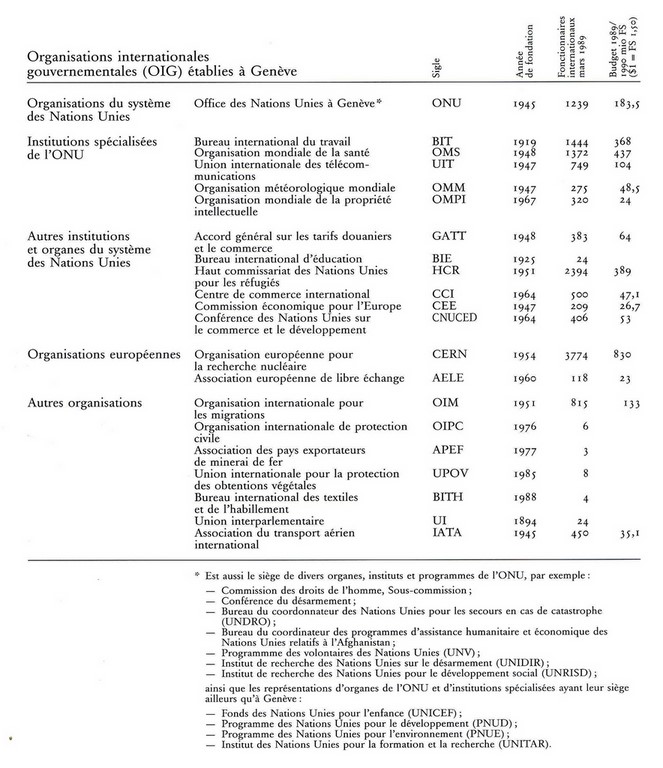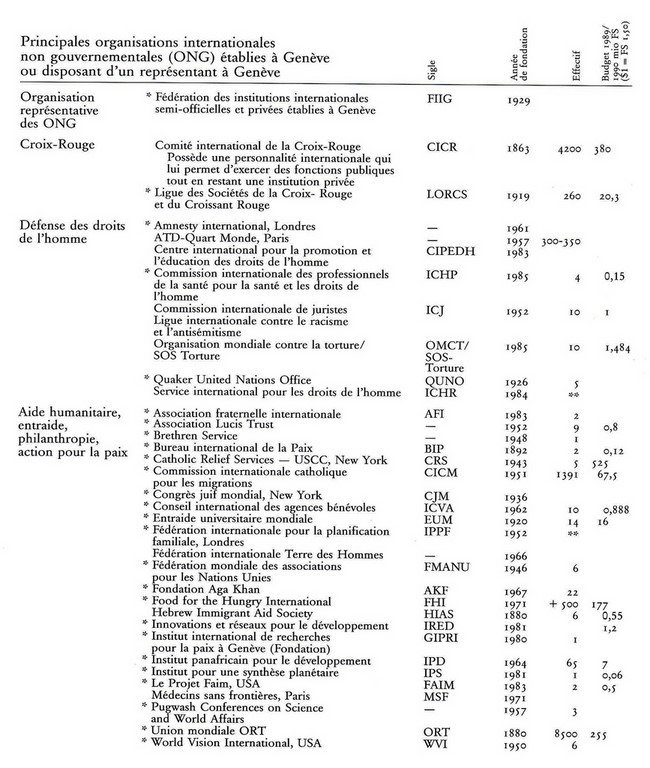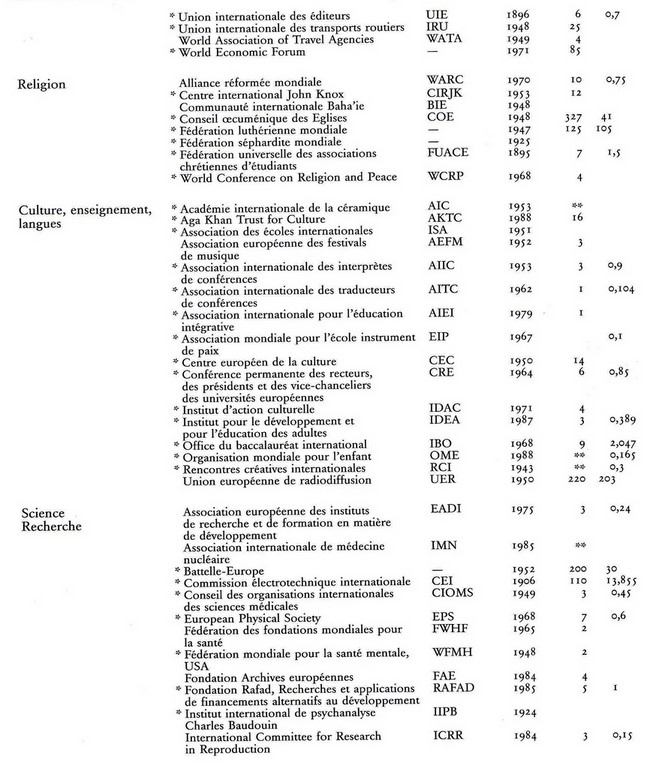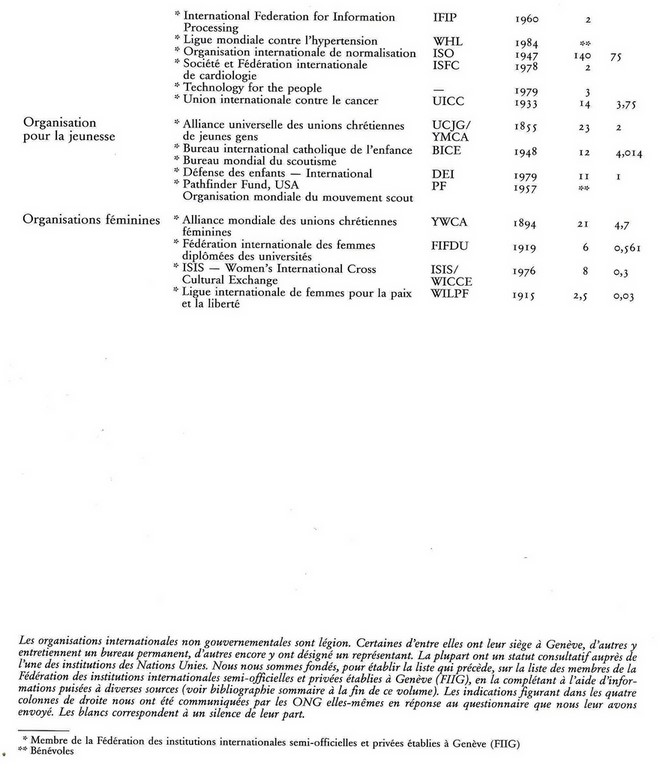Genève et la vie internationale
Catherine Courtiau / Jean-Claude Favez / Jacques Freymond / Alexandre Hay
Inès Lamunière / Catherine Santschi / Jean de Senarclens
La politique extérieure à Genève avant 1860
[p. 145]
Depuis quand Genève mène-t-elle sa propre politique extérieure?
En 1671-1672, le géographe Samuel Chappuzeau, ayant composé un Estat présent de la Cour de Savoye, omit le nom de Genève parmi les Etats souverains voisins de la Savoie. Il fut puni par le Conseil d'un exil rigoureux, puisqu'un tel oubli revenait à traiter Genève comme une ville sujette du duc de Savoie et constituait une sorte de négation des efforts séculaires de la République pour défendre son indépendance.
La politique extérieure de la communauté genevoise est antérieure à la Réforme. A la fin de 1486, le duc de Savoie, aux prises avec des difficultés militaires, réclama aux Genevois "le subside qui lui avait été accordé par ses sujets" en 1484. La réaction du Conseil fut vive: il s'opposa immédiatement à la demande du duc et s'efforça de rassembler des titres et des documents pour prouver que la communauté genevoise était sujette de l'évêque et non du duc. Ce qui, à cette époque, et depuis l'épiscopat d'Amédée VIII (1444-1451), n'était pas sans ambiguïté, puisque l'évêque ou l'administrateur de l'évêché était toujours un membre de la famille ducale de Savoie. De son côté, le duc de Savoie aurait pu produire autant de pièces que les Genevois, prouvant exactement le contraire — ce qui montre bien que les archives sont la source, non pas de la vérité historique, mais de la sécurité juridique. Toutefois, cette affaire des subsides obligea les juristes au service de la ville à préciser leur doctrine et à situer la communauté des citoyens par rapport aux puissances voisines. C'est donc le moment d'une prise de conscience très importante, qui prélude aux luttes pour l'émancipation et aboutira, de 1526 à 1536 — du traité de combourgeoisie avec Berne et Fribourg à la conquête du Pays de Vaud par les Bernois — à la création d'une République indépendante.
L'indépendance, c'est bien là le maître mot du discours mythique tenu par les historiens genevois, mandatés par leur gouvernement ou fidèles interprètes de la société dont ils sont issus. En vérité, cette minuscule république a toujours dépendu de l'extérieur, mais elle a conservé son autonomie et une part de sa souveraineté en maintenant la balance égale entre ses trois voisins, Berne, la France et la Savoie. Aucune de ces trois puissances n'ayant intérêt à ce que Genève tombe entre les mains de l'une des deux autres, chacune garantissait l'indépendance de la République, qui de son côté devait alterner fermeté et souplesse pour ne donner d'inquiétude à personne.
[p. 146]
De 1536 à 1584: le difficile jeu avec Berne
On sait que les Bernois, après avoir conquis et soumis le Pays de Vaud pour débloquer Genève menacée par les troupes savoyardes, demandèrent, à la mi-février 1536, le vidomnat qu'avait possédé le duc de Savoie et les droits de l'évêché de Genève: ils revendiquaient en somme la souveraineté de la ville, comme ils l'avaient obtenue de Lausanne et des "Bonnes villes" du Pays de Vaud. On sait aussi que le Conseil de Genève répondit fermement que "dès envyron vingt ans la ville de Genève avoit travaillé pour conserver sa liberté contre le Duc de Savoye et puis contre l'Evesque" et qu'avec l'aide de Dieu et des Bernois, "l'ennemy estoit fondu comme neige; que s'ils eussent voulu perdre leur liberté, ils eussent bien espargné tant de peynes, costanges et dangiers" (Chroniques de Michel Roset, chap. 64). La réponse était fière, mais les négociations ultérieures furent difficiles. Sur le moment, les Bernois n'insistèrent pas trop et levèrent le camp. Un nouveau traité de combourgeoisie fut signé. Sans doute la détermination des Genevois joua-t-elle un rôle dans cette affaire; mais il faut rappeler aussi que les troupes françaises occupaient la Savoie et que le roi de France n'aurait pas admis qu'une place située comme Genève tombât entre les mains des Bernois, compromettant ainsi l'équilibre des forces dans toute la région rhône-alpine jusqu'à la Méditerranée.
La suite des événements montre que Berne ne renonçait pas à réduire Genève au rang d'un simple bailliage bernois. Dans les terres de Saint-Victor et Chapitre, les conflits sont incessants. En effet, Genève y exerce, à la suite des seigneurs ecclésiastiques déchus, les droits de basse justice et Berne, à la suite du duc de Savoie, ceux de haute justice. Sous ce prétexte, les Bernois font signer le 30 mars 1539, par trois députés genevois, presque aussitôt désavoués, un traité très défavorable qui place pratiquement la République sous la sujétion de Leurs Excellences. Ces articles ayant été repoussés avec indignation par les patriotes genevois, c'est l'intervention des arbitres confédérés qui, par le "départ de Bâle" de 1544, règlera les difficultés entre les deux Etats au sujet de ces fameux villages (voir le tome I de cette Encyclopédie, p. 83-84).
Tandis que Genève essaie vainement d'intéresser à sa cause les autres cantons suisses, Berne fait mille difficultés pour renouveler le traité de combourgeoisie de 1536, le renvoie constamment à plus tard, refusant toujours de traiter sur pied d'égalité avec la ville décidément irréductible du bout du lac. Il faudra une évolution considérable de la politique européenne pour forcer Berne à modifier son attitude: en 1557, [p. 147] le duc Philibert-Emmanuel de Savoie, vainqueur des troupes françaises de l'amiral de Coligny à Saint-Quentin, recouvre ses Etats en Savoie et revendique le Pays de Vaud, le Chablais et le Pays de Gex conquis par les Bernois et les Valaisans. Dans ces conditions, il est évidemment préférable pour les Bernois et pour Genève de s'entendre face à cette menace. La nouvelle combourgeoisie est conclue en 1558, et malgré les lois somptuaires, de grandes réjouissances sont organisées à Genève.
Par le traité de Lausanne de 1564, les Bernois restituent à Philibert-Emmanuel les bailliages de Ternier et Gaillard et de Thonon, ainsi que le Pays de Gex. Occupé de 1590 à 1600 par Genève, le Pays de Gex passera définitivement à la France par le traité de Lyon de 1601.
Ainsi, de la fin du XVIe siècle jusqu'en 1860, Genève sera le point de rencontre de trois Etats: la Savoie, la France et les cantons suisses. Sa situation de "clé de la Confédération", sur le passage obligé du Sud-Ouest au Nord-Est, lui assure cette indépendance de droit qu'elle maintient par un effort militaire considérable et par une intense activité diplomatique.
Genève, chef de file du protestantisme français
Dans sa résistance à Berne, le gouvernement genevois a trouvé un appui très vigoureux dans l'Eglise de Genève, particulièrement dans le corps pastoral, entièrement d'origine française et formé selon la théologie calvinienne. Calvin, définitivement établi à Genève dès 1541, exerce même une influence réelle sur les Eglises du Pays de Vaud, dont les pasteurs ont également été formés en France. A partir de la fondation de l'Académie de Genève, en 1559, sur les débris de celle de Lausanne, l'Eglise de Genève envoie des pasteurs dans toute la France réformée à laquelle elle fournit ses cadres et ses références théologiques et même socio-politiques jusqu'au Synode de Dordrecht de 1618.
Les relations ambiguës avec la France
Situation ambiguë: Genève, continuellement exposée aux entreprises du duc de Savoie qui veut y rétablir son pouvoir et la messe, ne peut compter sur un appui franc de la part du roi de France, puisque les fils de Catherine de Médicis ont opté pour le catholicisme et orchestrent, sans beaucoup de conviction d'ailleurs, les persécutions contre les Réformés. [p. 148] Violant sans cesse ses assurances de neutralité en matière religieuse, Genève provoque l'irritation de la monarchie française et du parti tout-puissant des Guise en accueillant des réfugiés français par milliers (voir ci-dessus, p. 20-30) et en alimentant, intellectuellement et matériellement, la résistance et même la sécession protestante en France.
La protection que le roi de France peut accorder à la République répond essentiellement à des raisons d'opportunité: l'indépendance de Genève à l'égard du duc de Savoie est indispensable au roi de France pour assurer ses relations avec les cantons suisses. Or, en 1577, le duc de Savoie a conclu avec les cantons catholiques une alliance visant au rétablissement du catholicisme dans toute la Suisse. La sécurité de Genève est menacée. C'est dans cet esprit que, par le traité de Soleure du 8 mai 1579 entre Berne, Soleure et la Couronne de France, Genève est comprise dans la paix perpétuelle conclue en 1516 entre François 1er et les cantons suisses. Le roi de France s'engage à fournir des troupes pour protéger Genève chaque fois qu'il en sera requis par les Confédérés. Ces engagements seront tenus avec une bonne grâce et même une bonne foi très relatives par les successeurs de Henri III. Même Henri IV, oublieux de sa naissance protestante, fera toujours passer l'opportunité politique avant ses sympathies pour d'anciens coreligionnaires.
[p. 149]
La menace savoyarde se concrétise
En 1580, le duc Philibert-Emmanuel de Savoie meurt, ayant reconquis une grande partie de ses Etats, dont le centre de gravité est désormais au Piémont. Il laisse à son fils Charles-Emmanuel la mission de récupérer le Pays de Vaud et surtout de rendre Genève à l'Eglise romaine.
Le danger que représente pour la paix en Europe ce prince ambitieux et inquiet n'échappe à personne. Du reste, les entreprises sur Genève ont déjà commencé et la ville paraît particulièrement exposée. En effet, ni Genève, ni Berne n'ont réussi à persuader l'ensemble des Confédérés d'admettre Genève comme canton suisse à part entière: les cantons ruraux craignent que Genève n'accroisse l'influence des villes-seigneuries dans la Confédération. Les cantons catholiques redoutent le poids de la Rome protestante. Seuls les Zuricois comprennent l'enjeu, le rôle essentiel de Genève dans la stratégie économique et politique du Plateau suisse et concluent avec Berne et Genève, le 30 août 1584, un traité de combourgeoisie qui sera le fondement de la participation genevoise à la vie confédérale et le facteur principal de survie de la République jusqu'à la fin du XVIIIe siècle.
Les entreprises du duc de Savoie
Tandis que la coalition catholique et même européenne se renforce contre Genève, la combourgeoisie avec Berne et Zurich protège la ville contre les tentatives répétées de Charles-Emmanuel et de ses successeurs pour mettre la main sur la ville.
La guerre éclate en 1589, pour des raisons extérieures à Genève. En octobre 1588, Charles-Emmanuel a brusquement occupé le marquisat de Saluces, dernière possession de la France en Italie. Le roi de France Henri III, gravement menacé par la Ligue catholique en France et par l'influence grandissante de la famille de Guise, s'assure l'appui de Genève, de Berne, de Soleure, de Glaris et des Grisons dans la lutte contre le duc de Savoie. La guerre est très coûteuse et très dure pour Genève. A la mi-mai 1589, répondant à un appel pressant de Henri III, les troupes françaises abandonnent le terrain pour se rendre en Bourgogne. A leur tour, les Bernois renoncent à la lutte, qui pourtant n'était pas désespérée, puisque l'entreprise de Charles-Emmanuel était désapprouvée et mal soutenue par le pape et par le roi d'Espagne. Par la paix séparée conclue à Nyon le 1er octobre 1589 entre [p. 150: image / p. 151] Berne et le duc de Savoie, Berne s'engage à ne pas prêter assistance à Genève au cas où le duc voudrait poursuivre ses prétentions contre la ville.
Cette paix séparée, qui était une trahison à l'égard de Genève, provoqua l'indignation des princes et des cantons protestants. Elle fut repoussée à l'unanimité par les communes de l'ancien territoire bernois et du Pays de Vaud, qui voyaient apparemment mieux que leur magistrat le danger qu'elle représentait à moyen terme pour la Réforme, pour le canton de Berne et pour la paix confédérale. Genève fut donc sauvée, reprit l'offensive et, avec l'aide des troupes françaises commandées par Nicolas Harlay de Sancy, repoussa les troupes savoyardes, italiennes et espagnoles et obtint un armistice en 1594.
L'Escalade et le traité de Saint-Julien
Toutefois, le duc ne cesse de projeter de nouvelles entreprises, tant militaires que diplomatiques, pour isoler Genève et la réduire à sa merci. Il intrigue avec succès pour empêcher l'inclusion de la ville rebelle dans la paix de Vervins, du 2 mai 1598. En outre, le traité de Lyon du 17 janvier 1601, entre Henri IV et Charles-Emmanuel, retire le Pays de Gex à Genève pour l'incorporer définitivement à la couronne de France. Ce nonobstant, les Genevois ne se laissent pas intimider. Lors des conférences commencées à Hermance, en octobre 1598, ils ont repoussé les offres du duc de Savoie de faire de leur ville une capitale régionale, au prix de sa souveraineté, préférant son indépendance et sa vocation de chef de file du protestantisme français.
C'est que l'appui du roi de France, bien que prudent, est réel: le 11 novembre 1598, par une déclaration unilatérale, Henri IV inclut solennellement Genève dans la paix de Vervins. C'est aussi que le duc de Savoie, mal conseillé ou têtu, entreprend la fameuse Escalade du 11-12 décembre 1602 sans préparation diplomatique suffisante et malgré l'échec d'une conspiration destinée à neutraliser le roi de France.
La "cacade" de 1602 compromet définitivement les projets savoyards d'annexion de Genève. Sous la protection des troupes suisses envoyées, conformément aux accords, par les cantons de Berne et de Zurich, et avec l'aide des volontaires français, les Genevois tiennent le pays à l'entour et obligent, en soutenant la diplomatie par la guerre, le duc Charles-Emmanuel à traiter. Des ambassadeurs envoyés par les cantons non intéressés, Bâle, Schaffhouse, Glaris, Appenzell et Soleure, obtiennent, à l'issue d'une difficile négociation, que [p. 152] le duc reconnaisse l'indépendance de Genève et la liberté de ses relations commerciales avec les mandements et avec les cantons suisses: c'est le traité de St-Julien du 21 juillet 1603.
La France seul véritable maître du jeu
En dépit de ce traité, les menaces savoyardes, favorisées par l'incertitude des frontières, se poursuivront jusqu'au traité de Turin en 1754. En réalité, comme on l'a déjà montré dans cette Encyclopédie (voir le tome I, p. 79-84), il s'agit non tellement de frontières que de droits seigneuriaux, de natures et d'importances diverses, exercés sur des villages situés aux alentours de Genève. Vu l'enchevêtrement des juridictions, il était facile pour chacun des gouvernements, selon la conjoncture, de crier à l'empiètement ou à la violation, ou au contraire, d'ignorer une innocente sortie d'un curé allant porter l'extrême-onction dans le village voisin ou même un braconnage sur des terres mal délimitées.
C'est pourquoi on ne saurait sous-estimer le danger que représentent les projets franco-savoyards d'annexion de Genève. Les menaces se succèdent: en 1609, en 1611, en 1621, en 1629, en 1631, les autorités politiques et militaires de la ville doivent faire appel à toutes leurs ressources diplomatiques et à l'appui de Berne et de Zurich pour tenir en respect le duc de Savoie et le roi de France. En 1666, deux curés ayant porté le viatique à une femme dans une maison de Corsinge appartenant à la Seigneurie, l'affaire s'envenime à tel point que la guerre manque d'éclater entre Genève et la Savoie. L'année suivante, le duc de Savoie Charles-Emmanuel II répudie unilatéralement le traité de Saint-Julien. Or, l'article 19 de cet accord lui interdit de tenir des troupes et de construire des ouvrages militaires à moins de quatre lieues de Genève. Il s'arroge donc le droit de construire un château à Bellerive, qui doit soutenir la guerre navale contre Genève, tout en faisant courir le bruit hypocrite que ce n'est qu'un grenier à sel.
A cela s'ajoutent, dès 1661, les pressions constantes exercées par le roi de France sur les Eglises réformées du Pays de Gex et sur les protestants français, qui culmineront dans la Révocation de l'Edit de Nantes.
Dans une telle conjoncture, on se demande quel est le véritable poids de l'appui accordé à Genève par les principales puissances protestantes, la Grande-Bretagne et les Pays-Bas. Ces derniers n'envoient guère que de l'argent pour entretenir et agrandir les fortifications (le fameux bastion de Hollande, construit à partir de 1661). En dépit de belles [p. 153] déclarations, le soutien du roi d'Angleterre, puis de Cromwell, se limite à des interventions ponctuelles: un résident britannique, nommé à Genève en 1639, n'y demeure que quelques mois.
En revanche, pour assurer son contrôle sur la ville, Louis XIV y installe en octobre 1679, sous la menace d'une intervention armée — qu'il n'a peut-être pas l'intention de mettre à exécution — un résident permanent. Sa chapelle catholique, fréquentée par tous les domestiques savoyards de la région, nargue les successeurs de Calvin. Surtout dans la deuxième décennie du XVIIe siècle, les intrigues de ce résident isolent Genève par tous les moyens. En 1690, il oblige le Conseil à renoncer à la présence d'un résident d'Angleterre. En 1692, c'est l'ambassadeur de France auprès des cantons suisses qui fait échouer un projet d'alliance entre Fribourg, Soleure et Berne pour la défense et la protection des territoires de Genève, de Neuchâtel et de l'évêché de Bâle. Ainsi, l'équilibre entre les trois puissances entourant Genève est bien compromis.
La signature des traités de limites, avec la France le 15 août 1749, avec la Couronne de Sardaigne le 30 mai 1754, a permis d'affirmer la souveraineté de la République, par une réduction de ses droits et par une rationalisation de ses frontières (voir le tome I de cette Encyclopédie, p. 01-102). Dans les deux cas, l'initiative est venue du puissant voisin, qui a la possibilité d'exercer des pressions sur la petite République. Malgré l'appui de la France et des Puissances protestantes, la négociation du traité de 1754, qui a duré un quart de siècle, ressemble à un diktat imposé par le roi de Sardaigne qui porte ce titre depuis 1720. Il est indéniable que le flou des frontières était profitable à Genève, et que l'établissement de limites selon les principes rationnels du Siècle des Lumières a fait éclater aux yeux de tous les dimensions réelles de la "parvulissime".
De fait, Genève continuait de tirer parti de sa situation centrale entre la France, la Savoie et les cantons suisses désunis, mais unanimes dans leur recherche du profit par le mercenariat au service de toutes les puissances européennes. Dès cette époque, et sans que la chose soit déclarée par un traité proprement dit, Genève est au bénéfice de la neutralité suisse. Elle ne le sera officiellement qu'en 1792. Ni la France, ni la Savoie, ni Berne, ni du reste les cantons catholiques, trop faibles en face des puissantes villes réformées du Plateau suisse, n'ont intérêt à voir Genève tomber sous la domination d'une des puissances voisines. Mais si la souveraineté nominale de la ville demeure, elle dépend entièrement du bon vouloir de ses voisins.
[p. 154]
Désunion intérieure et interventions de l'extérieur
Il faut pourtant que les Genevois se soient sentis bien protégés par leur politique de balance, puisque durant tout le XVIIIe siècle, ils se sont offert le luxe de disputes internes jusqu'à la Révolution de 1792, qui met fin à l'Ancien Régime. En 1707, lors de l'affaire Pierre Fatio, en 1738, après l'interminable affaire du Tamponnement, en 1766, à la suite de l'affaire Rousseau, les Puissances garantes de la souveraineté genevoise, la France, les cantons de Berne et de Zurich, doivent intervenir vigoureusement à Genève pour soutenir l'aristocratie au pouvoir et imposer leur médiation: il y a là, d'ailleurs, une curieuse confusion entre la souveraineté d'un Etat et le maintien de la classe politique qui le dirige.
En 1766, la médiation, proposée sans préparation psychologique à une population particulièrement désunie, a échoué. On peut se demander si le traité de limites de 1754, qui a mis fin à une lutte séculaire contre la Savoie pour l'affirmation de la République et de sa souveraineté, n'a pas démobilisé les citoyens: ceux-ci éprouvent apparemment moins le besoin de la cohésion, n'ayant plus d'ennemi héréditaire.
Les querelles internes se poursuivant, la médiation sera imposée du dehors. Un blocus est imposé par la France et soutenu par des troupes pour faciliter l'adoption d'un "Prononcé" des Puissances garantes, prononcé qui est accepté le mars 1768, mais ne satisfait entièrement personne. Les troubles, qui n'ont jamais vraiment cessé, recommencent en 1777, à l'occasion d'une refonte complète de la législation. Ces événements ont été relatés dans le détail par les mémorialistes de l'époque, tels Bérenger, Cornuaud, d'Ivernois, impressionnés par l'indescriptible confusion que provoquent à Genève les luttes intestines, qui culminent dans la prise d'armes révolutionnaire du 7 avril 1782. Cette révolution, accomplie malgré les menaces très claires et répétées de l'ambassadeur de France à Soleure et du résident à Genève, est très mal accueillie au dehors. Les choses sont encore envenimées par les intrigues et les trahisons du chargé d'affaires de la République à Paris, Horace-Bénédict Perrinet Des Franches.
En mai, le roi de Sardaigne, Berne et Zurich joignent leurs troupes à celles de la Couronne de France pour assiéger Genève. Le faubourg Saint-Gervais est évacué. La ville se rend le 2 juillet; elle sera occupée par les troupes des quatre puissances qui demeureront jusqu'en avril 1783. Un "Edit de pacification" réactionnaire, appelé le Code Noir, est imposé. Le résident de France reprend son poste. Un résident de [p. 155] Sardaigne, le baron Jean-Baptiste Despine, s'installe à Genève. Pour éviter de le froisser, on renonce à commémorer l'Escalade. Plusieurs démocrates émigrent. C'est seulement à partir de 1789 que la République pourra commencer à assouplir sa constitution, ce qui est un signe supplémentaire de l'état de dépendance de Genève par rapport à sa puissante voisine.
L'Annexion
Au cours du XVIIIe siècle, les interventions françaises à Genève, comme de manière générale dans la politique suisse, se font de plus en plus pesantes et insistantes. L'édifice politique et diplomatique qui s'est péniblement constitué au début du XVIIe siècle se déséquilibre au profit des intérêts français. Dès 1792, Genève est pratiquement seule en face de la France révolutionnaire et conquérante, malgré son intégration à la neutralité suisse. Sous cette pression, accentuée par un résident français particulièrement actif, le célèbre Soulavie, les "clubs" instaurent l'"Egalité genevoise". Des comités provisoires, une Assemblée nationale sont créés sur le modèle français et élaborent une nouvelle constitution (1792-1794). Les tribunaux révolutionnaires éliminent les tenants de l'Ancien Régime ou les mettent hors d'état de nuire.
Ainsi, le fruit mûrit et va tomber presque de lui-même dans le panier révolutionnaire. Dès 1797, Genève est encerclée, ses communications avec la Suisse sont coupées. Elle ne peut empêcher le passage des troupes françaises qui, en janvier 1798, vont libérer le Pays de Vaud de la tutelle bernoise. Le 15 avril 1798, la ville est occupée. Par le traité de réunion du 7 floréal an VI (26 avril 1798), elle est annexée à la France et deviendra, jusqu'au 31 décembre 1813, le chef-lieu du département du Léman.
La Restauration de la République et la réunion de Genève à la Suisse
La fièvre révolutionnaire passée, les guerres napoléoniennes s'étant terminées par la défaite de la France devant les Puissances coalisées, Genève n'a pu retrouver et assurer son indépendance qu'au prix de son rattachement à la Confédération suisse. Son identité, la configuration de son territoire et sa limitation par rapport aux Etats voisins ne [p. 156: image / p. 157] sont pas issues d'une discussion à deux où les Suisses et Genève auraient pu faire valoir leur point de vue face à une France vaincue et pourtant menaçante. En fait, les Puissances qui ont signé l'Acte final du Congrès de Vienne avaient en vue une constellation politique où Genève et la Suisse, par leur neutralité armée, devaient tenir en respect l'impérialisme français.
Les Puissances posèrent donc pour condition de la réunion de Genève à la Suisse le désenclavement de Genève et la formation d'un territoire cantonal suffisant pour garantir la Suisse, du côté du sud-ouest, d'une invasion française. Le négociateur genevois au Congrès de Vienne, Charles Pictet-de Rochemont, obtint de la France, par le Traité de Paris du 20 novembre 1815, une portion du Pays de Gex suffisante pour assurer une liaison avec la Suisse d'un côté et avec le mandement de Peney de l'autre. Par le Traité de Turin du 16 mars 1816, un territoire cantonal viable était constitué sur la rive gauche du Léman, de l'Arve et du Rhône par la cession d'un certain nombre de communes. L'état-major fédéral souhaitait, pour des raisons de défense stratégique, une plus grande extension territoriale. Mais le roi de Sardaigne répugnait à livrer tant de sujets catholiques à la protestante Genève, et les autorités genevoises, civiles et ecclésiastiques, craignaient d'être mises en minorité par de trop nombreux catholiques et d'être méprisées par les hobereaux savoyards.
Pour faciliter les relations de Genève avec ses voisins et notamment son approvisionnement, des zones franches furent créées, aussi bien du côté français que savoyard (voir le tome I de cette Encyclopédie, p. 109-111).
Sans doute, le Pacte fédéral, auquel les députés genevois ont prêté serment le 9 août 1815, donne-t-il à la Confédération la compétence de la politique extérieure. Mais Genève n'en conserve pas moins une certaine liberté de mouvement, grâce aux zones et grâce à une situation de plaque tournante entre le Royaume de France, le Royaume de Sardaigne et la Suisse, à laquelle elle n'est reliée que par un étroit couloir, suffisant néanmoins pour assurer la stabilité politique et militaire de cette région.
La réunion de la Savoie à la France
Tout sera remis en cause en 1860, au moment où se pose la question de la Savoie. Pour se faire payer son appui apporté à Victor-Emmanuel II, roi de Sardaigne, dans l'unification de l'Italie, Napoléon III s'est fait promettre par le ministre piémontais Cavour l'annexion à la France du duché de [p. 158: image / p. 159] Savoie et du comté de Nice. Cette perspective inquiète non seulement Genève et la Confédération, qui appréhendent de voir le Canton encerclé désormais par une seule puissance dont l'impérialisme ne se dément pas, mais encore l'Angleterre qui redoute un accroissement aussi important de sa vieille ennemie.
Pour résoudre le problème posé déjà en 1815 par le statut de la Savoie du Nord, la Suisse, par le canal du Genevois Abraham Tourte, demande la cession à la Suisse du Chablais, du Faucigny et du Genevois au nord des Usses. Cavour, bien que marié à une Genevoise, refuse de se prêter à ce jeu. Quant à Napoléon III, il promet d'abord de céder la Savoie du Nord, mais finalement le Traité de Turin du 24 mars 1860 abandonne l'ensemble de la Savoie à la France, et le plébiscite de ratification qui suivra, donnera une écrasante majorité à cette solution, sous réserve de la création d'une grande zone franche douanière.
Dans cette crise, Genève et la Suisse ont indéniablement souffert de leur désunion. Si les catholiques et les radicaux, tant à Genève qu'à Berne, souhaitaient l'agrandissement de la Suisse et du Canton vers le sud-ouest, en revanche, les conservateurs et les protestants redoutaient que le délicat équilibre confessionnel et politique en Suisse n'en fût compromis. Mais en réalité, c'est l'équilibre international qui a été troublé par l'annexion de la Savoie à la France. Dès 1860, et en dépit des zones toujours soumises au bon vouloir du puissant voisin, Genève n'a plus qu'une alternative: se tourner vers la Confédération, avec l'helvétisation, voire la germanisation des moeurs et de l'Etat que cela suppose à long terme, ou se laisser progressivement absorber par sa région naturelle et par la France centralisatrice. Le développement de la vocation humanitaire et internationale est peut-être le seul moyen d'échapper à un choix aussi difficile.
C. S.
haut
[p. 160]
Genève et les organisations internationales 1863-1946
La Cité et le mythe
Le rôle international de Genève au XXe siècle prend appui sur deux événements majeurs: la fondation de la Croix-Rouge (d'où la date retenue ici de 1863) et l'installation de la Société des Nations (symbolisée dans ce chapitre par le rappel de la dernière assemblée générale en 1946). Ces deux événements feraient partie d'une même histoire. C'est du moins ce que prétend une abondante littérature qui entend prouver le caractère fatal, spécifique et ininterrompu de la tradition internationale genevoise, en-deçà de l'époque contemporaine. Mais cette littérature n'explique guère comment Genève occupe la place singulière qui est la sienne; pour l'essentiel, elle la justifie en évoquant la vocation internationale de la Cité. Or, cette dernière ne se laisse pas entièrement expliquer par l'histoire. Elle relève en partie également du mythe, c'est-à-dire de la représentation, de l'image que les Genevois ont de leur passé.
L'étude de ce mythe ne devrait pas constituer la matière de ce chapitre, qui rediscute d'ailleurs l'unité fondamentale de la séquence 1863-1946. Mais l'existence du mythe ne peut être passée totalement sous silence, tant il fonde aujourd'hui la perception que nombre de Genevois ont de leur histoire et cela indépendamment de ce qu'ils pensent chaque jour de la présence des organisations internationales dans l'étroit espace de leur Cité. Genève n'a-t-elle pas en effet exercé une attraction singulière sur certains hommes — nés dans ses murs ou venus du dehors — qui ont rêvé pour elle d'un destin exemplaire. Organiser une communauté réformée n'a pas été la seule ambition de Jean Calvin, mais bien fonder la Jérusalem nouvelle. Et Jean-Jacques Rousseau a rêvé à sa ville natale comme à la forme même du peuple souverain organisé par le contrat social. D'où leur vient cette conviction, reprise par d'autres hommes encore, dans d'autres circonstances, que Genève a vocation d'être parfois une des scènes de l'histoire du monde?
Poser cette question, c'est mettre en lumière certaines particularités de la Cité, au moins depuis la fin du Moyen Age, comme l'exiguïté de son territoire pour l'essentiel urbain, ou la souveraineté longtemps démocratique de son corps politique, qui fournit aux réformateurs religieux, politiques ou sociaux un cadre à leurs espoirs. C'est insister sur la volonté d'indépendance ou sur la situation géostratégique, qui tiennent en échec le destin de métropole régionale ou de capitale d'Etat qui aurait pu être celui de Genève; un destin malheureux si l'on en juge par l'épisode de l'annexion à la France. [p. 161]
C'est enfin évoquer le carrefour de routes, le lieu de passage et d'échanges, l'étape des refuges ouverte au monde extérieur. Les dimensions réduites de l'espace n'inclinent cependant pas ses habitants à la tolérance; elles nourrissent au contraire les affrontements d'idées et les rivalités personnelles, qui revêtent parfois une violence ou une précocité, elles aussi, singulières.
La République restaurée
Nous n'étudierons donc ni le mythe de Genève, ville internationale, ses éléments constitutifs et sa fonction, ni l'histoire de la Cité avant qu'elle n'entre à part entière, en 1815, dans le Corps helvétique. A ce moment, Genève est la plus grande ville de la Confédération. Mais elle n'est reliée à cette dernière que par un pédoncule de 4 km de large et une seule route, mince cordon qui limite la portée de la comparaison souvent trop rapide que l'on fait de sa situation avec celle de Bâle. Par ailleurs les zones franches accordées par les traités de 1815-1816 pour élargir économiquement l'assise territoriale exiguë du nouveau canton sont trop limitées pour constituer un espace régional dont Genève deviendrait la métropole. La République restaurée retrouve ainsi non seulement ses institutions, retouchées sur quelques points pour tenir compte des bouleversements antérieurs, mais la société et les traditions du brillant XVIIIe siècle. Le patriciat rétablit ses relations internationales fondées sur des solidarités familiales, bancaires, religieuses et intellectuelles anciennes. A l'étroit dans ses murailles, qui définissent avec le protestantisme sa nationalité, Genève cultive son originalité au grand agacement d'un Talleyrand ou d'un Stendhal qui s'étonnent qu'un si petit espace puisse à ce point retenir l'intérêt du monde. Le cosmopolitisme intellectuel et mondain de ses élites brille alors de tout l'éclat d'une lumière d'autant plus vive que sa source vacille déjà. Comme l'écrit après tant d'autres Alexis François: "Beaucoup de beau monde s'y rencontrait, beaucoup de pensée s'y agitait. La renommée d'un Pictet de Rochemont, d'un Augustin Pyramus de Candolle, d'un Lullin de Chateauvieux, d'un Bonstetten, d'un Sismondi, plus tard celle d'un Auguste de la Rive, d'un François-Jules Pictet de la Rive, d'un Adolphe Pictet, d'un Daniel Colladon, d'un général Dufour, d'un Ernest Naville, d'un Rodolphe Toepffer, d'autres encore, avaient attiré sur elle les regards de l'Europe. Et le sourire, l'esprit de ses femmes, qu'elles s'appelassent Eynard-Lullin, d'Yvernois, Necker de Saussure ou Rilliet-Huber y contribuaient aussi pour une grande part".
[p. 162]
De grandes causes pour une élite
De grandes causes contemporaines suscitent d'autant plus d'intérêt, voire d'engagement de la part des notables que l'élite cosmopolite de la Restauration est travaillée par le Réveil. Confrontée à la présence d'une forte minorité catholique, elle retrouve tout à la fois le chemin du calvinisme originel et celui de l'engagement philanthropique, car le Réveil est un mouvement complexe non seulement dans ses sources, mais dans ses conclusions. Jean-Gabriel Eynard consacre au mouvement philhellène sa fortune et son énergie. Plus significatif encore pour notre propos, le comte Jean-Jacques de Sellon fonde en décembre 1830, dans son hôtel de la rue des Granges, une Société de la paix, la première sur le continent, dans le souci de faire rayonner la cause de la fraternité humaine depuis Genève.
Né dans une famille venue de France lors du refuge de 1685, protestant convaincu, mais sans sectarisme, ce fils de magistrat de la République anobli par l'empereur Joseph II adhère tout d'abord aux Lumières et admire Napoléon. Il lutte pour l'abolition de la peine de mort et l'amélioration de [p. 163] la justice, avant de se joindre au mouvement pacifiste qui s'organise outre-Atlantique. Il dénonce désormais la guerre d'agression, cherche à la prévenir par l'instauration des armées de milice, car il n'exclut nullement la nécessité pour la patrie de se défendre, et finalement trouve dans l'arbitrage l'instrument propre à résoudre pacifiquement les conflits entre Etats. En opposition politique fréquente avec son milieu, le comte de Sellon représente une voix peut-être isolée dans l'aristocratie genevoise. Mais son attitude, elle, est exemplaire. Elle explique et la pérennité et la capacité de renouvellement de certaines traditions comme celle de la Rome protestante que l'on verra se manifester encore avec la création des Unions chrétiennes de jeunes gens et le développement du mouvement oecuménique après la Première Guerre mondiale.
Jean-Jacques de Sellon meurt en 1839, passablement isolé. Les libéraux critiquent alors le pacifisme, qu'ils considèrent, à l'instar de Cavour son neveu, comme un mouvement conservateur. Mais la Conférence internationale de Londres en 1843 prouve les progrès irrésistibles de l'idée.
Les services de la neutralité
Le rayonnement international de Genève ne repose plus, après 1815, sur le seul rétablissement des anciennes solidarités ou sur le cosmopolitisme du patriciat dont le gouvernement ferme et compétent aurait assuré à la Cité, selon les conservateurs, 27 années de bonheur. Depuis 1815, la parvulissime République est comprise comme canton dans la neutralité perpétuelle garantie à la Suisse par les traités de 1815. A dire vrai, jusqu'en 1848, cette neutralité ne contribue guère à assurer la souveraineté de la Confédération. Ce n'est qu'après la constitution de l'Etat fédéral et les unités italienne et allemande que la Suisse et ses grands voisins réalisent l'intérêt que peut représenter pour les uns et les autres, au coeur de l'Europe, en temps de paix également, un territoire neutre et des compétences impartiales et non engagées.
Les services que la neutralité helvétique peut rendre à la communauté internationale viennent parfois justifier l'organisation de rencontres diplomatiques. Ainsi Genève accueille, en 1872, le tribunal arbitral chargé de trancher le litige américano-anglais de l'Alabama, tribunal présidé par l'ancien Président de la Confédération, Jacob Stâmpfli. La Grande-Bretagne accepte le verdict rendu. Le retentissement de ce succès est considérable en Europe. Et même si les espoirs mis dans ce précédent par les partisans de l'arbitrage et par les pacifistes [p. 164] ne se réaliseront que très partiellement par la suite (malgré la multiplication des traités d'arbitrage bilatéraux), le règlement de l'Alabama sera porté largement au crédit de Genève et de la neutralité suisse.
Dans la seconde moitié du XIXe siècle, cette dernière paraît bien d'ailleurs inspirer au Conseil fédéral une politique plus active, notamment dans l'organisation des relations multilatérales techniques et juridiques qu'entraîne le développement de la société industrielle. Mais la tradition d'accueil genevois ne trouve pas particulièrement son compte dans ce mouvement. Parmi les Unions et les Bureaux internationaux créés à la fin du siècle, trois Unions, pour les télégraphes, les postes et les transports internationaux, plus deux Bureaux internationaux, l'un pour la protection de la propriété industrielle, l'autre pour celle des oeuvres d'art et de littérature, s'installent à Berne, non à Genève; les grands Etats préfèrent alors les centres administratifs, particulièrement des pays neutres, comme Bruxelles ou Berne. La vocation internationale active de la Confédération s'affirme ainsi et sa symbolique se rapproche de celle de la tradition genevoise, avant que les deux discours ne trouvent dans l'exaltation de la Croix-Rouge, durant la Première Guerre mondiale, la forme durable de leur synthèse.
Lié au développement du tourisme et à la modernité politique, sinon sociale, le rôle international de Genève se développe malgré tout. En septembre 1866, l'Association internationale des travailleurs, autrement dit la Première Internationale, tient son second congrès dans une salle à la Terrassière. L'un des participants, suisse il est vrai, souligne à l'ouverture que la liberté politique existante expliquait le choix du siège de la manifestation. Le mouvement ouvrier genevois est alors, en effet, en voie d'organisation, dans le sillage encore des radicaux. Mais les congrès ultérieurs de l'AIT se tiendront à Lausanne en 1867 et à Bâle en 1869, ce qui interdit de trop insister sur les particularités locales. En 1867 encore, une Ligue Internationale de la paix et de la liberté est fondée à Genève, avec la participation, parfois toute temporaire, de Garibaldi, Bakounine, Longuet et du leader radical James Fazy. Mais malgré le souvenir de Jean-Jacques de Sellon, c'est à Berne que s'installent par la suite les deux principales organisations du mouvement pacifiste: en 1891, le Bureau international de la paix, dont le secrétariat est assuré par le Genevois Elie Ducommun, figure marquante de la Franc-Maçonnerie qui tient précisément une conférence internationale, en 1901, à Genève; en 1892, l'Union interparlementaire de la paix et de l'arbitrage, dont le conseiller national Albert Gobat devient le secrétaire. [p. 165]
Ces quelques évocations prouvent que la Genève moderne, voulue par les radicaux, industrielle, mais aussi touristique, lieu de réunion, mais aussi d'enseignement, a pris sa place dans l'Europe des nations. Mais est-ce une place particulière, l'héritage du passé ou le fruit du mouvement même de la société contemporaine? Bâle, depuis 1901, abrite l'Office international du travail et en 1912, Lausanne est le siège de la conférence qui met fin à la guerre italo-turque. Le rayonnement de Genève paraît donc bien se fondre peu à peu dans celui de l'Helvétie libre et neutre.
Une telle perspective ne se réalisera pas. Le cosmopolitisme traditionnel et la culture politique locale n'ont pas épuisé leurs effets comme va le prouver maintenant l'aventure de la Croix-Rouge.
Une tradition. Une illumination. Une institution
Ce n'est pas affaiblir la portée de l'illumination d'Henry Dunant, au soir de la bataille de Solferino (1859), que de rappeler les nombreuses initiatives imaginées ou entreprises dans l'Europe d'alors pour tenter d'adoucir le sort des blessés du champ de bataille et de remédier, par l'engagement volontaire et bénévole, aux carences des services de santé militaires. Et ce n'est en rien diminuer l'écho de Un Souvenir de Solferino (1862) que de situer son auteur dans son milieu et dans son époque; sans eux l'Idée aussi généreuse et prophétique qu'elle ait été ne serait pas devenue réalité dans l'histoire. [p. 166]
Né dans une famille patricienne, ce qu'il ne cessera de rappeler lorsque son milieu l'aura rejeté, Dunant est une personnalité complexe et originale. On ne saurait le réduire à quelques traits exemplaires de l'aristocratie locale, quoiqu'il apparaisse bien comme un enfant de son siècle, jusque dans les excès de sa personnalité. Sa vie d'adulte, il l'entame de façon toute traditionnelle, par la banque et les affaires d'une part, l'engagement chrétien d'autre part, dans le droit fil du Réveil. La première activité lui vaudra plus tard ruine, déshonneur et abandon. La seconde, à la fin de sa vie, dans la solitude désespérée d'un hospice alémanique, la gloire du premier prix Nobel de la paix et la reconnaissance universelle. Mais sa méthode de travail aura été la même dans les deux cas: nouer à travers l'Europe et à partir de Genève les relations, les correspondances, les amitiés qui lui permettront d'intéresser à ses affaires — financières ou charitables — les personnalités et les responsables dont il a besoin pour agir.
Contraint d'accorder, en 1842, au mouvement démocratique un certain nombre de concessions, le patriciat qui gouverne Genève depuis 1815 perd le pouvoir à la suite de la révolution radicale d'octobre 1846. La rupture, cette fois, n'est pas que constitutionnelle. Les radicaux veulent ouvrir la Cité au progrès des sciences et des techniques, remodeler l'espace par la démolition des fortifications, élargir la nationalité genevoise en accordant la pleine égalité civile aux catholiques, développer l'industrie et le commerce. Ecartés des affaires publiques au moins pour un temps, les vaincus de 1846 ne renient cependant pas leur sentiment de responsabilité civique ni leur paternalisme éclairé. Ils vont chercher dans la défense des traditions réformées et dans la lutte contre les maux de la société industrielle moderne à poursuivre leur mission et à reconquérir leur pouvoir sur une République qu'ils considèrent comme leur propriété. L'avènement du régime radical relance donc le mouvement de création d'associations philanthropiques, charitables ou moralisatrices qui s'était déjà manifesté par la création, entre autres, de la Société genevoise d'utilité publique en 1828.
Engagé dans un groupe de jeunes qui, pour l'essentiel, appartiennent à la bonne société, Dunant participe à la fondation en 1852 de l'Union chrétienne des jeunes gens. Il prend une part active à sa constitution en mouvement international, ce qui se fera lors d'une rencontre qui se tient à Paris, en 1855, dans le cadre de l'Exposition universelle. Nul doute qu'il ne partage alors la conviction de l'un des animateurs, le pasteur Max Perrot, qui écrit peu après ces lignes révélatrices: "Voyez notre ville, elle s'est parée depuis dix ans: ses rues sont spacieuses, ses quais sont larges, de splendides [p. 167] magasins étalent leur luxe aux passants... Mais n'avez-vous pas souffert en apprenant qu'avec cet accroissement de richesse et de confort, le niveau moral baissait? Nous sommes parfois effrayés en voyant la corruption envahir la jeunesse". A cette date, fin des années 50, la vie de Dunant a pris un cours nouveau. Entraîné par ses affaires algériennes dans la suite de l'Empereur des Français, témoin des conséquences de la grande et sanglante bataille de Solferino, il bouleverse par son cri d'humanité, Un souvenir de Solferino, Gustave Moynier, juriste de formation, philanthrope de profession, qui dirige à ce moment la Société genevoise d'utilité publique, dont les quelque 200 membres se consacrent à chercher des remèdes aux dangers qui assaillent les saines traditions de la Cité. Le secours aux blessés du champ de bataille par des volontaires formés à cette tâche est-il dans les objectifs de cette association? Moynier en est convaincu dès sa rencontre avec Dunant. Mais le général Dufour penche d'abord vers une attitude négative, car il peut, lui, parler en connaissance de [p. 168] cause et mesurer l'ampleur de la mission qui exalte Dunant. Finalement, le 9 février 1863, l'assemblée de la Société d'utilité publique, qui ne réunit probablement guère plus d'une vingtaine de membres ce jour-là, décide d'entrer en matière et charge une petite commission de soumettre au congrès philanthropique, qui doit se réunir prochainement à Berlin, la question de la création d'un corps d'infirmiers volontaires.
La suite est connue, nous n'en retiendrons que quelques éléments qui concernent notre propos. La petite commission finalement composée de 5 membres, le général Guillaume-Henry Dufour, héros de la guerre du Sonderbund, Henry Dunant, Gustave Moynier, les docteurs Louis Appia et Théodore Maunoir, se constitue dès sa première séance en Comité international de secours aux blessés. Relevons l'adjectif. La commission n'est internationale que dans l'esprit de ses cinq membres, tous patriciens genevois. Elle décide par la suite de convoquer elle-même un congrès international qui se tiendra fin octobre 1863 dans le joli palais de l'Athénée, récemment achevé et mis à disposition par la veuve de Jean-Gabriel Eynard. Grâce à l'appui des gouvernements de Paris, de Berlin et de Berne, cette rencontre privée de médecins, diplomates et membres de l'aristocratie européenne débouche sur la convocation d'une conférence diplomatique qui, en août 1864, à l'Hôtel-de-Ville, élaborera la Convention de la Croix-Rouge pour la protection des blessés des armées en campagne.
Le signe de ralliement des volontaires suggéré par le congrès d'octobre 1863 évoque le drapeau fédéral; la France impériale considère, dans un premier temps, que la Croix-Rouge est une affaire plus helvétique que genevoise; qu'importe. Le Comité international de Genève fera reconnaître en 1887 par la Conférence de la Croix-Rouge sa composition uninationale, sa mission impartiale, son siège genevois. Grâce à Gustave Moynier, qui l'organise en le laïcisant, il est désormais moralement au centre de l'institution, l'inspirateur du droit humanitaire, le gardien de la tradition. Il maintient la fidélité et la cohésion idéologiques en préservant son caractère de club fermé, dont les membres se désignent par cooptation. Et ce n'est qu'en 1915 qu'il se dote enfin d'une personnalité juridique conforme au code civil.
Jusqu'en 1920, les membres du Comité se recrutent dans un cercle particulièrement étroit. Selon Diego Fiscalini, qui en a étudié les relations, les quelque 20 membres qui siègent, à cette date, ensemble ont de nombreux liens de parenté.
Pourtant, durant la guerre de 1914-1918, les tâches de la Croix-Rouge, partant les responsabilités du CICR ont crû énormément, notamment avec l'ouverture, au Musée Rath, de [p. 169] l'Agence centrale des prisonniers de guerre. Ces activités sont de plus en plus comptées au nombre des services que la neutralité suisse rend à l'Europe en guerre, tant par les belligérants que par l'opinion publique et le gouvernement suisse. Déjà Gustave Ador, président du CICR de 1910 à 1928, est entré au Conseil fédéral en 1917. Et en 1923, signe évident de cette helvétisation, trois membres non-genevois sont nommés pour la première fois, dont l'un, le conseiller fédéral Giuseppe Motta, devient ainsi le premier catholique à entrer au CICR.
Le rayonnement de Genève a reçu de la fondation de la Croix-Rouge une impulsion fondamentale qui va induire de nouveaux développements dans la vocation internationale de la Cité, développements qui ne viendront pas cette fois des Genevois eux-mêmes.
Un destin nommé Société des Nations
La guerre de 1914-1918 est un tournant pour l'Europe, pour le monde, mais aussi pour Genève. Au début du conflit, Français, Italiens et Allemands sont repartis par milliers d'une ville où ils ne reviendront pas s'installer. La croissance continue tout au long du XIXe siècle de l'élément étranger est brutalement stoppée. Elle est remplacée par un afflux accru de Confédérés, qui représentent, en 1822, 120 pour mille de la population, puis 265 pour mille en 1914, enfin 480 pour mille en 1949. Par ailleurs, la France victorieuse fait savoir à Berne, dès la fin des hostilités, son intention de mettre fin au dispositif zonien. A défaut d'être devenue une métropole régionale, Genève va-t-elle maintenant se replier sur la Suisse?
La réponse vient avec la Société des Nations. Evénement inattendu, certes, mais préparé malgré tout par la volonté des hommes. Le négociateur officieux du Conseil fédéral à la Conférence de la paix de Paris, le Genevois William E. Rappard, est d'autant mieux placé pour agir qu'il entretient avec plusieurs officiels américains, comme le colonel House, des liens de confiance et d'amitié. D'autres villes, en effet, sont sur les rangs pour devenir le siège de la future Ligue des nations, clé de voûte de la paix selon Woodrow Wilson. Parmi elles, Bruxelles qui, à d'autres titres, ajoute celui de capitale de la Belgique martyre. Mais c'est précisément ce dont ne veut pas le Chef de la Maison-Blanche. Genève en revanche évoque la démocratie helvétique, la neutralité, la Croix-Rouge, et last but not least, si l'on croit Rappard, la tradition protestante. Ce sont là des titres suffisants pour le président des Etats-Unis [p. 170] qui impose son choix, une première fois au printemps 1919 à Paris, une seconde fois en juillet 1920 à Washington, contre le voeu unanime du Conseil de la Société des Nations qui, dans l'attente de l'installation définitive à Genève, suggérait que le président réunisse à Bruxelles la première assemblée de la Société, puisque cette convocation lui revenait d'après le Pacte.
Au printemps 1919, les autorités fédérales, bousculées par Rappard et désireuses de faire avancer le dossier essentiel de la reconnaissance de la neutralité perpétuelle dans le cadre de l'Europe de Versailles, ont fourni les assurances souhaitées. Le 28 avril, la Conférence de la paix, suivant la recommandation prise à la majorité d'une sous-commission, décide donc de fixer à Genève le siège de la Ligue. Mais paradoxalement, à cette date, le cas helvétique n'est pas réglé, c'est-à-dire l'appartenance de la Confédération à la future Société des Nations. Il demeurera en suspens jusqu'à la Déclaration de Londres du 13 février 1920 qui, moyennant une dispense des sanctions militaires prévues à l'article 16 du Pacte contre un Etat agresseur, juge la neutralité compatible avec les engagements exigés des membres de la Ligue. Plus rien ne s'oppose donc à l'adhésion de la Confédération, si ce n'est la sanction populaire, qui est accordée le 16 mai suivant par 416.870 citoyens contre 323.719 et 11 cantons et demi contre 10 et demi, après une vive campagne référendaire. [p. 171]
Le choix de Genève, rendu public le 28 avril 1919 par une proclamation du Conseil d'Etat, provoque une grande émotion dans la population. Un cortège, autorités en tête, défile à travers la ville. Une ferveur analogue entourera l'ouverture le 15 novembre 1920 de la première Assemblée générale à la salle de la Réformation. Pourtant, lors du scrutin du 16 mai précédent, il s'est trouvé 5.143 citoyens contre 26.807 pour refuser la Société des Nations. Cette minorité n'est pas négligeable, surtout si l'on songe que toutes les autorités, tous les notables, tous les partis, sauf les socialistes, recommandaient un oui franc et massif à l'adhésion. Elle prouve que bien des Genevois hésitaient encore devant l'avenir nouveau qui s'ouvrait à leur Cité.
Un toit pour délibérer
Au printemps 1919, l'entourage de Wilson envisage d'installer bureaux et salles de réunion de la Société des Nations au bord du lac, dans ce qui deviendrait à 15 ou 20km de la ville un site international. Les contraintes matérielles, politiques et financières vont obliger à en rabattre. Le secrétariat de la Société, dirigé par le Britannique Sir Eric Drummond, prend possession en 1920 de l'Hôtel National (futur Palais Wilson), construit au bout des Pâquis dans les années 70, par Jaques-Elisée Goss et qu'un autre architecte genevois, Marc Camoletti, transformera pour son nouvel usage. L'austère salle de la Réformation (construite en 1867 pour le 350e anniversaire de la naissance de Calvin) abrite les séances de l'assemblée, lors de la session annuelle ordinaire, qui se tient en septembre. Cette situation n'est cependant pas satisfaisante; un regroupement s'impose. Le Bureau International du Travail a résolu, lui, plus rapidement ses problèmes grâce à l'énergie de son directeur, le Français Albert Thomas. On trouvera plus loin, pages 219 à 227, une description urbanistique et architecturale détaillée du "quartier international".
S'entretenir avec le monde entier
Conformément au Pacte et aux décisions arrêtées par le Conseil fédéral en 1921, les bâtiments de la Ligue et du Bureau International du Travail jouissent de l'exterritorialité et leurs agents de l'immunité à l'instar du personnel diplomatique, ce qui les soustrait entre autres au fisc et aux tribunaux genevois. [p. 172_ image / p. 173]
Conscientes de ce que, comme le disait Georges Clemenceau, "le choix de Genève [assure] la neutralité de la Suisse", les autorités sont prêtes à de larges concessions, par exemple à propos de la station de télégraphie sans fil que demandent les Américains, bien que son usage en temps de guerre puisse faire problème par rapport au statut de neutralité. Le retrait américain relègue ce projet à l'arrière-plan. La Suisse, en outre, développe par la suite son propre réseau de télécommunications. Avec l'encouragement des autorités fédérales, la puissante compagnie britannique Marconi établit une filiale à Berne qui obtient une concession de TSF pour l'ensemble du pays et qui devient, en 1928, Radio Suisse SA. En 1930, à l'issue de négociations où se sont mêlés problèmes juridiques et rivalités commerciales, la Confédération passe avec la Ligue une convention qui porte création du poste de Radio Nations. Comme le souhaitait la Suisse, la station est construite à Prangins par Radio Suisse SA, avec l'aide matérielle de la Confédération et de la Société des Nations; elle fonctionne, en cas de guerre, sous la responsabilité de la Ligue, en présence d'un observateur helvétique. Radio Nations ne rendra pas les services que l'on avait imaginés et, en 1939, la Suisse dénoncera la convention dans les délais prévus, suite logique de son retour à la neutralité intégrale de mars 1938 et de son abandon progressif de la Société agonisante.
Se déplacer dans le monde entier
Un effort particulier d'infrastructure sera consenti par les Chemins de fer fédéraux, notamment avec la reconstruction de la gare Cornavin entre 1927 et 1932 (architecte Julien Flegenheimer) et par les Postes Télégraphes et Téléphones. Toutefois aucune amélioration ne sera apportée au réseau ferroviaire qui relie si mal Genève aux grandes villes de Suisse et des pays voisins. L'échange des zones contre le percement de la Faucille ou la ligne Bellegarde — Saint-Amour (dont on reparle maintenant à propos du TGV) restera un voeu que le Conseil d'Etat ne parviendra pas à faire partager par Berne et le raccordement de la gare Cornavin à celle des Eaux-Vives, décidé il y a plus d'un siècle, n'est toujours pas réalisé, malgré la construction de la gare pour marchandises de La Praille entre 1941 et 1949.
En revanche, la présence de la Ligue vient soutenir les efforts des pionniers de l'aviation. François Dussaud, en 1918, réclame la création d'un champ d'aviation à Cointrin, justifiant le choix du lieu par la proximité des futures gares maritime [p. 174] (canal du Rhône) et ferroviaire (tunnel de la Faucille), dont la réunion ferait de Cointrin la gare centrale de l'Europe pour les transports sur terre, sur mer et dans les airs. C'est ainsi que l'aérodrome de Cointrin est mis en exploitation en 1920. (Sur l'ensemble du problème des transports, voir le tome III de cette Encyclopédie, p. 175-194).
La Société des Nations n'est pas seule
Le travail du Secrétariat, vraie fonction publique internationale, celui des commissions, du Conseil, de l'Assemblée, ne constituent qu'un aspect de la fonction internationale nouvelle de Genève. En s'installant sur les bords du Léman, la Ligue a entraîné avec elle de nombreuses organisations gouvernementales ou non, à commencer par l'Organisation et le Bureau International du Travail et les institutions qui lui sont proches, comme l'Institut d'organisation scientifique du travail et l'Institut psychotechnique. Au départ, il est vrai, les Bureaux et Offices internationaux existants ne se sont pas bousculés pour s'installer sous l'aile de la Société des Nations, ne serait-ce déjà qu'en raison de l'opposition de leurs membres non représentés à Genève.
Mais graduellement la Ligue élargit son activité au delà des questions politiques liées à l'application des traités et au maintien de la paix pour aborder d'autres domaines comme les transports, l'économie, l'hygiène, les réfugiés, la protection de la femme et de l'enfant, le contrôle des stupéfiants, etc... En outre, la coopération internationale s'organise aussi sur le plan intellectuel et si l'Institut international de coopération intellectuelle s'installe à Paris, comme l'Institut international de cinématographe éducatif à Rome, bien d'autres organes de cette coopération, comme le Bureau International de l'Education, le Comité d'entente des grandes associations internationales, etc... animent, depuis Genève, l'effort de rapprochement et d'éducation à la paix qui fait partie intégrante de l'idéal wilsonien.
De nombreuses organisations, officielles ou privées, s'installent donc autour de la Ligue, du BIT et du CICR ou établissent au moins un bureau ou une délégation. Elles sont plus de 70 dans les années 30, ce qui entraîne un affaiblissement considérable du rôle de l'Union des associations internationales à Bruxelles. Enumérer ces associations serait aussi fastidieux que de dresser la liste des conférences internationales qui se tiennent chaque année sur les bords du Léman. Anciennes ou récentes, techniques, sociales, culturelles ou humanitaires, grandes ou petites, connues ou quasi ignorées, [p. 175] elles trouvent à Genève, dans un lieu paisible et de dimension modeste, mais fréquenté par le monde entier, le calme et l'attention propice à leur activité et à la diffusion de leur message.
Vie mondaine. Vie culturelle
La présence internationale contribue à stimuler le tourisme pour lequel hôteliers, commerçants et autorités font un effort, afin notamment de contrer la réputation de cherté des prix genevois, en organisant par exemple, dès 1923, une Fête des fleurs, qui connaît par la suite un prolongement nocturne. Mais elle enrichit aussi la vie culturelle et mondaine par la demande qu'elle crée en spectacles et manifestations diverses, et le public qu'elle réunit. La société locale, déjà habituée avant 1914 à une vie artistique assez riche, en retire donc un bénéfice immédiat. La session annuelle de l'Assemblée en septembre tend à devenir — du moins dans les années 20 — un événement international politique et mondain. Les fonctionnaires et les diplomates cèdent le pas aux ministres et chefs d'Etat; la présence de ces personnalités attire des vedettes du spectacle et des arts, des journalistes, des curieux en tous genres. L'Hôtel des Bergues, où descend Aristide Briand, patron du Quai d'Orsay de 1925 à 1932, la Bavaria, où son collègue l'Allemand Gustav Stresemann tient son "Stammtisch", deviennent des lieux fameux, connus de l'Europe et même du monde entier grâce à la grande presse.
Malgré les efforts du Club international, du Cercle de la presse et d'autres lieux de rencontre, la société que constitue la fonction publique internationale et celle des Genevois s'ignorent cependant largement. La première se plaint du coût de la vie. Elle déplore la froideur des indigènes. La seconde, qui n'ouvre guère ses salons en dehors de contacts personnels, demeure méfiante et réservée. Elle redoute au fond un état d'esprit et des préoccupations qui ne s'inscrivent pas dans les traditions du lieu et surtout dans les limites d'un espace très étroit géographiquement, politiquement et parfois culturellement. Robert de Traz, qui célèbre la réunion de l'Esprit de Genève à la mystique de la Société des Nations, note qu'il existe un esprit genevois fort opposé à l'Esprit de Genève. "Cette ville ouverte à toutes les curiosités, à toutes les innovations, est aussi une bourgade très particulariste et très méfiante. Sous la culture cosmopolite persiste un génie local, lucide et réservé. Il y a le Genevois qui ouvre sa porte et celui qui la tient close".
[p. 176]
Une tradition revivifiée
Dans un domaine pourtant, la présence de la Société des Nations relance et amplifie une tradition locale.
L'Académie de Calvin avait été une pièce maîtresse du cosmopolitisme protestant sous l'Ancien Régime. Après un long repliement sur elle-même, la Haute Ecole, devenue Université en 1872, renoue avec cette tradition. En 1880, l'élément étranger représente le 44 pour cent des étudiants, en 1910 le 81 pour cent. Le phénomène est alors général en Suisse, mais il revêt à Genève une ampleur particulière. La guerre, là aussi, provoque une chute brutale de l'apport extérieur; les autorités universitaires et cantonales s'efforcent de regagner le terrain perdu à partir de 1920, dans le sillage de la Ligue.
Cette politique aboutit notamment à la création, en 1927, de l'Institut universitaire de Hautes études internationales, installé à deux pas du CICR, à la Promenade du Pin, sous la direction de William E. Rappard et du Français Paul Mantoux; l'Institut connaît des débuts modestes soutenus par la fondation Rockefeller et l'Etat de Genève, et une contribution fédérale chichement comptée. Mais son projet, l'étude scientifique et interdisciplinaire des relations internationales par un contact direct avec les institutions internationales, est original et bien approprié au génie du lieu. On peut en dire autant de l'Institut des sciences de l'éducation, qui prend le relais en 1929 de l'Institut Jean-Jacques Rousseau créé par Edouard Claparède, tandis que l'ouverture en pleine guerre mondiale de l'Ecole de traduction apparaît, elle, davantage comme un pari sur un avenir alors fort sombre. L'éclatement des hostilités a d'ailleurs entraîné la disparition d'un essai d'enseignement international de management, qui sera repris dans les années 50.
L'enseignement privé, illustré par des Ecoles réputées et anciennes, trouve lui aussi des raisons de croître et d'embellir à l'exemple de l'Ecole internationale.
Enfin, le mythe
Pendant presque une décennie, de 1924 à 1932 environ, le nom de Genève, dans la bouche des hommes d'Etat et sous la plume des commentateurs, devient synonyme de sécurité collective, de réconciliation entre les anciens ennemis et de paix parmi les nations, malgré l'échec de l'organisation de la sécurité collective et le règlement de certains problèmes dans des réunions qui se sont tenues dans d'autres lieux, comme la Conférence de Locarno, en 1925. [p. 177]
Comment ne pas croire dans ces conditions que cette Cité est effectivement appelée à un destin particulier? Deux œuvres parmi d'autres illustrent alors ce mythe de Genève, capitale des Nations.
La première n'est qu'un projet, une idée plutôt, du Belge Paul Otlet. Fondateur, avant-guerre, de l'Union des Associations internationales, ce fanatique de l'enregistrement mondial veut inscrire la fonction de la Ligue dans l'espace par la création d'une Cité mondiale, le mundaneum. Ce centre intellectuel, scientifique et politique, doté d'un statut analogue à celui du Vatican, serait construit par la banque mondiale dans le cadre d'une vaste opération d'aide financière des grandes puissances aux petits Etats démunis. Son établissement réglerait, en outre, la question des communications, par le tunnel de la Faucille et une grande traversée de la rade, et celle des zones.
Si Paul Otlet sépare ainsi physiquement Genève de sa fonction internationale, Robert de Traz lui, au contraire, les réunit dans son essai de 1929 sur l'Esprit de Genève. Français de culture, européen de sensibilité, de Traz est attaché à sa ville natale, d'une fibre toute barrésienne. De 1920 à 1930, il anime la Revue de Genève, périodique international, mais pas internationaliste comme il l'écrit lui-même, qui profite pour sa diffusion et le recrutement de ses collaborateurs du rayonnement international de la Cité. Pour de Traz, il existe bien un Esprit de Genève, une mystique même, dont il recherche les racines jusqu'à l'époque romaine. Mais il existe aussi une technique qui a trouvé dans les mécanismes de la Société des nations sa forme juridique et administrative contemporaine. Mystique et techniques coopèrent dans la recherche d'un [p. 178] humanisme moderne auquel le mythe de Genève, ville des nations, appelle tous les hommes de bonne volonté, à l'exemple de l'effort de dialogue et d'échanges de la Revue de Genève, qui n'a pas hésité à fusionner avec la vieille Bibliothèque Universelle, elle-même héritière de la Bibliothèque britannique, une des publications les plus connues de l'esprit libéral et cosmopolite de l'élite genevoise du siècle précédent. Mais en 1930, la Revue de Genève doit cesser de paraître car de Traz ne peut surmonter des difficultés financières récurrentes. C'est l'aveu, un an après la parution de l'Esprit de Genève, que l'écrivain n'a pas trouvé, dans sa propre ville, les appuis matériels et spirituels indispensables à la poursuite de l'entreprise.
Les deux Cités
Malgré son indépendance de comité privé, la laïcisation de son idéal et l'élargissement encore timide de son recrutement, le CICR demeure, dans la première moitié du XXe siècle, sociologiquement et culturellement, un héritier du cosmopolitisme genevois.
La Ligue des Nations n'est pas, elle, une institution genevoise, mais une organisation établie à Genève. Mais c'est aussi au départ un club, plus européen qu'international, dont les membres, sous la houlette franco-britannique, se réclament des mêmes valeurs libérales.
Malgré leur nature, leur fonction et leur but très différents, CICR et Ligue des Nations partagent donc bien encore une certaine communauté de pensée qui, directement ou indirectement, se retrouve dans le microcosme politique local. Le projet de Le Corbusier pour le Palais des Nations suscite, par exemple, des oppositions farouches, qui ne sont pas toutes mercantiles, mais qui s'en prennent à l'architecture moderne comme un instrument de la subversion révolutionnaire. L'admission de la Russie soviétique à la Société des Nations, en septembre 1934, entraîne de véhémentes protestations dans les milieux conservateurs, notamment au nom de la tradition chrétienne et libérale. Car parmi les institutions locales à vocation internationale, il existe aussi dans l'entre-deux-guerres l'Entente internationale contre la IIIe Internationale, dont les relations avec les puissances fascistes sont assez évidentes. Le discours sur l'Esprit de Genève, tout en faisant de la vocation internationale de la Cité le bien de tous les Genevois, est chargé de sens politique. Il est encore très fortement l'expression, à l'époque, de cette affirmation du patriciat local sur la République. [p. 179: image / p. 180]
Dans la continuité historique que le mythe de l'Esprit de Genève entend fonder disparaît ainsi l'existence de deux Cités que l'événement a pourtant parfois mises face à face. En 1864, les plénipotentiaires qui viennent d'adopter la Convention de la Croix-Rouge sont bloqués à l'Hôtel-de-Ville par l'émeute populaire déchaînée par un nouveau choc entre partisans et adversaires de Fazy. "On ne peut être que douloureusement frappé, écrit Alexis François en 1918 en évoquant la scène, de l'ignorance qui règne entre ces deux moitiés d'un peuple séparé, semble-t-il, par un abîme. Triste fruit de la révolution de 46, dont la Croix-Rouge paraît, à certains moments, avoir été comme une aristocratique revanche. Ces malentendus s'expliquent à l'époque, mais ne se justifient plus aujourd'hui. Pourtant, le Comité international n'a pas changé de physionomie..." Et que dire, plus tard, de la contradiction ouverte entre la célébration de l'Esprit de Genève, ville de paix et de négociation, et l'impuissance des diplomates à régler rapidement l'irritant problème des zones franches de la Haute-Savoie et du Pays de Gex!
L'Esprit de Genève et l'esprit genevois, Robert de Traz les voyait s'affronter dans le coeur des vrais Genevois, c'est-à-dire de ceux qui croient au destin particulier de leur ville. Cette image littéraire a-t-elle une portée sociologique? Elle concerne à première vue avant tout l'élite cultivée, et notamment ce patriciat, héritier des traditions anciennes. Mais elle ne les concerne plus exclusivement. Certes, le gouvernement socialiste de Léon Nicole se cabrera plusieurs fois, lorsque le Conseil fédéral voudra imposer une certaine retenue aux manifestations politiques locales, au nom de la présence des organisations internationales. Mais l'idéal de la Société des Nations n'en pénètre pas moins dans l'opinion publique en général, renforçant dans la culture politique genevoise, sans distinction de partis, une sensibilité internationale qui lui est propre.
Les deux Cités découvrent ainsi progressivement, dans l'entre-deux-guerres, leur communauté de destin, sur le plan matériel et psychologique. Une communauté suffisamment reconnue pour que, sitôt la guerre achevée, les autorités genevoises et fédérales oeuvrent pour que Genève reprenne ses fonctions internationales. Le développement du système des Nations Unies et l'interdépendance du monde donneront à ces dernières une ampleur sans commune mesure avec leurs dimensions des années vingt et trente. La coexistence des deux Cités en sera perturbée à nouveau, en raison même de l'étroitesse de l'espace local. Mais comme indifférent aux perturbations de la politique, le mythe continuera sa progression victorieuse dans l'esprit des Genevois.
J.-Cl. F.
haut
[p. 181]
Genève et les organisations internationales 1945-1989
Dans la guerre: préparation de l'après-guerre
En 1945, lorsque la guerre prend fin, les Genevois s'interrogent: quel sera l'avenir de la Genève internationale? La Société des Nations a été endormie en 1939. Où se réveillera-t-elle? Sous quel masque? Après le départ du Bureau international du Travail et des internationaux que la guerre a saisis, seul reste le souvenir, entretenu par des anciens mélancoliques des grandes années durant lesquelles Genève, parfois, se considéra comme le centre du monde.
Cependant la vocation internationale de Genève n'en est pas pour autant éteinte. Le Comité international de la Croix-Rouge (CICR), fleuron de la couronne genevoise, a relevé le défi de cette nouvelle guerre mondiale. Il est soutenu par la Cité, par la Suisse tout entière. Il n'aura guère de peine à recruter des collaborateurs, dont l'effectif se situera autour de 3.200 à la fin de la guerre. Les responsabilités qui lui incombent sont écrasantes non seulement du fait de l'extension géographique du conflit, mais peut-être plus encore par la nature même des gouvernements avec lesquels il faut négocier. Face à la violence cynique, cette institution, issue de l'idéalisme humanitaire du XIXe siècle, ne peut imposer le respect de ce "minimum d'humanité" que demande Max Huber, son président. On lui en fera le reproche. Le débat commencé au cours de la guerre s'intensifiera avec les années. Il reste ouvert. [p. 182]
Considérée globalement, l'oeuvre accomplie par le CICR s'inscrit dans la mission de la Genève internationale. Les Genevois ne se sont pas laissé enfermer dans les frontières de la Suisse. Pas plus que leurs Confédérés, ils n'ont cessé de suivre les affaires du monde et d'analyser les modifications qui intervenaient sur la carte de guerre. La chronique militaire de La Suisse, rédigée par Samuel Gonard, est probablement la meilleure qu'on puisse lire dans la presse suisse. René Payot fait bénéficier ses lecteurs du Journal de Genève et ses auditeurs à la radio des informations que lui fournissent ses contacts internationaux.
A l'Institut universitaire de hautes études internationales, qui n'a pas fermé ses portes, étudiants et professeurs marquent un intérêt croissant pour les sujets concernant "la reconstruction politique et économique du monde de demain", signale le rapport administratif de 1943. Dès l'instant que l'espoir est revenu, très tôt après le choc de 1940, la réflexion sur l'après-guerre, vers laquelle Guglielmo Ferrero avait orienté ses collègues de l'Institut, occupe une place prioritaire dans les milieux internationaux. En 1944, Paul Guggenheim réunit des textes d'articles et de conférences qu'il a publiés à la Baconnière sous le titre L'Organisation de la société internationale. Un ouvrage de son collègue Maurice Bourquin paraît en 1945 chez le même éditeur: Vers une nouvelle Société des Nations. "Le temps n'est pas loin où les institutions internationales voyaient le vide se faire autour d'elles. Le sort les accablait. On eût dit que la petite flamme qui veillait encore en elles était près de s'éteindre... Or, voilà que, du fond de l'abîme, nous les appelons à notre secours." [p. 183]
Si l'Institut universitaire de hautes études internationales assume la mission qui lui avait été assignée en 1927, il ne détient cependant pas un monopole de l'étude de la vie internationale. Tout au plus joue-t-il, grâce au rayonnement de William Rappard et des professeurs qu'il a su attirer à Genève, un rôle catalyseur. C'est à l'Université, dans le monde politique, dans les milieux d'affaires, dans les syndicats, autour du CICR, au sein du Mouvement oecuménique qu'incarne déjà Willem Visser t'Hooft, que la Genève internationale prépare l'après-guerre de l'Europe et des cinq continents, dont il s'agira de coordonner le développement.
Ceux qu'on pourrait qualifier d'internationalistes sont conscients de la modification qui est intervenue dans le rapport des forces mondiales. La position de l'Europe s'est affaiblie. Alors que du temps de la Société des Nations on vivait encore dans un système européen, la Deuxième Guerre mondiale débouche sur la création d'un système dominé par deux colosses continentaux. Les centres de décision se sont déplacés à Moscou et à Washington.
[p. 184]
Le retour des organisations internationales. Pourquoi Genève?
La question va se poser rapidement de savoir où placer le siège de la nouvelle organisation internationale. New York l'emportera. Que veut-on faire de Genève? La Suisse, dans l'immédiat après-guerre, ne jouit pas de la meilleure réputation aux Etats-Unis. Elle n'entretient pas de relations diplomatiques avec l'Union soviétique. La Société des Nations est tombée en discrédit. Mais Genève détient un atout. Une question se pose en effet qui appelle une réponse rapide: que va-t-on faire des biens immobiliers de la Société des Nations? Peut-on abandonner le Palais des Nations édifié à grands frais et conçu en fonction des besoins du secrétariat d'une organisation mondiale? Le bon sens commande d'utiliser cet instrument de travail, d'autant plus que l'Organisation des Nations Unies ne dispose pas encore d'installations adéquates à New York. Il y a bien d'autres villes européennes qui souhaiteraient accueillir les Nations-Unies à la place de Genève, hantée par le fantôme de la Société des Nations.
Daniel Secrétan, envoyé par le conseiller fédéral Max Petitpierre à New York, parvient à convaincre Trygve Lie, le secrétaire général de l'ONU, de donner la préférence à Genève, au terme d'un excellent déjeuner, rapporte le conseiller d'Etat Albert Picot. Le rapport des experts envoyés à Genève par le Secrétaire général sera positif: Genève offre une infrastructure immédiatement utilisable pour l'organisation de conférences et pour le développement des activités d'un secrétariat axé plus particulièrement sur les affaires européennes. On y trouve également des archives et une bibliothèque de travail qui sont, on s'en apercevra avec le temps, des instruments précieux pour la connaissance des expériences accumulées par la première organisation internationale politique, créée en 1919.
Ainsi, on s'est rendu à Genève parce que les installations nécessaires à la conduite d'une activité politique à l'échelle mondiale s'y trouvaient. Des considérations d'ordre pratique ont prévalu. Mais il ne faudrait pas pour cela négliger la contribution fournie par quelques Genevois. Avec leurs amis étrangers, ils avaient tissé un réseau de relations intellectuelles et politiques et s'étaient fait un nom dans le monde. Quant au gouvernement fédéral, et très particulièrement à Max Petitpierre, ils voulaient faire de Genève une ville internationale. Ils ont également joué un rôle dans des décisions qui ont offert à Genève la possibilité de rayonner à nouveau et d'être ainsi fidèle à son mythe.
[p. 185]
Genève et l'Europe
C'est également grâce à des initiatives individuelles, comprises et soutenues par les pouvoirs publics, que Genève participera à la construction de l'Europe politique. La première des Rencontres Internationales de Genève, organisée en 1946 par le professeur Antony Babel, a pour titre "L'esprit européen". C'est un événement: le dialogue sur la culture commune des Européens est relancé. Il sera poursuivi grâce à Denis de Rougemont, figure de proue du personnalisme et du fédéralisme. A la fin de 1950, le Centre Européen de la Culture, issu d'une résolution du Congrès de l'Europe à La Haye de 1948 et d'une décision de la première Conférence européenne de la Culture tenue à Lausanne en 1949, commence ses activités à Genève d'où, pendant de nombreuses années, il rayonnera en Europe: par la grande campagne d'éducation civique européenne, par la création de la Fondation européenne de la Culture, de l'Institut universitaire d'études européennes. Le "Laboratoire européen de Recherches nucléaires", qui deviendra le CERN, aux origines duquel on retrouve Denis de Rougemont, s'installera à Genève en 1953, malgré une vive opposition qui sera contenue par un vote populaire.
La Genève européenne, si active qu'elle soit, n'occupera cependant pas beaucoup de place dans la Cité et n'attirera qu'un nombre modeste de manifestations et de personnes.
Prolifération des organisations internationales
Les organisations internationales mondiales vont tout au contraire proliférer. L'Organisation internationale du Travail (OIT) réintègre Genève en 1946 déjà. La Commission économique pour l'Europe (CEE) s'y installe en 1947, en même temps que le GATT, suivi, en 1948, par l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et par l'Union internationale des Télécommunications (UIT). Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (HCR) s'y établit en 1951, le Comité intergouvernemental pour les Migrations européennes (CIME) en 1954, l'Organisation météorologique mondiale (OMM) en 1955.
Il ne s'agit là que des plus importantes des organisations gouvernementales. On en trouvera la liste à la page 214. Le rappel de leur nom souligne cependant la diversité de leur champ d'activité et le pouvoir d'attraction du centre international qui se développe à Genève. La concentration de ces organisations est due à des considérations d'ordre politique [p. 186: image / p. 187] et pratique. Le processus d'intégration à l'échelle continentale et mondiale, qui caractérise l'évolution internationale, a pour effet la création et la multiplication des organisations non gouvernementales qui gravitent autour de l'une ou l'autre des organisations internationales gouvernementales, comme des groupes de pression permanents (p. 215-218).
Toute conférence intergouvernementale mobilise les organisations non gouvernementales, ce qui provoque de grands rassemblements de délégués, d'experts, de conseillers, de défenseurs de quelque cause et de la presse internationale, pour les grands événements. Ainsi, lors de la conférence de 1954 sur l'Indochine, lors du Sommet de 1955 qui réunit Dwight Eisenhower, président des Etats-Unis, Edgar Faure, premier ministre de la France, Anthony Eden, premier ministre du Royaume-Uni et le maréchal Nikolai Boulganine, président du Conseil des ministres de l'Union soviétique, ou, plus tard en 1985, lors de la rencontre entre Ronald Reagan et Mikhail Gorbatchev.
Il est évident que les grandes rencontres que sont les sessions annuelles, dans lesquelles les responsables de la conduite des organisations internationales font rapport à leurs mandants, ne peuvent se dérouler correctement que si une solide infrastructure existe dans la Cité qui les héberge. Or, Genève est en mesure d'assurer les services que l'on attend du pays hôte. Le fait qu'elle ait pu les assurer dès 1946 et qu'elle n'ait cessé d'améliorer ses prestations a été, sans aucun doute, une des raisons du développement de la Genève internationale.
La Genève internationale prend-elle trop de place?
Ce succès même va provoquer une réaction, soudaine, mais de courte durée, au sein d'une partie de la population qui trouve que la Genève internationale commence à prendre trop de place et que la Ville et le Canton ne sont pas en mesure de supporter la charge financière qu'implique une présence étrangère importante. C'est bien l'avis des autorités genevoises qui convaincront le Conseil fédéral de la nécessité d'une participation de la Confédération au programme de construction de bâtiments à mettre à la disposition des organisations internationales. Les démarches genevoises aboutiront, au début de 1965, à la création par la Confédération et le Canton d'une Fondation des immeubles pour les organisations internationales (FIPOI). [p. 188]
Dès que la nouvelle de la décision prise par la Confédération est connue, un référendum est lancé. Pour les adversaires de la FIPOI, il s'agit de mettre un coup d'arrêt au développement désordonné des organisations internationales, de contraindre le Conseil fédéral à réviser les accords de siège, de revoir le statut fiscal des fonctionnaires internationaux, de limiter leurs effectifs de manière à réduire la concurrence avec les entreprises locales et d'obtenir une participation des organisations internationales au logement de leurs fonctionnaires. Ils défendent avec passion les intérêts de la Cité, en exprimant avec véhémence un sentiment de frustration. La mauvaise humeur est assez largement répandue. Elle transcende les frontières des partis, dont les membres prendront cependant en majorité position pour la FIPOI.
Un survol des thèmes de la campagne pourrait conduire à la conclusion que le débat porte essentiellement sur des problèmes matériels: logement, exemption fiscale, incidence de la présence des organisations internationales sur le coût de la vie. Les référendaires appellent les Genevois à se mobiliser contre les envahisseurs... Mais ils prennent soin de dire qu'ils ne sont pas opposés en principe à ces organisations et font naturellement l'éloge du CICR, une institution qui est née à Genève et qui incarne son esprit.
Ceux qui mènent la campagne en faveur de la FIPOI répliquent en citant des statistiques qui relativisent la menace que la Genève internationale fait peser sur la Cité. Léopold Boissier, Alfred Borel, Albert Picot rappellent avec éloquence la mission de Genève, ses devoirs envers la communauté internationale, le rôle qui lui est assigné dans la politique extérieure de la Suisse neutre. La votation aura lieu le 4 avril 1965. Les référendaires seront battus.
Fidélité au mythe
Le mythe a donné aux Genevois la force de surmonter un accès de colère surgissant dans une période difficile de transformation de la société. Le référendum, en fait, est un test de la fidélité des Genevois à leurs traditions. Il a rendu service à la Cité en mettant en évidence les incidences sociales et politiques de l'implantation de gens venus d'ailleurs et travaillant à l'échelle du monde sur les habitants d'un petit canton suisse qui ne veulent pas qu'on vienne troubler le rythme de leur vie quotidienne.
Le référendum a contribué également à une prise de conscience de l'existence d'une politique genevoise de dimension internationale et de l'effort accompli pour sa mise en oeuvre. [p. 189]
Ainsi, l'amélioration de la piste principale de l'aéroport, portée à 1.800 mètres entre 1943 et 1945, a représenté un atout non négligeable dans la présentation de la candidature de Genève comme siège du centre européen de l'ONU. Les initiatives prises par le Conseil d'Etat, emmené par Louis Casaï, ont permis à Genève de rester compétitive.
Cette petite crise a rapproché Berne de Genève, contraignant le gouvernement fédéral à procéder à un examen approfondi des problèmes concrets que pose la mise en oeuvre d'une neutralité active, conciliant la prudence et l'ouverture au monde. "La manière dont Genève remplit sa mission contribue à former ce qu'on appelle l'image de la Suisse dans le monde", déclare le conseiller fédéral Willy Spühler lors de la visite qu'il rend à Genève le 26 juin 1967, deux ans après l'échec du référendum.
"C'est en effet à travers Genève que ceux qui sont engagés dans cette entreprise de coopération internationale jugent souvent notre pays et apprécient la valeur de la neutralité suisse. Genève internationale est une porte de la Suisse ouverte au monde..., un lieu de rencontre de l'esprit de charité et d'oecuménisme, un lieu où convergent tous les courants de la pensée, où l'on s'attaque ensemble aux grands problèmes de notre monde, où l'on lutte contre le sous-développement, la maladie, où l'on cherche à améliorer les conditions de travail, où l'on explore l'atome. Cela est source pour nous tous d'un grand enrichissement spirituel."
Et le conseiller d'Etat André Chavanne, président du Conseil d'Etat, qui le reçoit, conclut son allocution par ces mots:
"En demeurant le symbole de cet effort patient d'accord entre nations, qui reste la tâche primordiale de notre génération, Genève servant la paix sert ses «fidèles et chers Confédérés», cette Confédération de cantons libres qui a résisté aux forces centrifuges nées de la diversité de sa population et qui a maintenu, contre vents et marées, le respect mutuel sur lequel se base toute vie nationale et internationale."
La brusque montée de tension de 1965 renforcera les Genevois dans leur conviction que leur Cité doit assumer une mission internationale par fidélité à son histoire et par devoir à l'égard de la Confédération suisse. Il y aura encore des frottements, tant sont nombreux les problèmes que pose la coexistence des deux Genève. La presse genevoise, qui soutient en général les organisations internationales et porte de l'intérêt à la vie internationale, se montre parfois critique. Certains journalistes ont même tendance à intervenir dans [p. 190: image / p. 191] des affaires internes et à se faire les porte-parole des mécontents. Mais on sera, de part et d'autre, attentif à résoudre ces problèmes dans les plus courts délais.
Les rapports se normalisent
La Mission permanente de la Suisse auprès des organisations internationales s'y emploiera, allégeant ainsi sensiblement la charge qui pèse sur le Canton. Tous les ambassadeurs qui se succèdent à la tête de la Mission suisse joueront un rôle extrêmement utile, aussi bien dans les contacts à maintenir avec les administrations des organisations internationales et avec les missions permanentes des pays membres de l'ONU que dans la vie de la Cité. Dans cette dernière partie du XXe siècle où les sociétés se fragmentent en groupes d'intérêts à l'horizon limité, où les grandes options politiques ne se concrétisent qu'en période de crise, l'activité quotidienne du diplomate est mal perçue. On imagine qu'elle se disperse en broutilles, en négligeant le fait que les relations publiques consistent essentiellement en dialogues entre des personnes, en dialogues grâce auxquels on élimine les malentendus possibles et on évite des conflits. Les diplomates avisés ne font pas d'histoires. Leur discrétion est une condition d'efficacité. L'ambassadeur Olivier Long en a fourni la preuve dans la mission suisse de paix en Algérie qui a permis la conclusion des accords d'Evian du 19 mars 1962.
Les rapports entre les Genevois et leurs hôtes internationaux seront stimulés par des initiatives privées. Le Club de la presse et des amitiés étrangères, créé peu après la bataille du référendum, jouera un rôle très utile en établissant, grâce à ses grandes conférences et à un programme de rencontres régulières, un cadre favorable au développement d'échanges intellectuels et d'informations réciproques. Le Club diplomatique est né de la même préoccupation d'encourager au dialogue.
Les Genevois bénéficient d'ailleurs très largement de la présence des organisations internationales, comme le relève, dans un petit livre sur Genève et la vie internationale, P.P. Spinelli, qui occupait avec distinction le poste de directeur de l'Office européen des Nations Unies:
"Plus que par des écrivains connus, c'est par des généra-tions continues d'hommes intelligents, curieux, à l'esprit ouvert et courageux, qu'elle (Genève) a conquis sa place dans le monde des idées. Cette longue et fructueuse tradition se renouvelle et puise des forces accrues dans la vie [p. 192] internationale."
Et de citer les échanges entre l'Université et l'OMS, le CERN ou le BIT, ainsi que l'enseignement de l'Institut de hautes études internationales.
On pourrait allonger cette liste et mentionner le Centre Européen de la Culture fondé par Denis de Rougemont et l'Institut des Sciences de l'Education illustré par Jean Piaget, ou encore l'Institut universitaire d'études du développement, l'Institut universitaire d'études européennes, déjà mentionné, le World Economic Forum et d'autres institutions ou des personnalités qui maintiennent la tradition suisse et genevoise d'intermédiaire neutre, de médiateur, de centre d'arbitrage et de négociation. Le potentiel intellectuel de Genève est considérable pour peu qu'on sache l'utiliser.
On aurait pu imaginer que les Genevois accepteraient la proposition de faire adhérer la Suisse à l'ONU. Ce ne fut pas le cas. Malgré un message très positif du Conseil fédéral, du 21 décembre 1981, et un vote favorable des Chambres, une majorité très nette opta pour le refus, à Genève comme dans la Suisse tout entière, le 16 mars 1986 (24 pour cent de oui en Suisse, 30 pour cent à Genève). A cette époque, l'ONU était encore l'objet de vives critiques que les partisans de l'adhésion ne parvinrent pas à réfuter.
Le message humanitaire et oecuménique
Néanmoins deux institutions sont là, qui contribuent, plus encore que celles que nous avons mentionnées, au rayonnement de Genève: le Comité international de la Croix-Rouge et le Conseil oecuménique des Eglises.
Le CICR, seule institution "uninationale" à vocation internationale, va être impliqué dans les conflits internationaux toujours plus nombreux et dont le champ d'action s'étendra au monde entier. Il n'est pas certain que les Genevois, qui sont fiers de leur Croix-Rouge, soient tous conscients de l'oeuvre accomplie à Genève et, plus encore, sur le terrain, dans des conditions toujours plus difficiles. Les relations qu'entretient le CICR avec la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge seront parfois conflictuelles et la division du travail toujours difficile à faire appliquer conformément aux accords passés entre les deux institutions qui rivalisent de zèle humanitaire. Mais cette rivalité ne diminue pas le rôle joué par Genève, depuis 1919, comme centre mondial du Mouvement de la Croix-Rouge et des agences bénévoles, qui sont venues s'installer dans la ville. [p. 193]
Autre institution, illustrée par le pasteur Visser t'Hooft, dont la présence honore Genève et la fait connaître dans le monde entier: le Conseil oecuménique des Eglises qui, lui aussi, rassemble autour de lui d'autres organisations de dimension mondiale, dont la Fédération luthérienne mondiale et l'Alliance réformée mondiale (voir le tome V de cette Encyclopédie, pages 214-217). Et il ne faudrait pas oublier, parmi les richesses humaines qu'abrite Genève, l'Alliance universelle des Unions chrétiennes de Jeunes Gens, l'Alliance mondiale des Unions chrétiennes féminines et le Bureau mondial du Scoutisme.
La Genève internationale déborde d'ailleurs largement le cadre des organisations internationales, de l'Université et de ses instituts ou de centre indépendants. Elle englobe les banques, les avocats internationaux dont l'activité s'est considérablement développée, l'ensemble du secteur des services. La ville, en fait, s'est internationalisée non pas seulement par l'apport des "internationaux", mais par le développement des échanges transfrontaliers.
Coexistence pacifique
Mais la Cité n'en continue pas moins à mener sa propre vie et à se préoccuper en priorité — ce qui est naturel — des problèmes qui naissent de sa trop rapide croissance et du processus de modernisation auquel elle n'échappe pas. [p. 194]
Les organisations internationales, quant à elles, poursuivent leurs activités. Considéré dans la longue durée, leur taux de croissance n'est pas de nature à inquiéter le peuple genevois: 14.267 personnes employées dans les organisations gouvernementales en 1978, 16.896 en 1989, selon les données fournies par le Service cantonal de Statistique en janvier 1990. Le personnel des missions permanentes passe pendant cette même période de 2.374 à 3.366; celui des organisations non gouvernementales de 2.158 à 2.663. Quant au nombre des personnes qui participent au cours d'une année à des réunions internationales, il s'élève en 1978 à 50.277 et en 1988 à 77.415, sensiblement plus que celui des participants à des conférences organisées par les organisations non gouvernementales qui passe de 6.585 à 10.355.
Ces conférences attirent des personnalités intéressantes, avec lesquelles les Genevois peuvent, pour peu qu'ils le veuillent, établir des contacts parfois durables. Elles créent du mouvement, contribuent à la marche des affaires et au rayonnement de la Cité de Calvin, du Comité international de la Croix-Rouge. Il n'y a pas de raison de s'en plaindre.
Pour qui parcourt les programmes présentés par les partis politiques à la veille des élections cantonales de 1989, les organisations internationales ne sont pas en question. Ce sont les problèmes de la Cité qui retiennent l'attention et c'est au sujet de l'aménagement du Palais Wilson que s'affrontent les Genevois internationaux et les habitants des Pâquis.
Un centre de politique mondiale?
La réponse à cette question ne peut être que nuancée. Genève est sans nul doute un centre de politique internationale si l'on considère les quelques grandes conférences qui se sont tenues à Genève pour des raisons diverses: attraction du site, garantie apportée par la Suisse, par un petit pays sans grande influence sur les affaires mondiales. Mais ces rencontres, si importantes qu'elles puissent être ou paraître, ne suffisent pas à placer Genève sur le même plan que Moscou, Washington, Londres, Paris même. Ces grandes villes ont une importance politique, parce qu'elles sont le siège d'un gouvernement qui dispose de moyens de la grande politique et dont, par conséquent, la décision compte.
La politique des Nations Unies se fait à New York, au cours des sessions de l'Assemblée générale ou du Conseil de Sécurité, mais plus encore dans les innombrables conversations et négociations qui se déroulent tout au long de l'année dans les bureaux et dans les couloirs. [p. 195]
Cela ne veut pas dire qu'il ne se fasse pas de politique à Genève au sein des organisations internationales spécialisées. Tout au contraire, il est bien certain qu'il n'y a pas dans le monde actuel, du fait de sa division, du fait du caractère "révolutionnaire" de la politique de certains Etats, du fait aussi de la floraison des nationalismes, de discussion technique qui n'ait un aspect politique. Qu'il s'agisse de la structure de l'OIT, du contrôle de l'énergie atomique, du commerce Est-Ouest, de l'assistance technique, de questions relatives aux télécommunications, à la météorologie, l'expert est impliqué dans les grands jeux de la politique. Les répercussions politiques des décisions prises au GATT sont importantes.
De ce point de vue, Genève est un centre de politique internationale, un centre où se pratique en permanence ce qu'il est convenu d'appeler aujourd'hui la diplomatie multilatérale; centre où, jour après jour, se déroulent des négociations d'une portée limitée sans doute, mais qui n'en ont pas moins une importance pour l'ensemble. Car on ne devrait pas sous-estimer l'intérêt politique des organisations internationales qui offrent à ceux qui savent s'en servir des possibilités de manoeuvres et de pénétration leur permettant de compléter l'action de la diplomatie bilatérale. L'histoire de ces dernières années offre sur ce point des exemples suggestifs.
Les organisations internationales ne sont cependant pas forcément des champs de bataille. Elles ont été conçues plutôt dans l'espoir qu'elles permettraient de résoudre en commun les problèmes techniques et politiques que pose l'organisation de la paix. Elles offrent donc un point de rencontres et d'échanges.
La Cité de Genève qui les abrite joue ainsi un rôle utile. Sans être un centre de politique mondiale, elle demeure, comme l'avait déjà dit César, un poste d'observation et, il faut l'espérer, un phare d'où rayonnent la compassion et l'oecuménisme.
J. F.
haut
[p. 196: image / p. 197]
Le Comité international de la Croix-Rouge
Le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) qui domine du haut de la colline de Pregny le quartier international de Genève est particulièrement cher aux Genevois. Non seulement ce sont cinq personnalités genevoises — le Général Dufour, Gustave Moynier, Henry Dunant et les Dr Louis Appia et Théodore Maunoir — qui ont fondé l'institution en 1863, dans le cadre de la Société genevoise d'utilité publique, mais encore d'innombrables Genevois ont participé à ses activités à un titre ou à un autre (membres du Comité, délégués, etc.), au cours des cent vingt-cinq ans de son existence.
Le caractère exclusivement genevois du Comité à ses débuts s'est modifié dès la fin de la Première Guerre mondiale pour devenir suisse. D'éminentes personnalités non-genevoises ont en effet depuis lors fait partie du Comité et l'ont parfois présidé. On rappellera à cet égard les noms des présidents Max Huber, Carl Burckhardt, Paul Ruegger et celui de l'ancien commandant de corps Samuel Gonard. Aujourd'hui (1989), le Comité est présidé par un Tessinois, M. Cornelio Sommaruga, ancien secrétaire d'Etat aux affaires économiques extérieures.
Un souvenir de Solférino
Henry Dunant assiste, en 1859, à la bataille que Français et Piemontais livrent aux Autrichiens à Solférino, dans le nord de l'Italie; elle fait en quelques heures 40.000 victimes, morts et blessés. Bouleversé par l'abandon dans lequel sont laissés les blessés sur le champ de bataille, il publie, en 1862, Un Souvenir de Solférino, dans lequel il propose que soient créées dès le temps de paix des "Sociétés volontaires de secours qui auraient pour but de donner ou de faire donner en temps de guerre des soins aux blessés"; ces Sociétés "devraient obtenir la bienveillance des autorités du pays où elles auraient pris naissance et solliciter, en cas de guerre, auprès des souverains des puissances belligérantes, des permissions et des facilités pour conduire leur oeuvre à bonne fin"; il exprime en conclusion le voeu que soit formulé "quelque principe conventionnel et sacré, lequel, une fois agréé et ratifié, servirait de base à des Sociétés de secours pour les blessés dans les divers pays de l'Europe".
Alertée par son président, Gustave Moynier, la Société genevoise d'utilité publique désigne une commission de cinq membres qui, dès sa première séance, se constitue en "Comité international de secours aux blessés" — futur CICR — et multiplie les démarches en vue de la réalisation des [p. 198] idées d'Henry Dunant. Une conférence internationale se réunit à Genève au mois d'octobre 1863 puis, à l'initiative du Conseil fédéral, une conférence diplomatique est convoquée qui adopte, le 22 août 1864, la Première Convention de Genève. Cette convention entérine le principe de la "neutralisation" des médecins et infirmiers intervenant sur les champs de bataille, porteurs d'un signe distinctif, la croix rouge sur fond blanc. Dès lors se constituent les sociétés de secours, futures Sociétés nationales de la Croix-Rouge (et du Croissant-Rouge dans la plupart des pays musulmans). A l'initiative du Comité, plusieurs conventions internationales furent conclues par la suite, qui chaque fois marquèrent un progrès dans la protection des non-combattants. Aujourd'hui le CICR agit sur la base de mandats qui lui sont donnés par les quatre Conventions de Genève de 1949, ratifiées par l'ensemble des pays du monde et par les deux Protocoles additionnels de 1977 qui sont en voie de ratification; ces mandats concernent la protection des victimes des conflits armés. Toutes les actions entreprises par le CICR dans les différentes parties du monde se basent donc, soit sur les dispositions desdites Conventions, soit sur ses statuts. Le nombre des sociétés nationales, de son côté, a crû énormément. Il s'élève aujourd'hui à 150 — une société nationale dans presque tous les pays du monde. A l'issue de la Première Guerre mondiale, en 1919, l'opinion prévalait qu'il n'y aurait plus jamais de guerre entre Etats. La Société des Nations, qui venait d'être créée, veillerait à ce qu'il en soit ainsi. Dans les milieux de la Croix-Rouge, on pensait dès lors [p. 199] que les sociétés nationales devaient s'adonner à de nouvelles activités réalisables en temps de paix et visant à l'amélioration du bien-être social et de la santé. Pour faciliter l'accomplissement de ces nouvelles tâches, elles décidèrent de se fédérer et créèrent la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Le siège du secrétariat de la Ligue se trouve tout près de celui du CICR à Genève.
Le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
Le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge est composé de trois entités (les "composantes"):
— le CICR, organe fondateur du Mouvement
— les Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
— la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge et du Crois-sant-Rouge.
Chacune de ces entités a ses fonctions propres:
— le CICR, exclusivement suisse, intermédiaire neutre, intervient dans les conflits armés, internationaux ou non, les troubles et tensions intérieurs
— les Sociétés nationales oeuvrent à l'intérieur des frontières de leur pays en tant qu'auxiliaires des pouvoirs publics. Elles s'occupent en particulier des questions de santé, des soins infirmiers, des secours aux sinistrés et déshérités, des problèmes de la jeunesse, etc. Elles participent aussi à des actions humanitaires internationales en coordination, soit avec le CICR, soit avec la Ligue; parfois elles opèrent directement
— quant à la Ligue, elle est l'organe de liaison entre les Sociétés nationales; en particulier, elle organise et coordonne, à l'échelon international, les secours de la Croix-Rouge lors d'une catastrophe naturelle (inondation, séisme, etc.) dont les dimensions dépassent les possibilités de la Croix-Rouge nationale. Elle s'efforce également de développer et de renforcer les Sociétés membres.
Ces différentes composantes du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge sont liées entre elles par ses Principes fondamentaux que sont l'humanité, l'impartialité, la neutralité, l'indépendance, le volontariat, l'unité et l'universalité.
En principe, tous les quatre ans, le Mouvement tient une Assemblée avec tous les Etats qui ont ratifié les Conventions de Genève. C'est la "Conférence internationale de la [p. 200] Croix-Rouge et du Croissant-Rouge", sorte de "Parlement" du Mouvement mondial de la Croix-Rouge, sa plus haute autorité délibérante. Ses décisions et résolutions lient toute la Croix-Rouge et tous les Etats parties aux Conventions.
Le CICR sur le terrain
Le Comité international de la Croix-Rouge tient au coeur des Genevois. Mais savent-ils ce qu'il fait dans le monde? Connaissent-ils l'ampleur de sa tâche? Celle-ci s'est, en fait, énormément accrue au cours des dernières années en raison de la multiplicité croissante des conflits armés. Savent-ils que les délégués du CICR sont présents dans les cinq continents?
La tâche essentielle du CICR est de protéger et d'assister, sans discrimination d'aucune sorte, toutes les victimes de conflits armés ou de troubles intérieurs. Il porte secours aux non-combattants (blessés et malades militaires, prisonniers de guerre, détenus politiques et les civils). Dans bien des cas, pour assurer la survie de ces victimes, il est nécessaire de leur apporter des secours soit alimentaires, soit médicaux. Ces secours ont parfois pris un volume considérable; ils cessent quand la période d'urgence est terminée, le CICR ne s'engageant pas dans des actions à long terme. Il est vrai que l'urgence se prolonge parfois pendant des années (comme au Liban, dans les Territoires occupés, au Cambodge, etc.). Le Comité considère que sa tâche la plus spécifique est celle de protéger ceux qui sont hors de combat; c'est d'ailleurs ce en quoi il se distingue d'autres organisations humanitaires.
Pour accomplir sa mission, le Comité dispose actuellement (en 1989) de 30 délégations et sous-délégations, et de 15 délégations régionales. Ces délégations se trouvent dans les pays où se déroulent des conflits armés, soit internationaux, soit locaux. Quant aux délégations régionales, elles sont installées dans des capitales de pays en paix, mais où le CICR estime nécessaire de maintenir un contact permanent avec les autorités et les Sociétés nationales pour s'y faire connaître et en particulier pour y diffuser le droit humanitaire (donc le contenu des Conventions de Genève). Il a constaté en effet que lorsqu'un conflit armé survient, si le CICR est déjà connu des parties en cause, son action peut se développer beaucoup plus facilement et plus rapidement. Ainsi, le Comité est présent dans environ 80 pays à la fin de 1989.
Il est difficile de dire quelles sont les délégations les plus importantes. Les événements changeant très rapidement, ils peuvent donner un poids considérable à une délégation qui quelques mois auparavant était moins exposée. [p. 201: image / p. 202]
A titre d'exemples, voici les principaux terrains d'activité du CICR en 1989:
— en Afrique: le Mozambique, l'Afrique du Sud, l'Angola, l'Ouganda, le Sud Soudan, la Corne de l'Afrique et le Sahara occidental
— en Asie: le conflit afghan, le Cambodge et les Philippines
— au Moyen-Orient: l'Iran et l'Irak, le Liban et les Territoires occupés
— en Amérique latine: le Salvador, le Nicaragua, le Pérou et la Colombie
— en Europe: les événements survenus dans les pays de l'Europe orientale, en particulier ceux de Roumanie, ont été au centre des préoccupations du CICR
Les visites aux prisonniers
Les visites aux prisonniers de guerre sont prévues dans les Conventions de Genève; il n'en est pas de même des visites aux détenus politiques (appelés aussi détenus de sécurité) pour lesquels, se basant sur le droit d'initiative en matière humanitaire qui est stipulé dans ses statuts, le Comité a dû négocier, parfois âprement, avec les gouvernements pour obtenir la possibilité d'entrer dans les prisons à ses conditions: entretiens avec tous les détenus et sans témoins, répétition des visites. Depuis la fin de la guerre 1939-45, le CICR a visité plus de 500.000 détenus politiques dans une centaine de pays; ces visites sont un moyen efficace pour lutter contre la torture et les mauvais traitements.
L'Agence centrale de Recherches (ACR)
Une tâche importante du CICR est celle accomplie par l'Agence centrale de Recherches (ACR) — connue autrefois sous le nom d'Agence centrale des prisonniers de guerre — créée en 1870/71. Elle enregistre le nom des prisonniers de guerre et des détenus politiques, leur assurant ainsi la protection du Comité. Elle s'efforce de recueillir également toute information relative aux internés et aux personnes déplacées. Elle informe les familles sur le sort des captifs et des disparus qu'elle recherche, créant ainsi un lien entre eux.
Outre les regroupements familiaux auxquels elle procède, elle établit des attestations de capture, de décès, etc. Les archives de l'ACR sont considérables: elles comptent quelque 6o millions de fiches.
[p. 203]
Les délégués du CICR
En raison de l'étendue de ses activités et de la complexité des situations auxquelles il doit faire face, le Comité doit disposer de délégué(e)s efficaces. On demande qu'ils soient si possible de niveau universitaire et surtout dotés d'une personnalité solide et d'une motivation humanitaire telle qu'ils soient capables de maîtriser des situations parfois très difficiles, délicates ou dangereuses. Leur nombre n'a cessé de croître ces dernières années et atteignait, le 31 décembre 1989, 1.450 collaborateurs et collaboratrices, dont 800 expatriés (hors de Genève); ils sons soutenus sur le terrain par 4.500 collaborateurs locaux. Les délégués sont de nationalité suisse. Toutefois, dans le domaine médical et technique, le Comité recourt aussi à des étrangers. En général, il s'agit de collaborateurs mis à la disposition du CICR par des Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Sur les 800 délégués sur le terrain à fin 1989, 150 provenaient de telles sociétés.
L'action médicale
Au cours des dernières années, le Comité a beaucoup développé ses activités médicales. En effet, outre ses tâches normales (évaluation et planification des besoins médicaux, services hospitaliers pendant les hostilités, participation aux [p. 204] visites des prisonniers de guerre et des détenus politiques), la Division médicale a notablement élargi son champ d'action; elle a développé une aide médicale de plus en plus élaborée aux invalides de guerre, en établissant des centres de réadaptation des amputés; de plus, elle a consacré de grands efforts à la médecine préventive. Dans son activité médicale, le Comité peut compter sur l'appui de nombreuses sociétés nationales qui, au premier appel, mettent des équipes médicales à sa disposition.
Le financement du CICR
Il est légitime de se demander comment le CICR finance ses nombreuses activités. En effet, il ne dispose d'aucune ressource propre. Il est donc entièrement financé par les gouvernements qui ont ratifié les Conventions de Genève, par les Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et par certains dons privés.
Le CICR a deux sortes de budgets:
— le budget "siège", destiné à assurer le fonctionnement général de l'institution. Les recettes proviennent des contributions des gouvernements et des Sociétés nationales, de dons, legs, collectes, etc. La Confédération helvétique, à elle seule, y participe pour près de 50 pour cent
— les budgets "terrain", destinés au financement des opérations résultant des situations de conflits ou de troubles. Ces budgets sont couverts grâce à des appels ad hoc, auxquels répond la communauté internationale.
Les contributions des gouvernements et des sociétés nationales sont purement volontaires. Il ne s'agit pas de "cotisations" obligatoires, comme dans la plupart des organisations internationales. L'existence du CICR et ses possibilités d'action dépendent donc de la bonne volonté et de la générosité des Etats et des Croix-Rouges nationales.
En 1989, les dépenses du CICR, tous budgets réunis, se sont élevées à quelque 380 millions de francs.
Le CICR et la paix
Le CICR s'emploie à prévenir et à soulager les souffrances nées de la guerre. Ne peut-il pas aussi oeuvrer en faveur de la paix? Il le fait.
Le rôle du CICR n'est pas d'empêcher les conflits, mais d'en restreindre les violences. Sans vouloir s'en prendre directement aux racines du mal — tâche essentiellement politique [p. 205: image / p. 206] — il n'en combat pas moins ce mal. Car l'idée de la Croix-Rouge — chercher à atténuer la souffrance, protéger la vie et la santé, défendre la dignité de l'homme — est fondamentalement liée à l'idée de paix.
Promoteur du droit international humanitaire, le CICR est, en fait, un facteur unique de la solidarité internationale, de la compréhension mutuelle, de la coopération et, partant, de la paix entre les peuples. Ses efforts dans ce domaine ont été universellement reconnus. En témoignent le premier Prix Nobel de la Paix décerné, en 1901, au fondateur de la Croix-Rouge, Henry Dunant, et le même Prix attribué à trois reprises au CICR: en 1917, 1944 et 1963 (cette dernière année, conjointement avec la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge). En témoigne aussi le Prix des Nations Unies des Droits de l'homme, dont le CICR a été l'un des lauréats en 1978.
Musée international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
Pour mieux faire connaître l'ampleur et la diversité de la mission de la Croix-Rouge dans le monde, il a été décidé de construire un Musée; celui-ci a été inauguré à la fin du mois d'octobre 1988 et se trouve dans la colline du CICR, à l'avenue de la Paix. Financé par des dons publics et privés, il est propriété d'une fondation privée suisse; son initiateur et actuel directeur est un ancien délégué du CICR. Le Musée retrace, grâce aux moyens audio-visuels les plus modernes, l'histoire étonnante du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge à travers les événements historiques de notre temps.
A. H.
haut
[p. 207]
La coopération au développement
La coopération Genève est ouverte au monde, ouverte aux apports de la religion, de la culture, de la science et de la technique, ouverte aussi à l'appel du large, des civilisations proches et lointaines, ouverte enfin aux misères des pays du Tiers Monde qu'elle s'efforce d'atténuer dans la mesure de ses moyens. Ces moyens sont de trois sortes: centres de formation, financement de projets et engagements personnels. Dans le domaine de la formation, Genève intervient principalement à deux niveaux: au niveau universitaire avec l'Institut d'études du développement et au niveau professionnel avec le Centre de perfectionnement technique.
L'Institut universitaire d'études du développement
L'Institut universitaire d'études du développement (IUED) a été créé en 1961 sous le nom de "Centre genevois pour la formation de cadres africains". Sa raison sociale actuelle et la convention qui le lie à l'Université de Genève datent de 1977. Il est géré par la Fondation pour l'étude du développement, dont le but est de promouvoir l'enseignement et la recherche relatifs aux problèmes du développement et de favoriser l'accueil d'étudiants du Tiers Monde.
L'activité de l'IUED est axée sur l'enseignement, la recherche, la poursuite d'études et de projets et la présentation de ces activités dans des publications périodiques. Les candidats doivent être en possession d'une licence universitaire ou d'un titre équivalent, ou encore avoir cinq ans d'expérience professionnelle de qualité. De plus, on exige une bonne connaissance du français. Le nombre d'étudiants approche de 400, dont les trois quarts environ sont des étudiants réguliers inscrits en vue d'obtenir un certificat, un diplôme ou un diplôme de recherche. Le programme est étalé sur deux ans, la première année comportant des cours ex cathedra et des séminaires, tandis que la seconde année est centrée sur les séminaires et les exercices pratiques.
Le Centre de perfectionnement technique de Genève
Le Centre de perfectionnement technique de Genève (CPTG) a été créé en 1965 par le Canton pour former et perfectionner des stagiaires du Tiers Monde, boursiers de la Confédération au titre de la coopération au développement. [p. 208] Il vise surtout à former des instructeurs de centres d'industrie, plus spécialement en mécanique, en métallurgie et en électrotechnique.
Les candidats doivent avoir entre 20 et 30 ans, et posséder un certificat d'aptitudes professionnelles ainsi qu'une expérience suffisante en mécanique générale. En vingt ans, de 1965 à 1985, le CPTG a formé 258 stagiaires, la plupart en provenance d'Afrique. L'enseignement dure deux ans, il est couronné d'un certificat ou d'un diplôme suivant les résultats obtenus par le stagiaire.
Le financement de projets dans les pays en développement
La coopération au développement est fondée, au plan fédéral, sur la loi du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales. Elle a trouvé à Genève un terrain favorable. Grâce aux contacts qui se sont noués, sur place et à Genève même, avec des étrangers, l'ouverture au monde s'est traduite de façon tangible. D'une part, de nombreuses associations se sont créées avec pour objectif de contribuer au développement du Tiers Monde, d'autre part les pouvoirs publics, Etat et communes, ont dégagé des fonds à cet effet. Mais la dispersion des efforts et le manque de rigueur de certaines initiatives étaient préjudiciables au but poursuivi. Il fallait un organe de liaison et de contrôle entre les associations, qui avaient des projets de développement et des hommes d'expérience pour les réaliser, et les pouvoirs publics, qui disposaient des moyens financiers nécessaires. Dès lors, la plupart des associations se sont groupées en une Fédération genevoise de coopération (FGC), créée en 1966, pour partager leurs expériences et coordonner leur action, informer le public des problèmes posés par le développement et soutenir des actions directes en faveur des pays en développement.
C'est un cas unique en Suisse, et sans doute en Europe, de cogestion de l'aide au Tiers Monde entre l'Etat et un organisme privé, d'autant plus remarquable que des hommes et des femmes poursuivant des objectifs différents, animés par des motifs variables, ont accepté de travailler ensemble en abandonnant une part importante de leur pouvoir de décision. Cette cogestion est définie dans un protocole d'accord du 9 avril 1986, dans lequel la FGC est présentée comme "une interlocutrice privilégiée de l'Etat de Genève pour l'étude et le financement de programmes de développement [p. 209] dans le monde". Elle est chargée d'étudier et suivre les projets d'aide au Tiers Monde qu'elle présente et d'établir des rapports réguliers sur l'état d'avancement de ces projets et sur l'emploi des fonds accordés. Ses rapports avec la Ville sont régis par un règlement et suivent un parcours analogue.
Le Canton contribue à raison de 2,3 millions de francs, pour 1990, à la réalisation des projets qui lui sont présentés, soit par la FGC soit directement par une association d'aide au Tiers Monde, tandis que la Ville y consacre 0,2 pour cent de son budget. La plupart des communes du Canton font elles aussi un effort financier, généralement pour soutenir un projet spécifique. Une initiative populaire cantonale a été déposée le 11 août 1980, intitulée "0,7. Pour la création d'un fonds cantonal d'aide au développement", qui visait à porter à 0,7 pour cent la part du produit cantonal brut consacrée par le Canton à l'aide au développement. Elle a été repoussée le 26 septembre 1982 par 42.484 voix contre 20.599, mais elle a eu un effet positif puisque l'Etat et la Ville ont augmenté sensiblement leur contribution à partir de 1983.
Un accord règle aussi les conditions de collaboration avec la Direction de la coopération au développement et de l'aide humanitaire du Département fédéral des affaires étrangères (DDA). Le dernier date du 28 juillet 1988, il prévoit une contribution de 1.200.000 francs à la FGC, à titre de participation au financement de son programme de développement de 1987 à 1990, pour des projets acceptés par la DDA et cofinancés par elle. Un nouvel accord est en négociation; la FGC espère que la contribution de la DDA sera portée à 5 millions de francs pour trois ans.
La procédure suivie par la Fédération genevoise de coopération
Les projets sont soumis à la Commission technique de la FGC, forte de 14 membres, qui donne son préavis au Conseil et à l'Assemblée générale. Ils sont alors présentés aux bailleurs de fonds, avec un préavis de la DDA si elle participe au financement. Les fonds sont remis à la FGC qui les distribue aux associations, en retenant 1,5 pour cent pour son activité d'information. Une société fiduciaire contrôle les comptes des différents projets.
Les principaux critères d'appréciation des projets sont les suivants: ils doivent répondre à des besoins ressentis par les bénéficiaires eux-mêmes, formulés et transmis par des groupes locaux; ils doivent favoriser au maximum la participation des intéressés, améliorer leurs conditions de vie et [p. 210] produire un effet d'entraînement dans le pays ou la région; ils doivent être conformes à la mentalité et au génie propre de la population concernée, utiliser les capacités locales en main-d'oeuvre, en technique et en ressources de telle façon qu'ils puissent être pris en charge très rapidement par les bénéficiaires eux-mêmes. La participation financière de la FGC ne peut dépasser 220.000 francs par projet et par an.
La FGC a accepté, en 1989, 71 projets, pour un montant total de 5.424.731 francs, consacrés avant tout à des programmes de formation (43,5%) et de développement rural (33,15%), en Amérique latine (33,8%) et en Afrique (32,7%).
Payer de sa personne
Les efforts qui sont faits à Genève pour aider les pays en développement sont presque entièrement bénévoles.
Le secrétariat de la FGC ne comporte que deux postes rétribués et sa Commission technique, composée exclusivement d'experts bénévoles, se réunit chaque semaine pour examiner les projets soumis par les associations. Celles-ci s'efforcent de réduire au minimum leurs frais de fonctionnement. A titre d'exemple, Terre des Hommes Suisse occupe soixante-dix volontaires chargés de suivre les projets et d'en contrôler l'avancement.
La décision de s'engager dans un projet d'assistance technique n'est presque jamais l'effet du hasard ou d'une démarche purement administrative. Ce sont généralement les fruits d'une expérience personnelle, de contacts avec la misère, la faim, le dénuement dans un pays du Tiers Monde, ou encore des révélations faites par des réfugiés de ces pays.
Des projets concrets
C'est ainsi que sept communes de la Champagne genevoise (Chancy, Avully, Avusy, Soral, Laconnex, Cartigny et Aire-la-Ville) ont décidé de financer une école professionnelle au Burkina-Faso, dirigée par l'un de leurs ressortissants, M. John Berthod. Cette école avait été créée par des pères belges obligés de quitter le pays. M. Berthod, qui avait vécu une dizaine d'années dans le pays, a pu, grâce à l'aide de ses compatriotes, reprendre les installations et les remettre en état. L'école compte 60 élèves répartis en trois sections: maçons, serruriers et mécaniciens. Les communes financent le salaire du directeur et l'outillage qui est remis aux élèves à la fin de leur formation pour leur permettre de s'établir. [p. 211] L'école tire, d'autre part, un certain revenu des articles qu'elle fabrique, ce qui lui permet, avec des dons privés, d'assurer la subsistance des élèves et d'entretenir un petit établissement pour handicapés géré par John Berthod.
On citera aussi le cas d'un jeune ferronnier d'art genevois, Silvio Cavuscens, parti en Amazonie, poussé par le goût de l'aventure et le désir de mieux connaître les Indiens, qui est resté douze ans sur place, vivant et travaillant avec les Indiens. Pendant trois ans, il a fait sur le tas son apprentissage d'ethnologue, s'approchant peu à peu des tribus, se familiarisant avec leur langue et accumulant les observations. Très rapidement, il fut ému par les conditions précaires dans lesquelles elles vivent et les risques qu'elles courent face à la politique intégrationniste du gouvernement, à l'exploitation sauvage de la forêt amazonienne et à l'indifférence à laquelle elles se heurtent de tous côtés. Après quelques tentatives de collaboration avec les organismes brésiliens d'aide aux Indiens, Cavuscens prend contact, en 1982, avec Terre des Hommes Suisse, élabore un projet d'appui à la survie de douze peuples indiens, la campagne Javari, qui est acceptée par la FGC et en cours de réalisation. Cavuscens est rentré en Suisse pour écrire un livre sur ce qu'il a vu et vécu et préparer des films destinés à aider les Indiens à prendre en mains leur destin. Il lutte pour la reconnaissance juridique des Indiens et se prépare à retourner prochainement en Amazonie. Son épouse, brésilienne d'origine, l'assiste dans sa lutte pour les droits des Indiens d'Amazonie. [p. 212: image / p. 213]
Un dernier exemple d'engagement créatif est un travail d'équipe du groupe de Carouge de la Déclaration de Berne, qui a eu l'idée de créer un jeu, le Tiers-Mondopoly, jeu de famille destiné à familiariser les jeunes, dès 12 ans, avec les grands défis du sous-développement et de l'aide au Tiers Monde. Il fait partie du matériel pédagogique des écoles genevoises et se répand, en différentes langues, dans toutes les parties du monde.
Un bilan positif
L'effort de Genève est modeste, comparé aux immenses besoins des pays en développement, mais le Canton est le deuxième, derrière Zoug, par l'importance de ses contributions, comparées au budget cantonal brut; de plus, parmi les 26 communes suisses qui ont effectué, en 1987, les versements les plus élevés, on trouve 8 communes genevoises (Genève-Ville, Lancy, Vernier, Carouge, Meyrin, Versoix, Bernex et Cologny, commune qui vient en tête de toutes les communes suisses pour le montant de sa contribution par habitant). Ces efforts témoignent d'une volonté d'ouverture; ils se concentrent sur des projets modestes aux structures légères et efficaces, dont on peut suivre les résultats et qui apportent des solutions concrètes à des problèmes de formation et de développement à la mesure des moyens mis en oeuvre. C'est aussi un exemple remarquable de collaboration entre l'Etat et des associations privées qui font largement appel au bénévolat.
J. de S.
haut
[p. 214]
Urbanisme et architecture des organisations internationales
[p. 219]
Genève, ville internationale
Lorsque le président Wilson convoqua la première assemblée de la Société des Nations, le 15 novembre 1920, il était encore aisé de trouver des locaux à Genève. L'assemblée eut lieu dans la salle de la Réformation et les délégués furent logés dans les hôtels alentour.
En juillet 1920, le Bureau international du travail loue la propriété de Georges Thudichum, futur hôtel Carlton, qui deviendra, en 1946, le siège du Comité international de la Croix-Rouge. En septembre 1920, la Société des Nations acquiert l'hôtel National, construit par Jaques-Elisée Goss en 1872-1875, pour y installer son secrétariat général. Grâce notamment au Bureau cantonal du plan d'extension créé par Camille Martin en 1919, Genève met tout en oeuvre pour remplir sa nouvelle fonction de centre international. Un champ d'aviation est installé à Cointrin, relié par une ligne régulière avec Paris, et la gare Cornavin est modernisée. La société Marconi offre une station de télégraphie sans fil. Les hôtels des Bergues, Métropole, de Russie, Richemond sont adaptés aux nouvelles exigences et l'on transforme le siège de la société Piccard, Pictet & Cie, à la rue du Mont-Blanc, en hôtel des Délégations.
Mais la Société des Nations se plaint de manquer de place et menace régulièrement de quitter Genève. Malgré l'opposition d'une partie de l'opinion, les autorités genevoises multiplient leurs efforts. En 1923, l'Etat et la Ville achètent la propriété Armleder, au sud de l'hôtel National (aujourd'hui Palais Wilson) et la cèdent à la Société des Nations pour y construire une salle de conférences. Cependant, très vite, la superficie s'avère insuffisante et l'on s'oriente d'abord vers une solution dans le parc de Château-Banquet, puis vers les terrains du bord du lac à Sécheron. Avec l'appui du Canton et de la Confédération, la Société des Nations fait l'acquisition des propriétés Moynier et Bartholoni, tandis que l'Etat [p. 220: image / p. 221] s'assure, après expropriation, recours au Tribunal fédéral et transaction, la Perle du Lac. De son côté, la Confédération achète la propriété Bloch et en fait don à la Société des Nations qui, à son tour, la cède au Bureau international du travail, lequel s'y installe en 1926. Un concours est ouvert la même année à tous les architectes de pays membres de la Société des Nations. Trois cent trente-sept projets sont présentés, mais finalement la solution de Sécheron est abandonnée au profit du parc de l'Ariana, légué en 1890 à la Ville de Genève par Gustave Revilliod: le charme des rivages du lac le cède au site grandiose face au Mont-Blanc; un droit de superficie est concédé à titre perpétuel à la Société des Nations le 20 septembre 1928 et la Ville reprend la disposition des terrains achetés par la Société des Nations au bord du lac. Aujourd'hui, la villa Plantamour abrite l'Institut Henri-Dunant, la villa Moynier l'Institut universitaire d'études européennes, la villa Bartholoni le Musée d'histoire des sciences, et la villa Lammermoor, dans le parc Barton, l'Institut universitaire de hautes études internationales.
L'acropole mondiale sur la rive droite
De nombreux projets internationaux virent le jour sur la rive droite du lac. En 1919, le Conseil d'Etat avait pris des options sur de vastes terrains entre le Creux-de-Genthod et Versoix. En 1924, l'architecte Jean-Jacques Dériaz proposait son projet d'une Société des Nations au Petit-Saconnex, daté de 1920, à Paul Otlet, fondateur de l'Union des Associations internationales à Bruxelles (une des grandes concurrentes de Genève). Après avoir envisagé le domaine Bartholoni, puis le coteau de Pregny, Paul Otlet publie en 1928 un projet de Mundaneum dressé par Le Corbusier et Pierre Jeanneret, puis en 1929 une Cité mondiale. [p. 222]
Le chantier de la Société des Nations, à l'Ariana, traînant en longueur, il fallut construire de toute urgence, en 1931-1932, une annexe au palais Wilson pour accueillir la Conférence du désarmement. Ce bâtiment d'avant-garde (Adolphe Guyonnet, architecte et Louis Perrin, ingénieur) fut détruit par un incendie en 1988.
La liaison avec Genève
L'aménagement des routes d'accès est à la charge du Canton. Dès 1928, les projets se multiplient, la plupart respectant le tracé historique des grands axes routiers. Aucun ne débouche sur un plan cohérent: plan d'aménagement de Paul Lachenal et Albert Pictet, au nom du groupe Pour une Grande Genève; concours pour la restructuration des quartiers de la rive droite par la section romande de la Fédération des Architectes Suisses; concours d'idées de la Ville en 1929. Pour décharger les quais, on envisage de créer une grande avenue reliant directement le palais de la Société des Nations à la gare (projet Albert Bodmer, Adolf Kellermüller, Hans Hofmann, repris par le Département des travaux publics en 1930 avec Jean Boissonnas, en 1935 avec Maurice Braillard).
L'idée est abandonnée en 1934, avec le concours d'idées pour la place des Nations lancé par le Service d'urbanisme cantonal; les lauréats, Arnold Hoechel et Jean-Marie Ellenberger, prévoyaient une avenue tangentielle, la future avenue Giuseppe-Motta. Cette même année voit la création de l'avenue de la Paix et l'exécution de l'avenue de France, liée à un déplacement de la ligne de chemin de fer. En 1936, un concours d'idées porte sur la place Albert-Thomas. En 1939, pour répondre à la crise du logement, les autorités approuvent le plan d'aménagement des campagnes Beaulieu et Vermont réalisé par le Service d'urbanisme, dirigé par Albert Bodmer. [p. 223] Les projets se poursuivent en dépit de la guerre et de la disparition de la Société des Nations: vaste plan d'aménagement entre la Servette et la place des Nations; agrandissement de l'aéroport et construction de l'aérogare à Cointrin; après l'installation de l'ONU en 1946, un plan d'ensemble réserve le quartier de Vermont au logement et aux espaces verts en 1948.
En 1956, un concours international pour la place des Nations est remporté par le Français André Gutton. En 1958, un autre concours porte sur une Maison des congrès au Grand-Morillon, à l'emplacement de l'actuel BIT. En 1965, la Confédération et l'Etat de Genève créent la Fondation des immeubles pour les organisations internationales (FIPOI), qui a pour but de mettre à la disposition d'organisations intergouvernementales — exceptionnellement non gouvernementales —, sans but lucratif, divers immeubles dans la région du Palais des Nations. La FIPOI peut construire des immeubles, en devenir propriétaire, les gérer ou en faciliter la construction de toute autre manière. Elle ne poursuit aucun but lucratif. C'est elle qui, en 1973, construit le Centre international de conférences de Genève (CICG) qu'elle met gratuitement à la disposition des organisations intergouvernementales.
Nouvelles études
Un projet aurait pu mettre fin à cette succession d'improvisations au coup par coup. En 1971-1972, il fut envisagé de doter le secteur international d'un statut juridique et administratif spécial, sous la forme d'une Zone d'urbanisme à destination des activités internationales (ZADAI), centrée autour du CICR et protégeant cette réserve naturelle. Mais de nouveau, le plan élaboré par le bureau Saugey-Richter, sur mandat du Département des travaux publics, resta sans suite.
Les parcelles occupées par les organisations et délégations internationales sur les communes de Pregny et du Grand-Saconnex, dans les années soixante, sont densifiées à outrance et de manière désordonnée, dans les années soixante-dix, par des constructions hybrides, pour répondre au besoin toujours croissant d'espace.
La nécessité de reprendre l'examen du site entraîne, en 1983-1984, de nouvelles études sur l'aménagement des abords de la place des Nations, mandatées par le service immobilier de la Ville de Genève et réalisées par l'atelier d'architecture et d'urbanisme A. et M. Baud-Bovy. Ces études témoignent de l'absence persistante de toute composition urbanistique et du manque de caractère représentatif de la place des Nations.
Pour trouver une solution à ces problèmes, la zone en question fait actuellement l'objet de projets de gestion urbanistique, à l'étude au Département des travaux publics.
[p. 224]
Une architecture entre exigences fonctionnelles et caractère représentatif
Face aux incertitudes de la planification territoriale de la rive droite, les bâtiments s'imposent aujourd'hui comme des données fixes et immuables du paysage genevois. Pourtant, en aval de la construction de ces grands immeubles de bureaux et salles de congrès, s'est discutée une page intéressante de l'histoire de l'architecture du XXe siècle. Souvent appliquée, la mise au concours de ces édifices a permis à maints ténors de se confronter, en terre genevoise, sur le thème de la conception moderne du grand immeuble de bureaux, tant dans sa fonctionnalité que dans sa convenance représentative.
Parmi la quarantaine de bâtiments construits et les plus de sept cents projets consacrés à la recherche d'un type de bâtiment spécifique, certaines contributions offrent des solutions particulières.
Bureau international du Travail
Le bâtiment du BIT, au bord du lac, est la première proposition concrète sur ce thème. Face aux soixante-neuf projets présentés au concours national de 1923, celui de Georges Epitaux s'impose par sa réévaluation du caractère traditionnel et représentatif du palais à cour: sous l'influence de l'hygiénisme moderne, les distributions sont rationalisées et la conception de la façade permet d'adapter la dimension des bureaux au respect de la hiérarchie des fonctions.
[p. 225: image / p. 226]
Société des Nations
Le concours international, lancé en 1926, pour l'édification du Palais de la Société des Nations suscite un débat plus fougueux. La querelle entre projets "académiques" et projets "modernes" repose sur la difficulté qu'a l'architecture moderne de s'imposer comme un "style" représentatif — notamment par ses emprunts au vocabulaire industriel —. Toutefois entre les modernes le débat est tout aussi vif: deux réponses distinctes à la retranscription moderne de la représentativité s'affrontent. Pour Le Corbusier, la "conception paysagère" dispose les volumes dans le parc et permet au schéma traditionnel du Palais de se fragmenter en éléments à la fonctionnalité autonome et rationnelle. Pour H. Meyer et H. Wittwer, leur projet d'un bâtiment à deux tours et une salle recouverte d'un voile de béton émane de la seule "objectivité" de l'analyse du programme. Deux manières de penser la modernité qui consacrent deux archétypes du bâtiment de bureaux: la barre et la tour. Ces deux conceptions trouvent leur aboutissement, après la guerre de 1939-45, pour l'ONU à New York où Le Corbusier élève le secrétariat aux dimensions d'un prisme rectangulaire vertical devenu, comme le suggère Mumford, le symbole de la bureaucratie de fonction de l'ONU.
A Genève, c'est finalement de 1927 à 1937 que Nénot et Flegenheimer, Broggi, Lefèvre et Vago construisent la Société des Nations à l'Ariana. Par l'expression d'un certain classicisme abstrait et la disposition des volumes, ce palais à consonances traditionnelles traversé de systèmes de circulation indépendants, parfois, de sa forme, est un des exemples les plus vifs d'une architecture représentative typique de l'avant-guerre.
Place des Nations
Après-guerre, une certaine modernité internationale s'impose à Genève. La qualité du projet lauréat de A. Gutton, au concours de 1956 pour la place des Nations, réside dans sa retranscription du "caractère monumental" souhaité par le programme: c'est le vide entre les volumes solitaires (deux tours et trois barres) qui en est le thème. De cette idée directrice, seuls certains bâtiments seront construits (UIT et AELE).
Organisation mondiale de la Santé
Jean Tschumi, qui reçoit la même année le prix Reynolds pour le bâtiment qu'il vient d'achever pour Nestlé, à Vevey, est vainqueur du concours international lancé en 1960. Son projet combine rationalité et représentativité de trois manières: la construction sur pilotis fait "entrer" le paysage dans les aires d'accueil du bâtiment, le porte-à-faux autorise une grande flexibilité dans la position des [p. 227] cloisons de bureaux aux étages et enfin, la façade suspendue, constituée de subdivisions d'aluminium à facettes réfléchissantes, trouve une manière particulière d'orner le pan de verre d'un brise soleil. Tschumi oppose son classicisme moderne à une plasticité qui parfois exalte les éléments fonctionnels ou l'élément symbolique, comme dans le projet de Saarinen. L'éducation Beaux-Arts de Tschumi porte, ici, moins sur le "geste" dans le site que sur l'élément lui-même: c'est l'objet miroitant et le porte-à-faux qui répondent à la convenance du bâtiment, le site n'est là que pur objet de contemplation.
Bureau international du Travail
Suivent des procédures d'attribution de grands mandats (nouveau BIT au Grand Morillon et agrandissement du Palais des Nations), moins prolifiques en débat architectural. Pourtant, il s'agit là de bâtiments qui par leur seul volume, 555.000 et 440.000 mètres cubes, propulsent, comme la Société des Nations quarante ans auparavant, le bâtiment de bureaux à l'échelle de Versailles. Beaudouin, à qui le titre de président de l'Association mondiale des architectes — l'UIA — vaut la réputation d'excellence suffisante pour ses mandataires, se voit attribuer les deux mandats. Au BIT, il est associé à P.L. Nervi (architecte du Palazzo del Lavoro pour Italia 1961) et à A. Camenzind (architecte responsable de l'Exposition nationale de 1964). Que reste-t-il du rapport fonctionnalité-représentativité? Un étrange rapport entre deux types d'exploits: une technologie qui permet à 1.250 cellules de bureaux de reposer sur des pilotis de plus de neuf mètres de haut, et un formalisme abstrait constitué par la bi-concavité du bâtiment. Ici s'impose la plasticité d'un volume dont l'échelle gigantesque et imposante devient le seul signe tangible du caractère représentatif recherché.
Aujourd'hui, force est de reconnaître que l'intérêt du "cas Genève" concernant l'image représentative et rationnelle d'une portion de territoire consacrée aux destinées du monde ne réside pas toujours dans les solutions construites. A quelques réalisations près, les débats en coulisse sur l'urbanisme et l'architecture restés sur le papier en constitueraient le seul véritable patrimoine.
C. C. et I. L.
haut
[p. 228: image / p. 229]