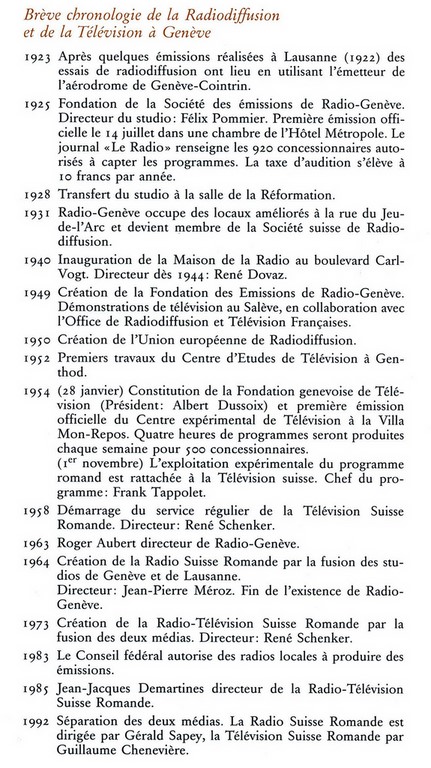La fête et les arts de la scène
Nicole Chevallier / Norbert Creutz / Aristide Frascarolo / Daniel Jeannet
Pierre Michot / Jean-Pierre Pastori / Jean de Senarclens
Avec la collaboration de Anne Cuénod-Deuber
[p. 12: image / p. 13]
La fête, creuset de tous les arts
La fête... Ce mot évoque la joie, le plaisir partagé, les échanges de cadeaux, les réjouissances entre amis. Il évoque aussi la solennité d'un événement, d'une commémoration. La fête est enfin, et c'est pourquoi elle figure en tête de ce volume, le creuset des différents arts, qu'il s'agisse des arts de la scène, de la musique ou même de la littérature. Il n'est pas jusqu'aux arts plastiques qui n'aient subi l'influence de certaines fêtes.
Avant la Réforme
Au Moyen Age, Genève a connu, comme toutes les villes impériales et princières, des fêtes solennelles célébrées à l'occasion de la prise de possession d'un évêque, de l'entrée solennelle d'un prince de la maison de Savoie, parfois même d'un empereur ou d'un pape, d'un mariage ou d'une naissance chez les ducs de Savoie; à l'occasion aussi de la signature d'un traité. Cortège, liesse populaire, banquet, parfois bal, c'était l'occasion d'offrir à la population — à ses frais! — quelque distraction. Voici comment François Bonivard, prieur du couvent de Saint-Victor, raconte la prise de possession, coûteuse, de son siège épiscopal par l'évêque François de Savoie:
"C'était par un dimanche, 25e de juillet 1484, après disné, que fut faicte ceste entrée honorable et magnifique à François de Savoye, Archevesque d'Auch, qui venait prendre possession de l'Evesché de Genève. Quant il marcha sur le pont d'Arve, il trouva sus icelluy diverses bestes sauvaiges et des chiens qui les chassoyent, et au bout du pont, sus un charriot cinq tours. Au millieu, en avait une d'une lance de hault, et au sommet d'icelle avait un tonneau enflammé de feu, lequel charriot marchait toujours devant luy jusques en Palaix. Et d'aultre cousté, avait de fort belles hystoires et riches, que commençarent depuis le pont d'Arve jusques en sa maison devant Rive, montant par la rue Verdaine tirant au Bourg-de-Four, et despuis le Bourg-de-Four tirant vers la Maison de Ville, tirant jusques en la grande porte de St.-Pierre et cela était tout historié. Et quant il fust devant la dicte église, il trouva les Chanoines qui le receurent, tous revestus de chappes de drap d'or et de soye, avec croix et reliques, comme en tels cas appartient; et quant beaucoup de frais furent faicts pour ceste venue, il en fallut aussi faire pour le duc Charles, son nepveu, à qui l'on fist aussy la sienne."
La fête se répète, en effet, à l'entrée du duc Charles Ier, pour laquelle, dit Bonivard, "fust faicte une galée [galère] belle et grosse, toute chargée de gentilles femmes". [p. 14]
Le cortège marquait des arrêts, à Plainpalais, à la Corraterie, à Notre-Dame-du-Pont (Bel-Air), au Molard, à Longemalle, etc., pour entendre des "histoires", c'est-à-dire des couplets composés pour la circonstance par la Confrérie des Orfèvres et des Doreurs, qui vantaient les éminentes qualités du récipiendaire.
Ces fêtes solennelles étaient aussi l'occasion de représenter des mystères, des farces ou des "soties", sortes de comédies où l'on exprimait, sous le masque de l'allégorie ou de la folie, des opinions qui frisaient la satire politique. Ainsi, à l'occasion de la signature du traité de combourgeoisie avec Berne et Fribourg, en 1526, le peuple de Genève est symbolisé par quatre poussins qui cherchent refuge sous l'aile d'une poule, leur mère, protégée par les alliés, Berne, Fribourg et l'Union helvétique, contre trois éperviers, tous trois savoyards, le duc, l'évêque et le vidomne.
Mais ces fêtes solennelles avaient aussi une autre fonction, de caractère fiscal celle-là: les cadeaux qu'il était de coutume de faire au prince à l'occasion de sa visite étaient parfois fort lourds et obligeaient le Conseil à imposer une contribution à la population; et la répétition de ces "cadeaux" finissait par entraîner la perception d'un impôt régulier.
La Réforme
La Réforme a été une rupture, non seulement en matière religieuse, mais aussi dans les moeurs.
Le 22 février 1539, deux ans et demi après la décision du Conseil général de "vivre en cette sainte loi évangélique et parole de Dieu" et quelques mois après la destitution de Calvin — il ne reviendra à Genève qu'en septembre 1541 —une "crie" proscrit la danse, sauf aux noces, de même que les chansons "deshonnêtes", les déguisements, les masques et les "manières" (simagrées). Ces interdictions sont répétées à plusieurs reprises, en particulier dans la campagne genevoise, où la "danse au virollet" est sévèrement proscrite. De plus, le Conseil général décide le 16 novembre 1550 d'abroger toutes les fêtes, soit les jours fériés qui ponctuaient le calendrier, ne laissant subsister que le dimanche.
Il faut se replacer à l'époque où ces dispositions ont été prises. Genève est pratiquement en état de siège depuis l'avènement au trône de Savoie du duc Charles III, en 1504, jusqu'au démantèlement de son duché par les Bernois et le roi de France en 1536-1537. Puis, après la menace savoyarde, c'est contre les visées de Berne que Genève doit défendre son indépendance. Il a fallu au Conseil, au Consistoire, à la [p. 15: image / p. 16] Compagnie des pasteurs une énergie farouche pour imposer la discipline indispensable en dépit de la résistance des libertins.
Qu'est-il resté de cette austère sagesse une fois le danger passé? Genève a ses fêtes, qui diffèrent souvent de celles des autres cantons, mais qui ne leur cèdent ni en éclat ni en gaîté. Deux d'entre elles surtout sont spécifiques à Genève: les Promotions et l'Escalade.
Les Promotions
C'est Calvin qui a institué les Promotions, en même temps qu'il fixait l'organisation des études dans l'"Ordre du Collège", le 5 juin 1559. Les différents degrés de l'enseignement étant représentés par des classes, il fallait une cérémonie pour promouvoir les élèves d'une classe à l'autre et récompenser les meilleurs, comme c'était déjà le cas à Lausanne: elles avaient lieu le 1er mai (le 2 si le 1er était un dimanche) au temple de Saint-Pierre. Les deux meilleurs élèves de chaque classe recevaient "quelque petite estreine... Et en la prenant, qu'ils remercient Messieurs avec révérence". Le Collège avait congé ce jour-là.
Les élèves et leurs maîtres se formaient en cortège dans la cour du Collège, défilaient devant les syndics, les conseillers et les membres de la Compagnie des pasteurs postés devant l'Hôtel de Ville et se rendaient à la cathédrale où ils entendaient prières et discours en latin avant d'assister à la distribution des prix. La cérémonie durait environ quatre heures, ce qui est beaucoup pour des jeunes gens: ils manifestaient leur impatience, si bien qu'au fil des années le nombre et la durée des discours se réduisirent sensiblement.
Cette "Fête du Collège" était d'autant plus importante que toutes les fêtes antérieures à la Réforme avaient été abrogées. Elle prit donc l'allure d'une véritable solennité nationale à caractère civique, à laquelle étaient invités les hôtes étrangers de passage que l'on désirait honorer. Après la cérémonie, les régents et professeurs étaient invités à un banquet et les élèves à des "goûters de prix" chez les parents des lauréats... s'ils en avaient les moyens.
Voici comment s'exprime Philippe Monnier dans Le livre de Blaise: "Touchante pensée [...] que celle d'un peuple qui choisit pour sa fête, la fête de l'enfance. Et noble pensée que celle d'un peuple qui prétend célébrer cette réjouissance dans la maison de Dieu par les joies de l'esprit."
Qu'en est-il aujourd'hui? La séparation de l'Eglise et de l'Etat, en 1907, et la laïcisation de l'instruction publique qui [p. 17] en est résultée a eu pour effet le déplacement de la cérémonie de la cathédrale au Victoria Hall. De plus, à partir de 1969-1970, les différents collèges et écoles de l'enseignement secondaire sont mixtes et les élèves sont trop nombreux pour trouver place dans un local unique: dès lors, les promotions se déroulent dans chaque établissement et ne réunissent que les élèves des classes terminales. Il ne s'agit donc plus, pour les élèves de l'enseignement secondaire, que d'une distribution de diplômes et des prix offerts par des privés, sans la solennité instituée par Calvin.
Mais les Promotions ont conservé toute leur valeur dans l'enseignement primaire. Les élèves des classes enfantines de la Ville, groupés par classes, défilent du boulevard Jaques-Dalcroze aux Bastions, en passant par les rues Basses et la Corraterie, en un joyeux cortège où la couleur le dispute à la gaîté. La récompense les attend en fin de parcours: des jeux, des carrousels et un goûter sont là pour les distraire et les restaurer. Quant aux classes primaires, elles se réunissent dans les différents parcs de la ville, où tout est prévu pour la récréation des élèves. Des fêtes analogues, pleines de charme et de bonne humeur, sont organisées dans la plupart des communes. A la cérémonie docte et solennelle des réformateurs ont succédé de véritables fêtes de la jeunesse. A la suite d'une initiative du Groupement des Associations de parents d'élèves, la loi du 10 mai 1981 prévoit la remise d'un souvenir d'égale valeur à tous les élèves qui franchissent une étape importante de leur scolarité. [p. 18]
Les Promotions civiques, c'est-à-dire l'accession des jeunes gens et jeunes filles à la majorité civique, célébrées depuis 1942, font l'objet, en ville et dans la majorité des communes, d'une cérémonie et de la remise d'un souvenir.
L'Escalade
Fête patriotique par excellence, l'Escalade est à la fois célébration de la victoire des Genevois sur le duc de Savoie dans la nuit du 11 au 12 décembre 1602, action de grâces pour la "miraculeuse délivrance" et commémoration des dix-sept défenseurs morts au champ d'honneur. C'est surtout la fête des Genevois; elle leur tient à coeur par tout ce qu'elle représente d'évocation historique et de réjouissances populaires et gastronomiques. Elle remplace le carnaval tel qu'il est célébré dans d'autres cantons et revêt plus d'importance que les autres fêtes du calendrier civil.
Grâce à la constante vigilance de la Compagnie de 1602, qui a succédé en 1926 à l'Association patriotique genevoise pour la rénovation de l'Escalade fondée en 1898, le rituel de la fête est chaque année dûment respecté: comme l'écrit Henri Naef: "A la lueur des torches (car il faut la nuit tombante), tambours battant, fifres sifflant, trompes sonnant et bannières au vent, cavaliers, fantassins attelés aux couleuvrines ou l'arquebuse à l'épaule, gravissent la colline de l'antique enceinte, font halte sur les places où le héraut d'armes lit sa proclamation et, dans la cour Saint-Pierre, face à la cathédrale, jetant au brasier les flambeaux, entonnent à l'unisson l'hymne des ancêtres." De leur côté, les étudiants de la Société de Zofingue suspendent une couronne devant le monument aux morts de l'Escalade, à Saint-Gervais, avant leur traditionnel banquet.
L'Escalade n'a pas toujours été commémorée de la même façon: le 21 décembre 1602, on se réunit dans les trois temples de la ville pour rendre grâce à Dieu, cérémonie reprise les deux années suivantes. Dès 1605, la commémoration religieuse se double de réjouissances profanes. La Compagnie des pasteurs ne voit pas cette fête d'un bon oeil, pour des raisons théologiques, tandis que le Conseil l'interdit dans les périodes de tension pour ne pas déplaire au voisin sourcilleux.
Aujourd'hui les enfants, déguisés en Savoyards, en Pierrots et Colombines ou en marquis, envahissent les rues de la Vieille Ville et se rendent à des bals costumés. Mais chaque année, un arrêté du Conseil d'Etat interdit le port de masques, de travestis et de costumes sur la voie publique aux [p. 19: image / p. 20] personnes âgées de quinze ans et plus. Il interdit également le port d'uniformes militaires, de costumes ecclésiastiques et de masques représentant des hommes d'Etat suisses ou étrangers, et toute manifestation susceptible de porter atteinte aux convictions religieuses d'une partie de la population: la liesse est tolérée, mais dans certaines limites.
Mais pour la plupart des Genevois, l'Escalade, ce sont les marmites de nougat ou de chocolat — hommage au courage et à la présence d'esprit de la mère Royaume — qui envahissent les vitrines des confiseurs dès la mi-novembre et que l'on brise en prononçant la formule consacrée: "Ainsi périssent les ennemis de la République!"
Autres fêtes historiques
D'autres fêtes commémorent des événements de l'histoire genevoise et suisse. Depuis le 11 mai 1900, date de sa fondation, la Société de la Restauration et du 1er juin veille à la commémoration de ces deux événements. [p. 21]
Le 1er juin est désigné dans l'Annuaire officiel comme la fête genevoise. En fait, elle n'est célébrée que depuis 1901, pour commémorer le débarquement des Suisses au Port Noir le 1er juin 1814. En fait, malgré les drapeaux suisses et genevois qui flottent sur les tours de Saint-Pierre et devant les bâtiments officiels, malgré aussi le cortège, la pose d'une couronne devant le monument du Port Noir et les discours qui l'accompagnent, cet anniversaire passe presque inaperçu de la plupart des Genevois pour qui l'Escalade est la seule vraie fête patriotique. Le jubilé aurait dû être célébré en 1864, mais des troubles politiques l'ont fait repousser de cinq ans; à cette occasion a été inauguré le Monument national au Jardin anglais. Quant au centième anniversaire, il a donné lieu, en 1914, à des manifestations grandioses: déjà le 1er juin a été fêté avec panache, mais les Fêtes du centenaire proprement dites ont eu lieu du 4 au 6 juillet. Le premier jour quatre bateaux à vapeur ont emmené les notabilités genevoises à Nyon pour y accueillir le Conseil fédéral in corpore; des contingents fribourgeois, soleurois, bernois, lucernois et bâlois en uniformes d'époque ont embarqué, à Versoix, dans trois barques du Léman qui les ont déposés au Port Noir. Un cortège historique a défilé dans une ville décorée de fond en comble. Le lendemain était consacré à des cérémonies religieuses, à des banquets de quartiers et à une fête de nuit, et le troisième jour à une fête de la jeunesse et à un tir cantonal. Mais le clou de ces manifestations fut sans contredit la Fête de juin, grand jeu scénique comportant 1.500 figurants et acteurs dans le parc Mon-Repos, où un théâtre en plein air avait été installé. Le livret était dû à Albert Malche et Daniel Baud-Bovy, la musique et la chorégraphie à Emile Jaques-Dalcroze. Ce fut un triomphe. Le cent-cinquantième anniversaire, en 1964, a été ainsi l'occasion d'une fête mémorable. Le cortège officiel, qui s'est transporté à l'Exposition nationale à Lausanne, a vivement impressionné les Confédérés.
La Restauration commémore la libération de Genève, le 31 décembre 1813, après quinze ans d'occupation française. La veille au soir, une personnalité prononce un discours sur la Treille, au cours d'une cérémonie organisée par la Société militaire; les autorités y sont représentées et les Vieux-Grenadiers confèrent à la cérémonie la solennité voulue. Le matin du 31 décembre, le canon tonne sur la Treille et à Saint-Antoine, après quoi les Genevois transis se restaurent de croissants et de vin chaud.
Le Jeûne genevois: Genève a décrété son premier jeûne connu en 1567, à l'annonce de la répression exercée contre les protestants de Lyon; un jeûne est ordonné ensuite, à la [p. 22: image / p. 23] demande de la Compagnie des pasteurs, lorsqu'un événement grave le justifie; ce fut le cas notamment après le massacre de la Saint-Barthélemy, le 23 août 1572, mais il n'en est pas résulté un jeûne annuel comme on le croit communément. C'est à partir de 1640 que le jeûne a été observé régulièrement à Genève. Aujourd'hui, le deuxième jeudi de septembre est jour férié officiel en vertu de la loi du 1er février 1966. Quant au Jeûne fédéral, fixé au troisième dimanche de septembre, il remonte à 1831, mais il a existé, de 1640 à 1793, un "jeûne helvétique" des cantons protestants auquel Genève s'associait. Il n'est pas mieux observé que le jeûne genevois; ce sont prétextes à randonnées et à ripailles (la fameuse tarte aux pruneaux) plus qu'à génuflexions.
La Fête nationale suisse est fixée au 1er août depuis 1891. Les feux brillent sur les sommets entourant Genève, le Jura et le Salève. En ville de Genève, comme dans les communes genevoises, on se réunit autour d'un feu et l'on écoute un discours de circonstance, après quoi commencent les réjouissances, qui varient d'une commune à l'autre. A la campagne, on fait généralement appel aux pompiers pour organiser les festivités: cortège aux flambeaux, collation, bal champêtre. Le sept-centième anniversaire de la Confédération, en 1991, devait être célébré dans les différents cantons. A Genève, il a donné lieu à des manifestations variées, mais n'a pas soulevé l'enthousiasme des foules.
Les fêtes dans la campagne genevoise
Une enquête faite à la fin de l'automne 1993 dans les communes genevoises permet de dresser avec une précision suffisante la carte des fêtes célébrées dans la campagne. Elle confirme le changement radical intervenu dans la population du Canton au cours du XXe siècle et surtout depuis la Deuxième Guerre mondiale: la main d'oeuvre agricole ne représente plus que 1,2 pour cent de la population active; elle est composée d'entrepreneurs et non de paysans. De plus, les villages sont peuplés en majorité de citadins et non plus d'agriculteurs. Dès lors, les fêtes traditionnelles, qui tiraient tout leur sens d'un fonds paysan et de traditions terriennes, sont devenues, au mieux, des manifestations folkloriques entretenues par la Fédération cantonale du costume genevois qui groupe, depuis 1933, les différentes sociétés folkloriques du Canton. A l'occasion de son soixantième anniversaire, cette fédération a monté, grâce au dévouement de nombreux bénévoles, un spectacle historique "Au pied du mur", qu'elle a présenté durant l'hiver 1993-1994 dans [p. 24]
différentes communes du Canton. Il s'agissait d'un jeu scénique en sept tableaux évoquant l'histoire de Genève à l'époque de l'Escalade.
Les anciennes chroniques mentionnent diverses coutumes de la campagne genevoise, qui sont souvent des survivances de rites païens: les failles et les alouilles, le feuillu, la reine de mai, sans parler des feux de la mi-été qui ne sont pas propres à Genève.
Au mois de mars, le dimanche des brandons (premier dimanche de carême) était encore fêté à Aire-la-Ville jusqu'en 1939 sous le nom de failles et d'alouilles. Les enfants du village se rendaient l'après-midi devant la maison des couples mariés l'année précédente et encore sans enfants au cris de "Aux Alouilles, aux Alouilles", chantaient une ritournelle annonçant la naissance d'un garçon et recevaient des bonbons, des caramels, des noix et des sous. Le soir, on allumait les failles (du latin facula), feux de joie symbolisant la fin de l'hiver, que l'on fêtait joyeusement.
Le premier dimanche de mai, c'est la fête du feuillu que l'on célèbre encore dans la commune de Satigny, à Choully et dans celle de Plan-les-Ouates, à Saconnex d'Arve, La Chapelle et Arare, alors qu'on y a renoncé à Avully en 1975, à Bernex en 1988 et au début du siècle à Cartigny et dans quelques autres communes du Canton. C'est Jaques-Dalcroze qui, dans Le jeu du feuillu, a donné à cette vieille coutume un regain de jeunesse en chantant "le joli mois de mai". Elle a donné son nom à un groupe de danses folkloriques de Plan-les-Ouates et à un crû de vin blanc. Le matin a lieu le nettoyage des fontaines, souvenir symbolique du culte des eaux fécondes. Puis on promène dans le village, en quêtant des oeufs, du beurre et des friandises, la "Bête". En voici la description par J.-B.G. Galiffe, né en 1818: "Le Foillu, tel que nous l'avons vu dans notre jeunesse, consistait en une sorte de pavillon conique formé de branches vertes entrelacées et garni de fleurs et de rubans; un homme muni d'une sonnette, caché à l'intérieur, portait aisément cette cage fleurie qu'on croyait marcher toute seule." (Voir l'illustration dans le tome II de cette Encyclopédie, page 31). De leur côté, les filles élisaient la Reine de mai qui, en robe blanche, une couronne de lierre sur la tête, se joignait au cortège et récoltait dans son panier les cadeaux qu'on lui lançait. Le Consistoire s'est élevé contre cette coutume en 1614, mais il a fallu l'exode rural pour qu'il disparaisse, sauf de rares exceptions.
La vogue est célébrée surtout dans les communes à tradition catholique, généralement le dimanche le plus proche de la fête patronale, et s'est étendue à d'autres communes après [p. 25] la Restauration. Elle a cessé d'être célébrée à Russin en 1990, mais une "Petite vogue des Baillets" a lieu dans ce hameau depuis 1989. Elle donne lieu, à Bardonnex à une course de brouettes, à Soral à la "Fête des roses", à Jussy à une fête foraine et à une course-tiercé aux cochons et à Veyrier à une fête de tir; à Carouge, elle coïncide avec le tir au canon, à Anières on la nomme "Anières en fête", à Lancy "Lancy en fête", à Presinge "Fête de l'automne", à Troinex "Festival de la Grand'Cour", à Onex "Carnaval", à Vernier "Vogue du renouveau", à Versoix "Fête du Bourg".
D'autres fêtes sont célébrées dans certaines communes. La plus connue est sans doute la Fête des vendanges de Russin. Vandœuvres a aussi la sienne, plus modeste, et Jussy y a renoncé en 1983. Une Fête de l'artisanat a lieu toutes les années à Onex et Perly-Certoux, tous les deux ans à Bernex, Collonge-Bellerive, Plan-les-Ouates et Puplinge, tous les quatre ans à Anières et Troinex. Le Vieil Onex accueille tous les deux ans la "Fête au village", tandis que le Festival de country music d'Onex a lieu selon le même rythme aux Evaux. Avully organise une Fête villageoise, Bernex une "Rencontre du jeûne fédéral", Presinge une Fête d'automne, Chêne-Bougeries une fête communale et un Automne musical.
[p. 26]
Quelques grands moments dans l'histoire des fêtes genevoises
En proclamant son indépendance, à la veille de la Réforme, la Communauté des citoyens s'est coupée de son arrière-pays savoyard en même temps qu'elle abandonnait son statut de principauté épiscopale. Plus d'entrées solennelles des ducs de Savoie, plus de prises de possession de l'évêché; l'humeur, on l'a vu, n'est d'ailleurs pas à la fête. Mais il est des événements que l'on se doit de fêter: c'est le cas du traité de combourgeoisie conclu avec Berne en janvier 1558. Michel Roset écrit dans ses Chroniques de Genève: "En ces jours, donc, on démenoit joye à Genève pleine de grande espérance du fruict de cet accord. Les ungs faisoient des cantiques, les autres des dictons à la célébration d'iceluy. On ordonna de planter arbre comme tilz (tilleuls), ormes, noyers &c. autour de la ville par le dedans les murailles pour plus grand ornement & décoration d'icelle." Toutefois, il faut attendre le XVIIIe siècle, la prospérité, l'apaisement des luttes contre la Savoie et le relâchement de la discipline de la Réforme pour trouver des fêtes dignes des fastes anciens.
Dans son Journal, édité en 1994 par Olivier Fatio, Jacques Flournoy, pasteur à Jussy, raconte dans tous ses détails la fête donnée, le 24 juin 1680, au nouveau résident de France, que "la Seigneurie voulut régaler sur le lac". Une galère à 20 rames, au pavillon bleu, dans laquelle prend place le Résident, est suivie d'une grande galère au pavillon blanc, portant une compagnie de 50 jeunes hommes d'élite et d'une petite frégate portant les vivres. On lève l'ancre au bruit du canon, se livre à une partie de chasse et de pêche et se rend au Château-Roset où la table est mise pour le banquet: 5 services, tous en vaisselle d'argent, libations rythmées par les santés que l'on boit au Roi, à la Reine, au Dauphin et à la Dauphine avec accompagnement des batteries de canons, à terre et sur les frégates. L'après-midi, une bataille navale oppose la suite du Résident à "une frégate armée de gens habillés à la turque": échange de coups de fusil et de canon, abordage, reddition, le tout pour le plus grand amusement des spectateurs et des acteurs. "Le résident parut fort satisfait de ce régal; il dit à ces Mrs qu'il ne se pouvait rien de mieux imaginé ni de mieux exécuté, et il asseura qu'il en feroit le détail au Roy."
En mai 1725, à l'occasion du mariage de Louis XV avec Marie Leszczynska, le Résident de France donna une grande fête dans la plus pure tradition des fêtes de notre royal voisin, telles qu'elles sont décrites dans la Grande Encyclopédie de Diderot et d'Alembert. Un dîner eut lieu dans la salle [p. 27] des festins de l'Hôtel de Ville, au cours duquel on porta onze "santé", pour lesquelles il y eut 790 volées de canon. Deux "fontaines de vin" avaient été installées à la résidence, qui coulèrent de midi à 8 heures du soir. Un bal réunit 500 personnes, de 10 heures du soir à 6 heures du matin, dans la salle des Deux-Cents. La ville était entièrement illuminée, la population manifesta sa joie et le Résident s'en réjouit tout en remarquant que "c'était une peine pour lui de donner de semblables fêtes" (lettre d'Antoine Arlaud à son frère Jacques-Antoine, du 26 septembre 1725).
Il a été fait mention, dans le tome IX de cette Encyclopédie, des fêtes de tir qui remontent au Moyen Age et revêtent parfois des dimensions considérables. Ainsi, le 4 juillet 1772, Mylord Charles Stanhope, vicomte de Mahon, donne une grande fête à l'occasion de son élection au titre de commandeur du Noble exercice de l'Arc.
Les fêtes fédérales de gymnastique sont bien plus que de simples événements sportifs puisqu'elles s'appuient sur une longue tradition et se déroulent dans une atmosphère de liesse populaire. Il en est de même, dans une moindre mesure, de la Fête fédérale des costumes qui a eu lieu à Genève pour la dernière fois en juin 1986.
Quant aux Fêtes de la Navigation, elles ont eu lieu à partir de 1677 et jusqu'à la fusion de l'Exercice de la Navigation [p. 28] avec l'Exercice de l'Arquebuse, en 1856. Le déroulement en est presque toujours identique: à titre d'exemple, le jeudi 24 août 1775, après qu'un tir eut servi à désigner le Roi deux semaines plus tôt, le canon tonne à 6 heures du matin; les compagnies, au nombre de 48 canonniers, 64 matelots et 20 "indienneurs", se rendent à la Maison de Ville où elles défilent. Le Roi embarque, accompagné de 60 chevaliers et d'une vingtaine de seigneurs allemands et anglais invités à la fête. La flottille se livre à divers exercices avant le dîner qui a lieu à l'hôtel de la Navigation aux Pâquis, où les Reines ont rejoint leurs époux. On se met à table à 1 heure et demie et ne s'embarque qu'à 6 heures. Un grand bal a lieu dans la salle des festins de 9 heures du soir à 4 heures du matin.
Les Fêtes de Rousseau, le 28 juin 1793 et le 28 juin 1794, furent avant tout des manifestations révolutionnaires. La première fut bon enfant: un cortège, des choeurs d'enfants devant la maison de Chevelu, des réjouissances aux Bastions. La seconde fut plus théâtrale: devant une statue géante du philosophe érigée aux Bastions, des discours enflammés préludèrent au Comité révolutionnaire constitué trois semaines plus tard.
L'Exposition nationale de 1896 fut en elle-même une grande fête où chaque canton, chaque profession fit des prodiges d'imagination et d'esprit créatif. Mais le point fort de cette manifestation fut sans conteste le Poème alpestre d'Emile Jaques-Dalcroze, créateur d'un genre nouveau, la fête populaire et patriotique en chansons, qui s'exprime à nouveau en 1914 à la Fête de juin, en 1923 à Carouge à la Fête de la jeunesse et de la joie et en 1937 à la Perle du Lac à Genève chante.
En 1912, les fêtes du Deuxième centenaire de Jean-Jacques Rousseau sont un événement considérable. Il s'agit d'abord de réhabiliter la figure de Rousseau, à qui l'on a fait la réputation d'un dangereux révolutionnaire. (On se souvient des polémiques auxquelles a donné lieu l'érection de son monument par Pradier, en 1835). Le 29 juin, sous une pluie battante, des discours célèbrent la figure du citoyen de Genève sur son île, devant sa statue, avant une immense ripaille: dans tous les quartiers des tables sont dressées sur les places, dans les rues et la population fait bombance. Et puis, au parc de l'Ariana, un théâtre de verdure accueille Le Devin du Village, suivi de Pygmalion. Jean-Jacques Rousseau le révolutionnaire, le réprouvé, est enfin célébré sans arrière-pensées par ses concitoyens en une fête qui, selon l'expression de Jean Starobinski, puisse être "une communion des citoyens dans une grande cérémonie". [p. 29]
Les IVe Fêtes du Rhône ont eu lieu à Genève, en 1929. René-Louis Piachaud a composé trois poèmes, une Évocation du Fleuve Rhône, Le Chant vers la colline et L'Offrande au Rhône sur des musiques de Frank Martin, de Samuel Baud-Bovy et de Louis Piantoni, avec des jeux rythmiques d'Emile Jaques-Dalcroze.
A Genève, les fêtes sont avant tout des commémorations: anniversaires de la Réforme en 1735, en 1835 et plus tard, au XXe siècle, célébrés dans la ferveur et la dignité; sixième et septième centenaires de la Confédération, en 1891 et 1991, manifestations patriotiques sans grand éclat; rattachement de Genève à la Confédération, qui a donné lieu en 1869, en 1914, en 1964 et en 1989 à des fêtes populaires hautes en couleurs; bimillénaire de Genève en 1942, prétexte à cortège historique, exposition, spectacles; commémorations de l'Escalade, de la fondation du Collège de Genève, des Communes Réunies, de la naissance de Jean-Jacques Rousseau et de celle du Général Dufour, de la fondation de la Croix-Rouge. Ces jubilés sont généralement célébrés par des cortèges historiques, des publications et des spectacles, au mieux par des banquets ou des pique-niques. Mais ils sont aussi l'occasion de créations artistiques. Ainsi, en 1909, le trois-centième anniversaire du Collège et de l'Académie coïncida avec la pose de la première pierre du Monument de la Réformation; d'autres fêtes ont été illustrées par la frappe d'une médaille et nombreuses ont été les oeuvres littéraires et musicales créées à l'occasion de telles commémorations.
La fête au secours des Eglises
Mais les fêtes qui ont le plus marqué à Genève au cours des dernières années, ce sont les kermesses organisées pour la restauration de la cathédrale Saint-Pierre, de la basilique Notre-Dame et du temple de Saint-Gervais. Après les "Chantiers de l'Eglise", qui ont eu lieu tous les cinq ans de 1955 à 1970 et qui ont été sabordés par des prêtres et des pasteurs de la mouvance "mai 68", trois kermesses "Les clefs de Saint-Pierre" ont animé pendant trois jours la Vieille Ville en 1976, en 1982 et en 1989. Fruits d'un engagement de toute la population, religions et nationalités confondues, en faveur d'une oeuvre chère à tous les Genevois, ces kermesses ont bénéficié d'une collaboration enthousiaste de toutes les communes et de différentes communautés étrangères. Ce furent de vraies fêtes, sans excès, mais sans retenue, qui ont vu défiler, consommer et s'amuser toute la population du Canton. En septembre 1980, une grande kermesse a eu lieu au Palais [p. 30: image / p. 31] des expositions en faveur de la restauration de la basilique Notre-Dame et en juin 1992, c'était le tour du temple de Saint-Gervais de réunir le peuple de Genève sur les bords du Rhône et dans le Faubourg à l'enseigne des "Ponts de Saint-Gervais". 600.000 personnes auraient participé à cette joyeuse fête.
Ces manifestations ont eu des précédents: en 1926, un grand bazar avait pour objet le financement d'une Ecole en plein air permanente du Sanatorium populaire genevois de Montana; en 1937, la Section genevoise de Zofingue organisait la Kermesse du Coin de Terre; en 1960, une grande kermesse était organisée à l'occasion de l'Année internationale des réfugiés, mais les Clefs de Saint-Pierre ont réussi, pour la première fois, à transformer tout un quartier de la ville en scène festive, évoquant ainsi l'atmosphère d'une ville de foires au Moyen Age.
Quant aux Fêtes de Genève, organisées depuis 1947 dans un but essentiellement touristique, elles comprenaient traditionnellement un corso fleuri et un feu d'artifice, deux spectacles de qualité. De nouvelles formules sont appliquées depuis le début des années quatre-vingt-dix, les quais sont couverts de boutiques qui attirent la foule des badauds et les Fêtes restent un des grands attraits de la Genève touristique.
Le Festival du Bois de la Bâtie, qui a eu lieu pour la première fois en 1977, succcédant au 1er Festival libre du Bout-du-Monde, fut une vraie fête populaire de la jeunesse. En 1984, il s'installa en ville et perdit de ce fait une part de sa spontanéité. Depuis 1992, il se nomme La Bâtie, Festival de Genève et présente d'excellents spectacles, mais sans la participation active de la jeunesse. Il faut aller au Paléo Festival de Nyon pour trouver cette ambiance de "big show" propre aux grands festivals de cette fin de XXe siècle, avec ses excès et ses coups de coeur.
Les Genevois savent-ils "faire la fête"?
La fête — quelle fête? — est-elle compatible avec la fameuse austérité calviniste? Les Genevois sont réputés pour leur sérieux, leur raideur, on les trouve volontiers ennuyeux; savent-ils aussi "faire la fête"? Dans la mesure où la fête est une transgression de certains interdits à la manière des saturnales de l'antiquité ou des foules en délire du Festival de Rio, un "excès permis" selon la formule de Freud, Genève n'est certainement pas à la hauteur. Mais la fête peut aussi être une manifestation culturelle où les différents arts, y compris les arts de la table, se [p. 32] conjuguent pour la joie des participants. A ce titre, Genève ne fait pas exception, mais la fête y prend une expression particulière: pas de défoulement collectif comme au carnaval de Bâle, rarement un grand jeu scénique comparable à la Fête des Vignerons de Vevey, mais pas de morosité non plus: ni les enseignements de la Réforme ni la rudesse du climat les jours de bise n'empêchent les Genevois de manifester leur joie dans les fêtes décrites dans ce chapitre. Il est vrai cependant que le Genevois est volontiers introspectif et qu'à la fête populaire, il préfère généralement les spectacles artistiques et les débats politiques ou philosophiques.
J. de S.
haut
[p. 33]
Le théâtre
"A l'entracte — on jouait je ne sais quelle pièce imitée de l'Allemand — le narrateur rencontre un vieil amateur de théâtre de sa connaissance. «Vous paraissez préoccupé, lui dis-je, en le voyant les yeux fixés sur la barrière de l'orchestre, le pommeau de sa canne contre la bouche et dans l'attitude d'un romantique qui cherche une idée: — Vous l'avez deviné. Je faisais dans ce moment une singulière remarque: c'est qu'il y a précisément soixante-cinq ans aujourd'hui que je fus à la comédie pour la première fois. —Je ne croyais pas que la comédie existât depuis si longtemps à Genève. — Non, sans doute, mais vous êtes comme la plupart de nos concitoyens, vous ne connaissez point l'histoire de votre pays; elle vaudrait cependant la peine d'être apprise; et je puis vous assurer que l'article du théâtre n'en serait pas le chapitre le moins piquant. Il me prend fantaisie de vous le faire connaître. Allons au café.» J'acceptai: nous entrâmes chez Papon. Et l'amateur octogénaire prit la parole."
C'est ainsi que Jean-François Chaponnière met en scène la causerie sur le théâtre à Genève qu'il publiera en 7 articles dans le Journal de Genève (du 2 février au 16 mars 1826). Il fait partie du Caveau genevois, joyeuse réunion de poètes et de chansonniers qui cherchent à égayer l'époque très austère du mouvement religieux appelé le Réveil.
C'est ce petit groupe d'amis — Chaponnière, Salomon Cougnard, Gaudy-Lefort, Petit-Senn — qui fonde le Journal de Genève cette même année 1826. L'on doit aussi à Chaponnière la chanson qui a fait le tour du monde et que chantait Gavroche sur les barricades:
«... S'il est du mal sur la terre, C'est la faute à Voltaire...»
[p. 34: image / p. 35]
Dans Genève et ses poètes, Marc-Monnier dit de Chaponnière qu'il "avait de l'à-propos, du naturel, des refrains heureux... Il ne manquait à chacune de ses petites pièces qu'une demi-heure de travail". Malgré son mérite d'avoir été le premier en date, son essai sur le théâtre à Genève est devenu lacunaire et mieux vaut s'appuyer sur les Histoires littéraires postérieures et plus développées de Philippe Godet et Virgile Rossel, sur Marc-Monnier, sans oublier Les Chroniques de Bonivard, ennemi du duc de Savoie qui l'emprisonnera au Château de Chillon: toutes sources auxquelles nous puisons pour l'essentiel nos informations sur la vie théâtrale genevoise jusqu'au XIXe siècle.
Pédagogues avant d'être artistes
L'"amateur octogénaire" conversant avec Chaponnière passe comme chat sur braise sur notre théâtre au Moyen Age. C'est qu'on ne trouve pas trace chez nous de littérature dramatique avant le XVIe siècle. Rossel vérifie qu'en Helvétie romane, la chevalerie n'a pas suscité, comme en France et en Allemagne, des poètes et des conteurs. Isolés des cours du Midi et de la cour de France, nos ancêtres — paysans, artisans ou négociants — sont coupés de tout centre artistique. C'est le mouvement de la Réforme qui nous apportera la vie de l'esprit et le goût de l'instruction. Mais la Réforme n'aime pas le théâtre. Nous voilà bien obligés de nous faire une raison imposée par l'histoire: nous sommes pédagogues avant d'être artistes.
Comme au Moyen Age français, mais tardivement, Genève s'offre des spectacles religieux et des spectacles comiques, des "mystères", des "farces" ou des "soties". On peut aussi assimiler au théâtre ces "entrées solennelles" qu'étaient les grandes fêtes données en l'honneur d'un visiteur de marque. Un exemple, parmi les rares qui nous soient parvenus.
Nous sommes le 4 août 1523. Genève accueille Béatrice de Portugal, femme du duc de Savoie. On honore la duchesse avec des pantomimes à grand spectacle. Un cortège somptueux serpente à travers la cité, ponctué de stations où harangues et compliments sont adressés à la visiteuse. Puis celle-ci est conviée, place du Bourg-de-Four, à assister à la représentation d'un mystère: Sainte Hélène et son fils, l'empereur Constantin. C'est un spectacle qui se déploie parmi six échafauds, lieux scéniques éclatés comparables à des maisons vues en coupe entre lesquelles le public se déplace, au fil de l'action. Echafaud 1: Sainte-Hélène prie et un ange lui suggère d'exhorter son fils à partir en croisade. Echafaud 2: [p. 36] Bataille sans paroles: Constantin tue le roi de Perse. Echafaud 3: Retour de l'empereur victorieux auprès de sa mère. Echafaud 4: A Jérusalem, Constantin demande aux Juifs où est la vraie croix. Echafaud 5: Miracle: parmi trois croix, l'on reconnaît la vraie qui ressuscite un mort. Echafaud 6: L'empereur et sa mère sont en adoration devant la vraie croix qui est blanche, on l'aura compris, comme la croix de Savoie réapparaissant à l'écusson d'une fontaine qui déverse du vin pour toute la population.
La petite histoire relève que la duchesse, qui était enceinte et à laquelle on avait épargné le tir du canon, réserva au spectacle un accueil très frais qui froissa ses hôtes. Un badaud, cité par Bonivard, exprime avec malice ce qui pourrait bien être l'avis du chroniqueur lui-même: "Vous feriez mieux d'employer la dépense que vous faites pour honorer le Duc et sa femme, à fortifier votre ville pour les en faire demeurer dehors, afin qu'ils ne vous brûlent de votre bois."
Les Genevois ont des raisons d'être révoltés. Leurs franchises sont menacées par deux ennemis: le duc de Savoie, qui se mêle de rendre justice dans la ville, et l'évêque, nommé par le pape, qui a aussi des ambitions sur le pouvoir temporel. Les partisans de la liberté lorgnent du côté des Confédérés. L'un d'eux, Philibert Berthelier, est décapité sur ordre de l'évêque. Deux spectacles, les Soties de la Mère Folie, témoignent de la dureté de l'époque (selon le mode allégorique et critique du peuple des "sots", acteurs costumés en bouffons).
1523, place du Molard: Mère Folie est en deuil, car Bontemps (le bon temps) est mort. Mais le Printemps (messager vêtu de vert) dément cette rumeur: Bontemps, qui vous laissa "y a quatre ans" (date de l'exécution de Berthelier) n'est pas mort; il reviendra quand Genève à nouveau s'appartiendra.
Mais en 1524, dans la deuxième "sotie", Bontemps n'est toujours pas revenu et mère Folie est morte. Ses enfants prennent le Monde à temoin, qui est malade et de mauvaise humeur. Un médecin accourt et diagnostique plusieurs maux, dont ces "bénéfices" ecclésiastiques qui se vendent et s'achètent. "Propos du pays de Luther", rétorque le Monde! Il est vrai que les Genevois, pour chasser leur duc et leur évêque, s'apprêtent à embrasser la Suisse et la Réforme.
Des pasteurs plus calvinistes que Calvin
Avec son va-et-vient d'esprits érudits et brillants, la Réforme apporte un rayonnement culturel sans précédent, mais qui redoute le théâtre: "Que nul n'ait à chanter [p. 37] chansons prophanes et deshonnestes, ni dancer ou faire masques, momons, momeries, ni se desguiser en sorte et manière quelconque, à peine de tenir prison trois jours au pain et à l'eau et de soixante sols." Cette ordonnance du 27 juillet 1609 radicalise encore l'empreinte de la réforme calvinienne.
Au reste, il y a plus calvinistes que Calvin, rappelle Marc-Monnier à propos d'une polémique déclenchée en 1546, avant la représentation d'une moralité, Les Actes des Apôtres. Calvin, qui ne trouve rien à redire au contenu, autorise le spectacle. La Compagnie des pasteurs ne l'entend pas de cette oreille. Cop, le plus fanatique d'entre eux, sermonne en chaire les "effrontés qui voudraient monter sur les planches afin d'agacer la convoitise des yeux". Les acteurs portent plainte, le peuple se fâche contre le "ministre" que l'on arrêtera et la pièce sera finalement jouée sur la place de Rive.
Mais le théâtre et la Réforme — à quelques exceptions près, dont le chef-d'oeuvre de Théodore de Bèze, Abraham sacrifiant, créé à Lausanne en 1550 — sont incompatibles. Trois spectacles de circonstance seront encore joués au XVIe siècle pour resserrer les liens entre Genève et la Suisse réformée: une Comédie du Monde malade et mal pansé de Jacques Bienvenu (1568), où l'on voit un médecin prescrire au Monde "le jus du Concile de Trente"; une Pastorale allégorique de Simon Goulart (1584), où l'on assiste à la réconciliation de trois bergers: Zurchin, Ursin et Gerbin (Zurich, Berne et Genève) et, la même année, trois actes de Joseph Duchesne, L'Ombre de Garnier Stoffacher, Suisse, hymne à la paix qui raconte les débuts de la Confédération, en vers médiocres, mais qui sont les premiers que Guillaume Tell inspire à la langue française. Sauf une pâle Genève délivrée de Samuel Chappuzeau, jouée en 1662 pour commémorer l'Escalade, il n'y aura plus de spectacles publics jusqu'au XVIIIe siècle. Les pasteurs genevois auront eu le dernier mot!
Voltaire et Rousseau: pour ou contre le théâtre à Genève
C'est gâce à Voltaire, qui s'installe aux Délices, que le théâtre reviendra. Grâce aussi aux militaires français appelés à la rescousse plusieurs fois pour pacifier la ville où s'entredéchirent une oligarchie de patriciens, des bourgeois affaiblis et un petit peuple privé de droits, mais qui ploie sous les impôts; à chaque intervention, ils obtiennent un théâtre pour agrémenter leur vie de garnison. Beaucoup de Genevois partagent leur plaisir. [p. 38]
En 1755, Voltaire met le feu aux poudres en lisant Zaïre devant un parterre d'aristocrates genevois. "Nous avons fait pleurer tout le Conseil, écrit-il le lendemain. Jamais les Calvinistes n'ont été si tendres." Son dessein n'est pas d'abord de faire enrager les puritains, mais de faire jouer ses pièces, car il est le premier auteur français du moment. Tous les moyens lui sont bons. Il encercle la ville: obtient du roi de Sardaigne l'autorisation d'installer une troupe permanente à Carouge (1758), loue le château de Tournay à Pregny et y ouvre un théâtre avant d'acquérir finalement ses terres de Ferney et d'y donner la comédie. Il a recours aussi à la pression intellectuelle en invitant d'Alembert aux Délices, sous prétexte de lui faire consulter le Dr Tronchin. En réalité, c'est pour comploter avec le philosophe le fameux article sur Genève qui paraîtra dans l'Encyclopédie, et d'y agiter notamment la question brûlante du théâtre. Pourquoi, écrit d'Alembert, cette ville qui ne désapprouve pas tant le spectacle que le libertinage ne remédierait-elle pas à cette menace en réglementant sévèrement la conduite des artistes? Peu à peu, les comédiens de Genève "serviraient de modèles aux comédiens des autres nations." Vision très voltairienne que cette ville-laboratoire où l'on expérimenterait un théâtre consacré au progrès des moeurs et des arts.
On connaît la célèbre et substantielle réponse de Rousseau: la Lettre à d'Alembert sur les spectacles, écrite à l'arraché, en moins d'un mois. Il est vrai que Jean-Jacques craint que le théâtre n'entraîne une dissolution des moeurs. Mais, par-dessus tout, il déteste le théâtre mondain et parisien, celui que défend Voltaire: un divertissement de classe, comme on dira plus tard, qui ne concerne pas l'ensemble des citoyens. Il ne faut pas bannir le théâtre de la république, conclut-il, mais il faut que la république invente un autre théâtre: des fêtes civiques que le peuple se donne à lui-même. Pour Jean Rousset, l'enjeu du combat de Rousseau, "c'est la patrie, le livre à demi rêvé des nostalgies et des espérances, qui s'érige en un autre symbole, l'anti-Paris. En même temps, le citoyen intervient, en connaissance de cause, dans une lutte très réelle, celle qui oppose à Genève le parti populaire et traditionaliste au parti francisé et cosmopolite qui gouverne la «parvulissime république»; or c'est dans ce patriciat [...] que se recrutent les partisans d'un théâtre stable régulièrement admis dans la ville (Le Lecteur intime)."
Si nous insistons autant sur ce chapitre enseigné au lycée, c'est qu'il oriente déjà les directions dans lesquelles se développera notre théâtre aux XIXe et XXe siècles. Dans la ligne de Voltaire, le spectacle venu de Paris, divertissement ou théâtre d'art, ne va cesser de plaire à une élite provinciale de [p. 39] goût et d'origine variables. Dans la ligne de Rousseau se répandront les fêtes civiques ("Festspiele") et autres drames "nationaux" qui finiront aussi par s'empâter.
Mais nous ne sommes encore qu'en 1782. De nouveaux troubles éclatent à Genève: comme à chaque fois, le résident de France en profite pour demander un théâtre pour la garnison. En 1766, il avait obtenu une salle en bois qui brûlera deux ans plus tard: le Théâtre de Rosimond. Cette fois, le Théâtre de Neuve sera construit en pierre et sur l'emplacement du précédent, aux Bastions. Il durera un siècle, jusqu'à l'édification du Grand-Théâtre. On y jouera la comédie et l'opéra. Directeur désigné: Saint-Gérand, qui avait animé pendant 13 ans le Théâtre de Châtelaine, autre brûlot périphérique cher à Voltaire et dont la coqueluche est le comédien Aufresne, fils d'un horloger genevois. Comme la construction de la salle de Neuve est lente, la saison se déroule provisoirement au Jeu de Paume de Saint-Gervais, là où une troupe étrangère — celle de Gherardi — avait fait un passage éclair entre 1738 et 1739. Le nouveau théâtre de Neuve est inauguré en 1783. Mais ni Voltaire ni Rousseau ne sont plus là pour rire ou pleurer de ce retour définitif du théâtre à Genève.
XIXe siècle: James Fazy entre autres dramaturges
A l'époque où Jean-François Chaponnière, cité en ouverture, est le chroniqueur dramatique compétent du Journal de Genève, celui-ci, qui vient de naître et n'a pas tardé à trouver sa vocation, publie des vers plutôt que des annonces et ouvre le débat sur la querelle des classiques et des romantiques.
Comme la Suisse en général, Genève, entrée dans la Confédération en 1814, bouge. Sous l'impulsion des radicaux, le gouvernement conservateur est renversé (1846). Les sociétés d'étudiants naissent, avec leurs théâtrales d'amateurs. Les Amis de l'Instruction, fondés en 1842, oeuvrent au "développement intellectuel" de la république et intègrent la littérature et bientôt l'art dramatique dans leur programme d'activités. La Montagne et la Patrie deviennent un culte national. Mais Paris grise toujours les Genevois et certains d'entre eux s'y font un nom.
Ainsi Marc-Fournier, poète romantique et auteur, qui deviendra le directeur du Théâtre de la Porte Saint-Martin. Et Marc-Monnier, ce critique et historien auquel le présent article a souvent recours, qui est aussi un auteur heureux, dont certaines pièces sont jouées à l'Odéon et au Vaudeville. [p. 40] Mais c'est dans son Théâtre de Marionnettes qu'il excelle comme satiriste politique, visant à "démasquer les grands hommes et à vider les grandes pensées", note Philippe Godet.
Dans le registre "national" et patriotique, qui a donc la cote, signalons comme curiosité La Mort de Lévrier (partisan genevois, comme Philibert Berthelier, au début du XVIe siècle): tragédie que prendra le temps de signer James Fazy, le tribun radical, plus attaché à la souveraineté du peuple qu'au prestige de l'écriture. Rappelons aussi la renommée étroitement locale de Jules Mulhauser, ancien précepteur des cadets de la marine à Saint-Pétersbourg, que le mal du pays ramènera à Genève, un livre sur le coeur: Exil et Patrie. Il y gagnera sa vie comme enseignant et journaliste, écrira un poème national, Sempach, deux drames en prose (Philibert Berthelier et L'Escalade) et signera à deux reprises le livret de la Fête des Vignerons de Vevey (1851 et 1865).
Töpffer: l'universalité de la saveur locale
Mais notre préféré, au XIXe siècle, dont nul n'ignore plus les récits de voyage, les albums dessinés, les nouvelles et les romans, c'est Rodolphe Tôpffer, brave homme et père de famille modèle, qui sait faire rire son monde avec un style qui a "de la fleur", dit joliment Sainte-Beuve. On connaît moins les pièces que ce maître de pension a écrites pour son délassement et celui de ses amis et élèves, avec lesquels il les interprète à l'occasion d'un anniversaire ou d'un baptême familial. Elles datent d'entre 1829 et 1832 et annoncent déjà Labiche avec leur "cocasse défilé de domestiques un peu sots, mais hauts en couleurs, médecins des bains, Anglais colériques, syndics de commune, barbiers, bourgeois engoncés dans leur redingote et leurs préjugés, vieux militaires, garçons d'auberge hilares, jeunes filles sages et volontiers rougissantes, voire même quelques pachas et quelques bédoins". (Introduction de Jacques Buenzod au Théâtre de Tôpffer.)
Tout, ici, est abandonné gracieusement à "l'exquis du genre et à la joie de l'amateur". Il est là, le secret de Tôpffer: s'il a réussi à plaire à la France, relève Godet, n'est-ce pas précisément parce qu'il est demeuré lui-même, Suisse et Genevois, et qu'il s'est contenté, selon son expression, de "boire dans son verre"? Oui, mais avec quel talent et sans oublier de trinquer à la santé du monde! Le destin surprenant de cet homme et de son oeuvre n'est-il pas une leçon toujours actuelle?
[p. 41]
Appia et Jaques-Dalcroze: la rythmique dans l'espace théâtral
Rien ne prédisposait Genève, dont le théâtre est l'enfant tardif (et problématique), à donner le jour à deux rénovateurs parmi les plus importants de l'art scénique au XXe siècle. Adolphe Appia, scénographe, metteur en scène et théoricien du théâtre, est né en 1862, à Genève. Après des études musicales et des stages de théâtre à Paris, en Allemagne et à Vienne, il se passionne pour l'oeuvre de Richard Wagner et en 1888, comme il le dit dans son curriculum vitae, il "prend la résolution de réformer la mise en scène". Non seulement il condamne l'ornementation surchargée du décor illusionniste, mais il s'en prend à la fonction même du théâtre de l'époque, qui est de faire croire au spectateur qu'il est comme dans la vie. "Donner l'illusion de la réalité est la négation de l'art", dit -il. Et il assigne une nouvelle fonction au théâtre et à la mise en scène qui sont "l'art de projeter dans l'espace ce que le dramaturge n'a pu projeter que dans le temps". La musique (ou le verbe, ajoutons-nous), qui passe par le corps de l'acteur, détermine ses gestes et ses mouvements, lesquels créent l'espace scénique. L'acteur est donc le pivot du théâtre et, à partir de lui, Appia définit cette hiérarchie des éléments qui fondent la représentation: acteur — espace — lumière. Voilà où en sont ses recherches, en 1906, quand il découvre la gymnastique rythmique d'Emile Jaques-Dalcroze. Ma méthode, dit Jaques-Dalcroze, consiste à "soumettre l'organisme humain à l'emprise des rythmes musicaux, lui apprendre à vibrer à l'unisson des vibrations sonores; c'est rendre la liberté à des impulsions depuis longtemps entravées par les défauts de l'instruction à travers les âges, d'une instruction constamment restrictive des instincts primitifs et naturels."
Appia et Jaques-Dalcroze partagent une même conscience de la valeur expressive. Ils participent, par là même, à ce profond mouvement de libération du corps qui fait surface, depuis la fin du XIXe siècle, et qui se traduit notamment par la renaissance des Jeux Olympiques (1896), par une redécouverte de la vie au grand air, et, dans le domaine des arts, par une nouvelle approche de la plastique corporelle que l'on peut observer chez Rodin, Hodler, ou chez une danseuse comme Loïe Füller, qui évolue sur scène pieds nus. Commence une fructueuse collaboration entre les deux hommes. Ainsi naîtra, entre 1909 et 1910, cette série de dessins appelés Espaces rythmiques où Appia structure l'espace par une combinaison de lignes verticales et horizontales et [p. 42] où il propose aux rythmiciennes et rythmiciens toutes sortes d'obstacles — praticables, plans inclinés et escaliers — qui doivent leur donner de nouvelles impulsions et constituer pour eux des tremplins.
La "Fête de Juin" (1914): rendez-vous manqué du festspiel et de l'avant-garde
On imagine l'allure de La Fête de Juin de 1914, si elle avait été confiée au tandem Appia et Jaques-Dalcroze. Pour commémorer le centenaire de l'entrée de Genève dans la Confédération et raconter l'histoire de la cité, les autorités n'ont pourtant pas lésiné. Un théâtre provisoire en bois de 5.700 places est construit au bord de l'eau, à la Perle du Lac; la scène est bâtie sur pilotis; à la fin du spectacle, le rideau de fond s'ouvre sur le lac, par où arrive la barque des Confédérés qui ont délivré Genève de la tutelle française; la barque accoste à même la scène. Le dispositif ne manque pas de sobre grandeur: l'absence de rideau et de fosse et l'unique gradin réservé aux spectateurs sont tout à fait dans la ligne d'Appia. Jaques-Dalcroze a composé la musique et Firmin Gémier, pionnier du théâtre populaire en France, signe la mise en scène. Les rythmiciennes transcrivent avec invention la partition dans l'espace. Mais le livret, poème officiel d'Albert Malche et Daniel Baud-Bovy, est aussi conventionnel que le travail scrupuleusement figuratif d'Aloys Hugonnet, le décorateur. [p. 43]
Cette occasion rêvée de subvertir le Festspiel au contact d'Appia et Jaques-Dalcroze ne se représentera plus: rendez-vous unique et manqué du théâtre populaire suisse avec l'avant-garde scénique du XXe siècle. Jaques-Dalcroze poursuivra une carrière de plus en plus officielle, alors qu'Appia, malgré quelques réalisations inabouties et controversées (l'une à la Scala de Milan, à l'invitation de Toscanini, en 1923, et l'autre à Bâle, en 1924) demeurera surtout un génial théoricien, dont l'influence est aujourd'hui incontestée au théâtre comme à l'opéra. En revanche, nous avions peut-être oublié que Jaques-Dalcroze, étouffé par son image de chantre d'une patrie suisse surannée, avait influencé un Copeau, lequel introduira la rythmique à l'école du Vieux-Colombier; et par là même qu'il a marqué toute l'école française de théâtre, celle de Lecoq et de Decroux, c'est-à-dire celle qui a servi de base de travail et de réflexion à la nouvelle école du Piccolo Teatro de Milan, créée par Giorgio Strehler au début des années 1950. Pour attester ce que le théâtre doit à la rythmique, quel meilleur certificat?
Création du Théâtre de la Comédie (1913): premier théâtre dramatique à Genève
L'ironie du sort veut que l'austère Genève doive au commerce du vin sa première scène entièrement consacrée au théâtre parlé. C'est le théâtre de la Comédie, créé en 1913, au boulevard des Philosophes, par Ernest Fournier, qui a investi dans la construction 60.000 francs hérités de son père, d'origine savoyarde, cafetier et négociant à la rue de la Croix-d'Or. Gérée par une société auxiliaire au sein de laquelle il détient la majorité des actions, Fournier travaille sans subvention pendant une vingtaine d'années. Ancien élève de Féraudy, acteur du Français, il monte des modernes et des classiques dans l'esprit de son maître, et avec une passion d'autant plus méritoire que les conditions de production du temps ne sont pas celles d'aujourd'hui. Dans La Suisse du 18 mars 1920, Eugène Fabre se demande "si le public rend assez justice à l'effort des pensionnaires de notre Comédie: il leur faut sans cesse interpréter de nouveaux rôles, alors que leurs camarades parisiens mènent jusqu'à la centième des rôles longuement préparés". Et il ajoute, le 28 novembre 1925: "Ici, trois oeuvres sont à la fois à l'étude et, chaque semaine ou presque, c'est pour chacun un rôle nouveau. Et si vous saviez dans quel amical esprit tout cela s'accomplit!" Bref, avec une pièce par semaine et en prime un classique par mois, sans oublier les saisons d'été dans les villes d'eau où [p. 44] certains d'entre eux arrondissent leurs revenus (pour les premiers rôles, 1.200 francs par mois): les 25 comédiens de la troupe, français pour la plupart, n'ont pas l'impression de voler un salaire somme toute convenable.
Autre son de cloche, qui compte: celui de Copeau, auquel Fournier a donné carte blanche pendant un mois et qui est distribué, en 1916, dans le rôle-titre de Guillaume le Fou de Fernand Chavannes, mis en scène par l'auteur avec des décors de René Auberjonois. Le patron du Vieux-Colombier en exil est plus que déçu par les pensionnaires de la Comédie. Il l'écrira dans ses Registres.
Ce n'est donc pas sur la scène des Philosophes, malgré les bons certificats de la critique genevoise, que l'on peut rencontrer le théâtre d'art des années vingt. Encore moins au Casino-Théâtre, qui mène déjà tambour battant la revue locale et la gaudriole. Ni au Kursaal (futur Grand-Casino) ni à l'Alhambra qui affichent les numéros de cirque et les variétés: Grock, Joséphine Baker et Maurice Chevalier.
La légende des Pitoëff (1915-1922)
Il faut aller plutôt du côté de la rue de Carouge, en plein quartier de l'exil russe à Genève, où l'on a pu croiser le comte Prozor, consul de Lithuanie et premier traducteur d'Ibsen. C'est dans cette "Karoujka" que débute l'aventure de Georges et Ludmilla Pitoëff. Dans le théâtre qui porte aujourd'hui leur nom, et sur un petit plateau qu'ils exploitent tout en hauteur, ils révèlent aux Genevois le nouveau répertoire européen et les intriguent par leur manière singulière de restituer Shakespeare. Entre 1915 et 1922, ils monteront, à Genève, 70 spectacles. Georges lit tout ce qui s'écrit pour la scène, dessine chaque maquette de décor qu'il réalise avec un raffinement de pauvre, qui incite à la stylisation, et il développe avec quelques casseroles toute une science de la lumière et des ombres qui transfigure les tissus bon marché qu'il choisit lui-même. Surtout, il consacre une patience d'ange à modeler amoureusement son actrice fétiche, sa jeune épouse, Ludmilla. Un petit public d'élite a beau suivre passionnément leur travail, les Pitoëff n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Mais un jour, Jacques Hébertot débarque à Genève, voit plusieurs spectacles d'affilée. Il engage toute la troupe à Paris et avec elle un débutant, Béroald, alias Michel Simon, qui avait rejoint Georges et Ludmilla dans des circonstances amusantes: photographe pour gagner son pain, il avait tiré le portrait de la compagnie, insolvable. "Qu'à cela ne tienne, Pitoëff: vous me donnerez un petit [p. 45] rôle dans le prochain spectacle!" Ainsi débutera le "monstre sacré", en 1920, dans la silhouette d'un garde de Mesure pour mesure de Shakespeare, avec une seule phrase: "Il est onze heures, Monseigneur." Mais il émane de ces quelques mots, prononcés avec une bonhomie si cocasse, comme l'invitation irrésistible d'en finir pour aller boire un coup. L'épilogue est connu: Paris consacrera bientôt les Pitoëff et l'impayable Simon dans les Six personnages en quête d'auteur de Pirandello.
Le "temps des passions"
Années trente: le "temps des passions". La politique fait irruption dans le répertoire et les commentaires de la critique. Georges Oltramare, leader de l'extrême-droite genevoise, écrit des pièces dans l'esprit cabotin de son personnage, qui sacrifie tout au panache et à la saillie, par hantise d'être lourd — ou complexe d'être suisse? Il nargue la Société des Nations avec l'une de ses pièces jouée à la Comédie, pendant la Conférence du désarmement: La Foire aux Colombes (1932). Dans La Suisse, Eugène Fabre l'approuve et dénigre le pacifisme, comme il avait mis au pilori le "messianisme juif" à propos du Retour à Jérusalem de Maurice Donnay, joué chez Fournier le 16 octobre 1931. René-Louis Piachaud se compromet aussi dans ses chroniques et dans sa traduction ouvragée du Coriolan de Shakespeare, en 1933, à la Comédie-Française, qui révolte les partisans de la souveraineté populaire et fera tomber l'administrateur de la Maison de Molière, dépassé par les remous.
Ces maurrassiens, il faut le leur concéder, écrivent assez bien et le savent, et c'est sur le point sensible du jargon marxiste qu'ils attaquent obliquement le Théâtre Prolétarien constitué, dès 1932, d'ouvriers et d'employés genevois soutenus par les syndicats et les partis de gauche. Les spectacles politiques du Théâtre Prolétarien s'inspirent du Groupe Octobre et puisent des textes dans la revue Commune qui traduit déjà Brecht. Cette extension genevoise du réseau théâtral des "blouses bleues" de Paris finira par se joindre, à l'invitation de Lucien Tronchet et des syndicats, aux Fêtes de Mai qui se déroulent à l'ancien Bâtiment électoral, sur un plateau immense et dans des décors d'Alexandre Mairet. Les Libertiades de 1939, en particulier, avec près de 200 interprètes, constituent un festspiel de la condition ouvrière, qui englobe les figures emblématiques du peuple genevois: Philibert Berthelier, Jean-Jacques Rousseau et Pierre Fatio.
[p. 46: image / p. 47]
Montero, Oury et Tréjan à la Comédie
Cette expérience des Fêtes de Mai ne se renouvellera pas: le Bâtiment électoral, et pour cause, est réquisitionné par la Croix-Rouge. La guerre, au moins, a toujours eu l'avantage d'attirer en Suisse les artistes qui cherchent un refuge. En 14-18, c'étaient les Pitoëff, sans oublier Jaques-Dalcroze, le Genevois, revenant de Hellerau, près de Dresde, où un mécène entiché de la rythmique lui avait construit, dans une cité-jardin futuriste, un grand centre d'art scénique expérimental. En 39-45, ce sont Germaine Montero et deux débutants, Gérard Oury et Guy Tréjan (double national), notamment, qui renforcent la troupe de la Comédie. Le nouveau directeur en est Maurice Jacquelin, successeur de Fournier, mort en 1937. Jacquelin, réputé pour ses méthodes militaires, monte toujours un spectacle par semaine et, assis à sa table, prépare sa mise en scène comme une partie de dames, manipulant des pions étiquetés qui préfigurent les déplacements des acteurs. Il mène sa barque du mieux qu'il peut, avec une subvention totale (Etat et Ville confondus) de 60.000 francs et un taux moyen de fréquentation de 300 spectateurs par représentation.
Mais il y a beaucoup plus pauvres que les pensionnaires de la Comédie (parmi lesquels se renforce le contingent d'artistes locaux avec Camille Fournier, Germaine Epierre, Isabelle Villars, Adrien Nicati, André Favre, notamment): ce sont les jeunes gens qui aspirent à autre chose que ce théâtre soumis aux modes de Paris, qui copie au mieux l'esthétique du Cartel (Jouvet, Baty, Dullin et Pitoëff) et au pire sacrifie — le plus souvent — aux facilités du "boulevard" qui fait recette, — à preuve que les Galas Karsenty deviendront bientôt les "locomotives" de la Comédie.
Le lit de la rivière
Il est amusant et révélateur d'avoir fixé en 1949 la date à laquelle le théâtre suisse romand invente son existence propre et son identité: quand Charles Apothéloz et la Compagnie des Faux-Nez, Lausannois bouillonnants de trouvailles, mais amateurs, remportent le prix du Figaro de la meilleure mise en scène, en catégorie professionnelle, au Concours parisien des Jeunes Compagnies. Pied de nez digne de Tôpffer: aux innocents les mains pleines, surtout s'ils ont du talent et savent rester eux-mêmes, avec leur accent et leur saveur locale. [p. 48]
A observer le terrain de plus près, à Genève en particulier, les origines d'un théâtre autochtone apparaissent plus progressives et surtout plus complexes. Pure vision de l'esprit que d'imaginer un théâtre enfin produit par les forces vives d'ici et donc, libéré de toute influence extérieure. Nous serions d'ailleurs privés, s'il en était ainsi, de la chance des rencontres et du profit de la circulation des artistes, des formes et des idées. Il n'est que de constater le fécond mélange de nos pionniers, de tous ceux qui, à Genève, et j'en oublie sans doute, ont préparé le lit de la rivière de longue date: Jean-Bard, Jean Hort, Greta Prozor et Alfred Penay, anciens des Pitoëff, qui ont joué, créé des compagnies ou enseigné; Carmen d'Assilva, qui a joué avec Copeau et fondera, dès les années 20, le Studio d'art dramatique qui forme de nouveaux acteurs; Germaine Tournier, comédienne et enseignante, qui créera, en 1937, un théâtre de répertoire contemporain — le Théâtre du Temps — avec Pierre Valde, disciple français de Dullin; Jo Baeriswyl, collaborateur de Jaques-Dalcroze, metteur en scène de festspiele et découvreur d'amateurs de talent, parmi ses "Compagnons de Romandie": ainsi débutent Monique Mani et Jo Excoffier; Georges Firmy, alias Giorgio Strehler, jeune interné de guerre italien qui prend des cours chez Jean-Bard et signe à la Comédie, en 1945, ses deux premiers coups de maître: Meurtre dans la cathédrale d'Eliot (avant Vilar) et Caligula de Camus (en création mondiale); Alfred Roulet, qui a rallié Dullin (près de la mort, abandonné par Paris) au projet avorté d'une maison du théâtre au Casino de Saint-Pierre (Théâtre de la Cour Saint-Pierre, aujourd'hui détruit), en [p. 49] 1948); William Jacques, ancien apprenti du Théâtre Prolétarien qui sera de toutes les aventures tentées depuis 1940: troupe de l'Equipage, avec Daniel Fillion, Compagnie des Cinq, avec François Simon, premier Théâtre de Poche, dès 1948, avec Fabienne Faby, puis Théâtre à l'Usine (1960), utopie qui tourne court faute de moyens et d'adeptes assez nombreux, — sans oublier la carrière de William Jacques, metteur en ondes à cette Radio genevoise qui, depuis 1925, contribue à cimenter la corporation des acteurs en lui donnant du travail et l'occasion de se syndiquer; enfin, Philippe Mentha, Gilbert Divorne et François Simon qui rejoignent, au début des années 50, le Moulin à poivre, cabaret-théâtre où Michel Soutter chante et Bernard Haller rode ses premiers sketches.
François Simon et la création du Théâtre de Carouge
Si Lausanne peut se vanter d'avoir possédé, avec Apothéloz, un animateur imaginatif et politiquement organisé, Genève a la chance d'avoir donné naissance à l'un des plus grand acteurs de son temps, qui a su devenir aussi, par pure intuition, le sourcier de notre vie théâtrale. C'est François Simon. Après des débuts chez Dullin, Barrault et Pitoëff, dans le sillage de son père, il revient à Genève au début de la guerre. "Tu as du génie", lui dit Ludmilla en reprenant avec lui, en Suisse, certains succès des Pitoëff après la mort de Georges, en 1939. Simon, nous l'avons vu, se mêlera à toutes les expériences qui lancent la nouvelle vague d'un théâtre romand. Mais c'est au Théâtre de Carouge, qu'il fonde avec Philippe Mentha, Louis Gaulis et Pierre Barrat, en 1957, que son rêve prend vraiment corps. La troupe s'installe dans une église désaffectée, plus tard démolie, la Salle Mermillod, austère et chaleureuse à la fois, où le spectateur hume un air de fête et de chapelle ardente. Vraie passion du métier, élégance de princes fauchés, intensité des acteurs et goût pour un répertoire (ancien et moderne) de haute volée: voilà l'héritage venu des Pitoëff et que l'ancien Carouge honore. Simon et Mentha montent Shakespeare, Tchékhov, Beckett ou Pirandello et révèlent deux auteurs genevois de talent: Louis Gaulis (Capitaine Karagheuz) et Walter Weideli (dont le public retiendra le subversif Banquier sans visage, qui torpille l'image de Necker, au Grand-Théâtre, dans une mise en scène de Vilar, pour les 150 ans de l'entrée de Genève dans la Confédération). Simon et Mentha, mais aussi Maurice Aufair, Lise Ramu, Michel Cassagne et Georges Wod, entre [p. 50] autres, composent un ensemble de comédiens digne des meilleures troupes françaises du moment. Occasionnellement, le metteur en scène invité se nomme Roger Blin et la tête d'affiche Michel Bouquet, qui reçoit le cachet astronomique (aux yeux du Carouge, dont la subvention est maigre) de 250 francs par représentation!
Simon (qui finira par être reconnu en France, par les spectacles de Patrice Chéreau et le cinéma) aurait pu se contenter de jouer. Il n'avait pas d'autre ambition qu'être acteur: métier qui apporte, disait-il, la "conscience d'être". Il aura pourtant la générosité de transmettre son art et, avec Mentha, d'ouvrir un cours qui révélera François Rochaix, Marcel Robert et Dominique Catton: la meilleure des relèves, celle qui dessinera bientôt un nouveau paysage.
Pour compléter le tableau d'avant 1968, ajoutons Richard Vachoux. Formé par Marcel Raymond (à la faculté des Lettres) et par Greta Prozor (au Conservatoire), il crée, en 1962, le Nouveau Théâtre de Poche, lui-même issu d'un Théâtre Poétique dont le nom indique assez l'orientation vers des textes littéraires et l'avant-garde de l'invention verbale: Audiberti, Ionesco, Obaldia, entre autres. La famille du nouveau Poche réunit notamment Gérard Carrat, Georges Milhaud, Josette Chanel, Corinne Coderey, Monique Mani et Leyla Aubert, équipe dont l'enthousiasme soutenu portera Vachoux, en 1974, à la tête de la Comédie après le départ d'André Talmès, resté fidèle à l'héritage de Jacquelin. Rétif à l'emprise du metteur en scène et aux idées de Brecht qui se sont répandues depuis lors, Vachoux, pressé aussi par une opinion et un public qui commencent à changer, finira par résilier le contrat avec les Galas Karsenty-Herbert et renverser la tendance longtemps dominante de la Comédie. Le théâtre parisien marginalisé, relégué au Casino-théâtre, puis au Grand-Casino: c'est comme le symbole qui marque la fin d'une époque.
1968: un millésime corsé
Hors des modèles français, les Genevois n'ont eu d'autres références que le Théâtre d'art de Stanislavski et le Théâtre Habima de Moscou, accueillis dans les années 20 par la Comédie. Soudain, dans le mouvement général et accéléré des années 60, tout afflue: Brecht, les spectacles de Strehler, le théâtre américain. Artistes et critiques genevois commencent à voyager pour voir d'autres expériences. Qui plus est: ce seront bientôt quelques-uns de nos meilleurs spectacles qui sortiront des frontières. [p. 51]
A Genève, le Théâtre de l'Atelier, fondé par François Rochaix et quelques autres élèves de François Simon, est au centre de ce va-et-vient. Nous devons à Rochaix — Genevois formé au gymnase allemand de Berne — l'ouverture sur le théâtre germanique, en particulier celui de Brecht, auquel ce jeune homme de 22 ans consacre un festival, en 1964, obtenant le déplacement de quatre des plus grands acteurs du Berliner Ensemble à la Maison des Jeunes de Saint-Gervais, là où l'Atelier a pris ses quartiers. Ce qui crée l'événement, autour du Cabaret-Abend de la troupe allemande, c'est le débat tout nouveau que provoquent, à Genève, les idées de Brecht sur le rôle politique du théâtre et de ses moyens esthétiques. Est-ce à ce moment que Rochaix et l'Atelier ont décidé de travailler leur style comme on ajuste son tir? Ils vont s'armer de références, voir les grandes mise en scène de l'époque, explorer un répertoire de choc, s'aguerrir aux techniques de la musique, de la voix et de l'expression du corps, apprendre au spectateur à recevoir des images codées avec intelligence, humour et sensualité. Rochaix signe la mise en scène, Jean-Claude Maret les décors et Guy Bovet la musique. La troupe est composée d'Armen Godel, Dominique Catton, François Germond, Patrick Lapp, Alain Lecoultre, Claire Dominique, Laurence Montandon, Nicole Rouan et bientôt Jacques Denis. Quant aux cibles, elles ne manquent pas. Un mois avant les événements de Mai 68, en voici une: le régime dictatorial et colonialiste de Salazar, que l'Atelier pointe sans pitié avec son Chant du fantoche Lusitanien de Peter Weiss. Et qu'il atteint, au-delà de toute prévision: le Portugal réagit violemment et fait pression sur les autorités genevoises qui lui présentent leurs excuses. La troupe évite alors de justesse une double censure: l'interdiction du spectacle et la coupure des crédits.
Si l'on ajoute à l'affaire du Fantoche le scandale que provoquera la même année, au Palais des Expositions, le Living Theatre avec Paradise Now, on peut dire que 68 est un millésime corsé pour le théâtre genevois. S'il en coûte à Rochaix d'être pour longtemps discrédité auprès de certains magistrats genevois, l'Atelier s'est imposé à la presse et au public, et entre dans le circuit international.
La longue marche du théâtre "indépendant"
Dans les années 1970 à 1980, en même temps que notre théâtre fraîchement subventionné se consolide, de petits groupes marginaux, démunis de tout, lui contestent déjà le monopole des moyens de production. [p. 52]
En mai 1971, l'un de ces groupes, les Tréteaux Libres de Bernard Heymann, est emprisonné pour avoir squatté le temple désaffecté de la Servette et joué — corps nus et cache-sexes maculés de sang — une trilogie de créations collectives, dont Requiem pour Roméo et Juliette, parabole hippie de la sexualité réprimée par la société, dans l'esprit du Living Theatre. Qui plus est, la police a trouvé des drogues douces dans le campement et deux ou trois acteurs sont surpris en train de voler des vivres à l'étalage. Sous les verrous, les Tréteaux Libres entament une grève de la faim et deux compagnies solidaires — le Théâtre O de Michel Barras et le Théâtre Mobile de Marcel Robert — descendent dans la rue et enflamment Genève, clamant leur droit à l'existence et revendiquant un lieu pour les théâtres "marginaux". Ce lieu qu'ils convoitent et n'obtiendront jamais, ce sont les anciennes Halles de l'Ile, qui avaient une âme avant d'être pétrifiées par une restauration radicale, au début des années 80.
1988: les "marginaux" (appelés aujourd'hui les "indépendants") héritent enfin d'un centre de création: ce théâtre du Grütli luxueusement rénové, où — signe des temps qui changent — l'on perçoit moins l'urgent désir d'une alternative théâtrale que le besoin d'intégration d'une corporation rajeunie et désormais pléthorique. Qui, mieux que Marcel Robert (le pionnier devenu directeur du Grütli, entre 1988 et 1990) peut mesurer le décalage entre la passion explosive des années 70 et le projet politique qui en est résulté, près de vingt ans après? Il est heureux que le désir renaisse aujourd'hui dans des lieux poétiques et précaires, comme le Garage ou l'Usine.
Toujours est-il, le temps et l'usure auront eu raison du Théâtre O et des Tréteaux Libres, morts en cours de route. Le Théâtre Mobile? C'est dans le cabaret satirique qu'il trouve tout de suite sa meilleure veine: ainsi ce fameux Western (créé en 1972 dans un bistrot de Carouge) où il met en joue les ténors de la politique genevoise, insolemment incarnés par Marion Chalut, Pierre Bauer, René Donzé, Philippe Nicati, Christian Robert-Charrue, Jean Schlegel et Jean-Charles Simon, entre autres. Puis, au fil des ans, victime d'une série de succès de plus en plus calibrés, le Mobile va mourir à petit feu, une ligne au budget de la Ville, échouant dans l'ornière d'une sécurité modeste et trop chèrement payée, vu son nom: Mobile.
[p. 53: image / p. 54]
Le "Loup" au bord de 1'Arve
Tous ces agitateurs, qui voulaient changer la vie par un théâtre du corps et du cri, par la charge politique ou par l'insolente légèreté du café-théâtre, ils auront au moins servi à aiguillonner les "institutions" confortées — et déjà confortables, pour certaines. Au milieu de ce bouillon de culture, un homme ouvre tous les chantiers: Marcel Robert, improvisateur-né, passionné de Beckett et bientôt, sur les traces d'Artaud, orienté vers une recherche sur le théâtre des origines (celui d'Indonésie, en particulier). Il féconde, dès 1970, presque tout ce qui va naître: le Théâtre Mobile (que reprendront Pierre Bauer, J.-Ch. Simon, René Donzé, puis Philippe Nicati); la Bâtie (festival de la création contemporaine locale et bientôt internationale, dont il étrenne la formule sur un terrain vague, en 1971); enfin ce Théâtre du Grütli dont il acceptera la responsabilité comme l'ultime étape d'une longue marche — et qu'il s'empresse de céder à Bernard Meister, metteur en scène audacieux (du Théâtre de la Ville) et leader ambitieux d'une génération nouvelle très polymorphe.
Les vrais héritiers du théâtre "alternatif", au sens littéral du mot, sont Eric Jeanmonod et le Théâtre du Loup, tribu d'acteurs et de musiciens qui dessinent de beaux spectacles d'images dansantes et bariolées, comme ces jumeaux dont ils se sont séparés: les Montreurs d'images. Ce sont eux — Jeanmonod, Rossella Riccaboni, Sandro Rossetti, François Berthet, etc. — les vrais "indépendants". Ils se sont donné la liberté d'inventer un système et un outil de production sur mesure. Leur nouveau "Théâtre au bord de l'Arve", dont le coût et l'ingéniosité défient la comparaison, répond enfin aux besoins d'un art qui est celui de l'éphémère, de la nécessité vitale du moment: un théâtre selon leur voeu.
André Steiger, "pirate" d'institution
C'est encore d'une autre manière, au milieu des années 70, qu'André Steiger, metteur en scène, dont la dextérité est pourtant prisée par l'institution, tente de faire exister un "autre" théâtre, en marge d'elle. Il est l'animateur auquel fait appel une coopérative d'acteurs, le T-Act, qui réunit notamment Roger Jendly, Michèle Gleizer, Yvette Théraulaz, Séverine Bujard, Jacques Michel et Jacques Denis, sans oublier Michel Beretti et Bernard Bengloan, auteurs, ainsi que Roland Deville, décorateur. Si l'institution ne produit pas nos projets, piratons-la! Ainsi peut-on résumer le plan du T-Act. Steiger a plus d'un tour dans son sac. Ce Genevois, [p. 55] formé par Greta Prozor, a fait carrière chez Vilar et dans la décentralisation française, où il s'est fait le spécialiste de Brecht et d'Adamov. C'est un pédagogue remarquable, qui a formé toute une génération d'acteurs: en France (à l'école de Strasbourg), plus tard en Suisse (à l'école de Lausanne). Il brasse les idées, intègre toutes les disciplines (marxisme, psychanalyse, structuralisme) dans sa réflexion sur le théâtre et ouvre les débats les plus excitants. Au Festival Brecht de 1964, à l'Atelier, c'est déjà lui qui lance le plus gros pavé dans la mare. Or, la dernière trouvaille de Steiger, c'est d'investir son travail et celui du T-Act, puis d'en toucher la plus-value par la vente des spectacles dans le circuit subventionné, voire à la télévision. L'expérience réussit quelquefois, puis elle tourne court, attestant, une fois encore, la difficulté de durer hors de ce théâtre subventionné qu'il est temps de retrouver.
Paysages changeants du théâtre subventionné (1968-1990)
Depuis soixante-huit, plusieurs changements sont intervenus. A la direction du Carouge, pendant la construction du nouveau bâtiment, Mentha succède à Simon et met en scène — à la Comédie et au Théâtre Pitoëff — Frisch, Saunders et Dubillard avec les meilleures distributions du moment: Simon, Aufair, Marcel Imhoff et lui-même. Un régal! Après Mentha, Guillaume Chenevière (passé de l'administration à la mise en scène, avec succès) intensifie la présence à Genève des plus forts spectacles contemporains. En 1972, l'Atelier fusionne avec le Carouge et, dans le nouveau théâtre qu'il dirigera de 1975 à 1981, François Rochaix réalise quelques spectacles magnifiques, parmi lesquels Baal de Brecht (avec Roger Jendly), Le Bourgeois Schippel de Carl Sternheim et Sauvages de Christopher Hampton. Il soutient avec fidélité les auteurs suisses et, particulièrement, la verve multiple et singulière de Michel Viala. Il a le flair, enfin, d'inviter Manfred Karge et Matthias Langhoff, transfuges du Berliner Ensemble et de la Volksbühne de Berlin, à monter Prométhée enchaîné d'Eschyle et de confier à Michel Soutter la mise en scène d'un Ubu Roi mémorable (1976) — chronique feutrée d'un coup d'Etat chez des petits-bourgeois ordinaires — qui ouvre au cinéaste une carrière importante d'homme de théâtre. Depuis 1981, le Carouge est dirigé par un communicateur dynamique et bouillant, Georges Wod, acteur des débuts mythiques à la Salle Mermillod, qui séduit son large public grâce à une publicité émotionnelle et personnalisée, grâce aussi à l'abattage de la troupe et à l'attrait facile d'un répertoire classique, biographique et populaire. [p. 56]
Au Poche, du temps de Gérard Carrat (1974-1984), successeur de Vachoux, le répertoire tangue parmi les textes qui offrent des morceaux de bravoure aux acteurs, car le patron est un lion généreux, qui donnera notamment sa chance, comme l'ont fait Mentha et Rochaix, à un ancien "marginal", auteur et acteur genevois parmi les plus lyriques et les plus percutants: Jacques Probst. Après Carrat, c'est Martine Paschoud qui reprend le flambeau, en 1984: une femme de tête, qui vient de chez Apothéloz à Lausanne et du Carouge/ Atelier de Rochaix; une artiste — metteur en scène exigeante, passionnée par l'écriture contemporaine; une animatrice soucieuse de constituer autour d'elle un cercle d'initiés — public et artistes confondus, et parmi ces derniers Hervé Loichemol, metteur en scène polémique et stimulant, et Yves Laplace, auteur aigu et brillant intellectuel — qui la conforte dans son ascèse courageuse.
Quant à la Comédie, où Richard Vachoux est arrivé en 1974, nous l'avons vu, il y a d'abord atermoiement, puis rupture avec les galas parisiens. Malgré ce choix décisif et malgré des collaborations fructueuses avec Steiger et Michel Soutter (L'Echange de Claudel, monté par ce dernier), il n'appartiendra pas à Vachoux d'incarner le changement.
Benno Besson: l'ouverture
C'est l'arrivée de Benno Besson, en 1982, qui apporte un renouveau à la Comédie et à tout le théâtre romand. A cette époque, le périple du grand metteur en scène appartient déjà à l'histoire du théâtre. Il est l'artiste européen le plus suisse, puisqu'il a travaillé — en Allemagne, en France et en Italie — dans nos trois langues nationales. Que vient-il retrouver au pays sinon les racines de la langue originelle? La langue française de Besson est terrienne et plébéienne. On l'observe en répétition: c'est une langue que les acteurs, accrochés à son oreille, façonnent comme de la glaise que le metteur en scène leur demande d'extraire de leurs entrailles. Etrange et familière à la fois, cette langue qui sonne avec netteté dans des spectacles dont le charme est difficile à décrire: singulier mélange de féerie cocasse et ludique (il est temps de citer Jean-Marc Stehlé, décorateur et acteur), de gaîté roturière (Brecht et Molière s'y retrouvent) et d'ironie cinglante (signée Besson). Pas la moindre part laissée au vague-à-l'âme et à la métaphysique dans cet univers-là, où le tragique est absent. Comme si le tragique n'était jamais que de l'humain qui se trompe ou qui abuse l'autre: ce que Besson transforme allègrement en illusion comique ou en [p. 57] mascarade grinçante, avec la complicité inventive de Werner Strub, dont personne n'a oublié les beaux masques de L'Oiseau vert.
Benno Besson est aussi pédagogue, sans avoir l'air d'y toucher. Plus par l'exemple que par le discours, il ouvre notre horizon: par des spectacles pointus qui tournent avec succès et transforment le métier de nos acteurs sédentaires, et par ce va-et-vient de projets et de personnes qu'il provoque et qui amène la confiance en soi et l'émulation. Carlo Brandt, Michel Kullmann, Laurent Sandoz, Alain Trétout, Antoine Basler et Gilles Privat, entre autres acteurs, peuvent en témoigner. Douze ans après "l'effet Besson", la présence des comédiens suisses en France n'a jamais été aussi forte. Il n'est que de citer deux autres Genevois: Jean-Luc Bideau à la Comédie-Française et Jean-Quentin Châtelain, prix du meilleur acteur 1992, décerné par le Syndicat des critiques parisiens.
L'un de ces exilés nous est revenu, qui a succédé à Besson, en 1989: Claude Stratz. Sa candidature a été préférée à celle de Matthias Langhoff, dont les vues ambitieuses et les projets de rénovation de la Comédie — voir à ce propos l'explosif Rapport Langhoff, publié chez Zoé — ont effrayé nos autorités. Stratz présente le profil plus familier d'un ancien "marginal" genevois qui a créé ses premiers spectacles dans le réseau obscur des caves privées et des salles périphériques. Rochaix lui a donné asile au Carouge pour un Woyzeck prometteur, mais c'est Patrice Chéreau qui le révèle et lui fait partager toute l'aventure du Théâtre de Nanterre. Artiste jusqu'au bout des ongles, sensible, érudit, Stratz honore délicatement son public de la Comédie avec des spectacles élégants et vibrants. Lui reprochera-t-on sa prédilection pour les joyaux du grand répertoire, si c'est là qu'il trouve matière à brûler sa passion?
Un nouveau défi pour le XXIe siècle
Au moment de conclure, je pense aux jeunes spectateurs que Dominique Catton — aujourd'hui installé dans ses murs — a réunis au Théâtre Am Stram Gram, depuis vingt ans. Connaissent-ils l'artiste qui leur a offert leurs premiers beaux spectacles, ceux qui peuvent décider d'une vie? Savent-ils qu'il a fait ses armes à l'Atelier de François Rochaix, qu'il doit sa passion du théâtre à François Simon, lequel la tenait des Pitoëff qui nous relient au grand théâtre du monde? Si l'on ajoute que Dominique Catton vient de Lyon et qu'il a choisi Genève pour y exercer son art, nous avons l'abrégé de [p. 59] ce qui me touche et me plaît dans cette grande chaîne du théâtre reliant les lieux, les personnes, les amours et les références. C'est ce réseau de filiations que j'ai tenté d'esquisser et qui est miraculeux si l'on songe qu'il se concentre, en l'occurrence, sur une seule ville somme toute petite, Genève, laquelle a eu la chance et le mérite d'accueillir Voltaire, les Pitoëff, Copeau, Dullin et Strehler, qui ont créé, chez nous, certains de leurs spectacles.
Je songe, enfin, aux élèves de l'Ecole Supérieure d'Art Dramatique, qui relève du Conservatoire et que Leyla Aubert dirige depuis 1974. Leur tour viendra bientôt de prendre place au centre du cercle. S'ils connaissent le passé problématique de notre théâtre, ils ne s'attacheront que mieux à ce métier qui n'est pas n'importe quel gagne-pain, mais la "conscience d'être", comme disait François Simon. Leur incombera la responsabilité d'inscrire notre tradition autochtone encore fragile dans le grand tout du théâtre européen. Ils devront être eux-même - au mieux de leur talent et au plus près de leurs propres références - parmi d'autres: sans perdre la mémoire de leurs racines, ni s'enfermer dans un protectionnisme angoissé, par peur du large et de la comparaison. Tel est le défi que notre théâtre devra relever au cap du XXIe siècle.
D. Je.
haut
[p. 60]
L'opéra
Le vendredi 18 janvier 1850, Henri-Frédéric Amiel note dans son Journal intime: "Je reviens du théâtre. [...] Alboni chantait dans la Favorite. Depuis deux ans que je ne l'avais entendue, elle a gagné en rotondité et en talent." Suivent vingt-cinq lignes de commentaires sur la voix de la vedette, qui témoignent d'un esprit critique exercé. "Organe incomparable, de trois octaves et plus d'étendue, et d'un moelleux d'ivoire, d'un velouté, d'une largeur, d'une abondance qui ravissent. Science et méthode parfaites, limpidité, mesure, opulence surtout. Alboni chante comme les autres parlent, sans effort et sans la moindre coquetterie."
Amiel amateur de divas! Ainsi l'écrivain que l'on se plaît à voir comme le type même du calviniste austère se révèle un vrai dilettante; ainsi le professeur introverti, qui noircit des milliers de pages pour triturer sa conscience, ne néglige pas une soirée à l'opéra et sait y apprécier le brillant de Donizetti. On parcourra avec intérêt son Journal pour connaître ses avis sur Mozart, Wagner ou Verdi.
Si Amiel nous sert de point de départ, c'est parce qu'il nous aide d'emblée à dépasser ce qui depuis Rousseau semblait devoir rester un antagonisme irréductible: voués par Jean-Jacques à vivre en s'excluant, voici que le Genevois et le théâtre finissent par faire bon ménage. Mieux encore, car il ne s'agit plus seulement de théâtre parlé: entre la cité de Calvin et l'art lyrique, il n'y aura plus incompatibilité d'humeurs et de goûts. De la chaire de Saint-Pierre à la scène de Neuve, il existe un chemin possible, qui n'est plus seulement de perdition. Et dans cette société qui l'avait longtemps banni, l'opéra aura non seulement droit de cité, il trouvera même un lieu privilégié, internationalement reconnu, recherché par les vedettes et envié par nos voisins.
Mais la route aura été longue, qui conduit des balbutiements à l'essor des années récentes. Quasiment deux siècles, qu'il convient de parcourir rapidement. Ne serait-ce que pour dire qu'on vient de loin.
Douze choristes et trente musiciens
Quand le fameux docteur Charles Burney passa en 1770 — c'était au cours de son enquête sur l'Etat présent de la musique en France et en Italie —, il nota: "On fait peu de musique à Genève, puisque les spectacles y sont interdits". Une année avant, ce n'était plus tout à fait vrai. Une douzaine d'années après, ça ne le serait plus du tout.
Mais ce premier théâtre, ce ne sont pas les Genevois qui le voulurent. Les troupes de garnison, qui désiraient occuper [p. 61] leurs loisirs, eurent ce qu'on appela la "Grange des étrangers" pour leur amusement. La vie de ce "Théâtre de Rosimond" fut très courte: bâti en 1766, il brûla en janvier 1768. On y faisait la comédie et l'opéra-comique. C'est là que Grétry entendit Monsigny et Favart; c'est là qu'il donna lui-même une oeuvre nouvelle, Isabelle et Gertrude. Elle inaugure modestement la modeste liste des créations mondiales dont l'art lyrique genevois pourra se vanter.
Près de quinze ans après l'incendie, les troupes des Puissances occupant la ville en 1782 exigèrent leur théâtre et l'obtinrent: construit au pied de la Treille, dans l'enfilade de la Corraterie, ce fut celui qui servit presque un siècle durant. De nombreuses gravures et des photographies nous en conservent l'image. Le bâtiment, signé Matthey, n'était pas sans élégance. Il contenait un millier de spectateurs sur un parterre et trois étages de balcons. Mais la scène était exiguë et sans dégagements, la fosse ne pouvait accueillir qu'une trentaine de musiciens.
L'histoire de ce bâtiment mêle théâtre parlé et art lyrique. L'opéra y fut médiocrement pratiqué, faute de moyens, faute d'une vraie troupe. Il semble qu'au début, ce furent les comédiens eux-mêmes qui se hasardaient parfois à chanter quelques opéras comiques, de Grétry, de Nicolo, puis de Boieldieu. Quoi qu'il en soit, on a peu de renseignements sur le tournant du siècle: avant 1826, aucune presse pour nous informer sur le répertoire et la manière dont il était servi. Le témoignage de Ludwig Spohr n'en est que plus précieux. Passant par Genève en 1817, il note: "De toutes les villes de Suisse, c'est Genève qui possède le plus grand nombre de musiciens distingués; mais ils sont divisés en deux et même davantage de partis qui vivent à couteaux tirés." Sans doute faut-il imaginer que ces messieurs de la haute ville qui faisaient de la musique ensemble ne se commettaient pas dans les basses régions de Neuve où le théâtre tentait d'explorer aussi le répertoire musical.
Plus tard, on parvient tout de même à jouer Rossini et Donizetti, Auber et Meyerbeer, puis Gounod et Verdi. Et des troupes passent. Allemande en 1841, qui amène Mozart, Beethoven, Weber, Donizetti et Bellini; italienne en 1845, qui y ajoute Rossini. Le théâtre de Zurich vient à plusieurs reprises et réussit même à faire découvrir Tannhäuser aux Genevois, quatre ans avant les Parisiens. Bouffées bienvenues, comme aussi les quelques étoiles qui consentent à quitter Paris: Mme Cinti-Damoreau, Marietta Alboni, le ténor Duprez. Sinon, le Journal de Genève donne l'idée du niveau moyen: "Nous ne pouvons faire l'éloge de l'orchestre, son manque d'accord et d'ensemble a fait [p. 62] murmurer les amateurs... Nulle harmonie, nul accord parmi les choristes." En fait, le choeur était réduit à une douzaine de chanteurs, l'orchestre à trente musiciens. On donne pourtant 170 à 180 soirées par an, où l'on mêle toujours parlé et chanté. Roger de Candolle précise: "Les opéras étaient presque toujours précédés d'un lever de rideau, parfois aussi suivis d'une pièce courte ou d'un ballet. Les vaudevilles figuraient aussi souvent à l'affiche ainsi que les variétés, ce qui pouvait aller jusqu'à un numéro d'acrobates. Le dimanche, il arrivait que l'on donne un drame en cinq actes suivi d'un opéra en cinq actes également." Le goût reste orienté vers le répertoire français, léger de préférence. Si Faust est un succès constant, La Fille de Madame Angot en est un bien plus grand. Dans la même saison, Don Juan est joué deux fois, mais Les Cloches de Corneville dix-sept.
Des hauts et des bas
Quand, en 1879, on construisit le nouveau théâtre — le Grand Théâtre actuel, ou plutôt celui qui brûla en 1951 —, on se réjouit surtout de pouvoir y jouer le grand opéra français, Guillaume Tell, Les Huguenots, La Juive. On le fit en accroissant peu à peu les effectifs de l'orchestre et du choeur (jusqu'à une cinquantaine de musiciens et presque autant de choristes), et jusqu'à se permettre une troupe d'opéra de vingt-cinq personnes, plus une douzaine pour l'opérette, ainsi [p. 63] qu'une vingtaine de danseuses. Cela dans les meilleures saisons, par exemple celle de 1895-1896, marquée par l'Exposition nationale. Il y eut donc quelques hauts et beaucoup de bas.
Les hauts, ce furent ces périodes fastes où Massenet ne refusait pas de venir se faire applaudir aux premières de ses oeuvres, toutes abondamment jouées avec grand succès; ce furent aussi ces vingt-cinq représentations de Lohengrin, qui firent sensation en 1889, alors que Paris n'avait toujours pas réussi à monter l'oeuvre; ce furent encore d'autres Wagner, au cours des saisons suivantes. Les bas, ce furent ces années où les habitués lançaient des pétitions pour réclamer le renvoi de sept chanteurs de la troupe, où "chaque fin d'acte [était] soulignée de protestations et de bordées de sifflets d'une incroyable violence". Vers 1900, la qualité avait à ce point chuté que "la police dut intervenir pour calmer l'indignation des spectateurs" (R. de Candolle). Routine des programmes, désintérêt du vrai public musicien. Juste est pourtant de dire que peu après le tournant du siècle, une oeuvre nouvelle, et suisse, fut un réel et durable succès depuis sa première genevoise en 1907: Les Armaillis de Gustave Doret furent joués vingt-sept fois la première saison et atteignirent la centième dix ans après.
Sinon, toute la première moitié du XXe siècle est un long déclin. Alors qu'Ansermet fait de Genève un haut lieu musical, où la musique vivante est cultivée et aimée, le Grand Théâtre stagne dans la morosité d'un répertoire vieilli et de productions médiocres. En 1927, on congédie troupe et orchestre. Le nombre de soirées lyriques chute jusqu'à moins de vingt par saison. Quelques coups d'éclat, mais importés: les galas des Ballets russes de Diaghilev, les visites des Opéras de Vienne, de Dresde et de Paris. C'est qu'une "Exposition internationale de musique", puis une "Société des festivals internationaux" regroupaient certains mécènes et permettaient de faire venir Mozart avec Franz Schalk, Elisabeth Schumann et Richard Mayr, Pelléas avec Mary Garden, Wagner et Strauss dirigés par Fritz Busch, Rossini et Verdi avec Mariano Stabile.
En marge du théâtre officiel, Albert Paychère, avec sa "Société de musique symphonique", avait pourtant donné l'exemple d'un travail de qualité: en sortant des routines, en explorant un répertoire oublié qu'il défendait avec ferveur, en misant sur un nouveau public, en s'appuyant sur les forces locales sans négliger les amateurs, mais avec l'appoint de la célèbre Rose Féart, en investissant un lieu a priori ingrat (la Salle de la Réformation), dont il tirait des effets de noble simplicité, il prouvait que Gluck parlait encore à une large audience.
[p. 64: image / p. 65]
Une remontée difficile
Plus tard, dès 1934, la Société romande de spectacles entreprit de gérer les saisons du Grand Théâtre et d'en élever le niveau. Son combat fut long, méritoire et ingrat. D'abord parce que la remontée était difficile, alors que le public exigeant avait déserté une scène poussiéreuse (Jaques-Dalcroze écrit alors que "le culte de l'opéra est presque éteint"). Ensuite parce que la guerre survint. Enfin parce que l'incendie de 1951 et l'interminable reconstruction du Grand Théâtre contraignirent à poursuivre les activités lyriques au Grand Casino, salle conçue pour des spectacles d'été, d'opérette et de music-hall.
Son mérite fut pourtant d'élargir le répertoire, de réussir à attirer Ansermet dans la fosse (pour Debussy, Fauré, Moussorgsky, Smetana, Ravel, Falla); de retenir un chef de la qualité de Franz von Hoesslin; plus tard d'engager Schuricht, Karl Bôhm et toute une génération nouvelle de chanteurs, dont les noms font maintenant rêver: Danco et Della Casa, Simionato et di Stefano, Lorenz et Hotter. Au Grand Casino, on se consolait des conditions scéniques précaires, car Léon Ferly, metteur en scène à demeure, faisait des miracles. Les soirées tenaient par la vertu des chanteurs, débarqués de Paris, de Milan ou de Vienne, à l'époque où ces villes avaient de vraies troupes. Qu'importe si l'on avait peu répété: ces équipes restaient soudées et le bon style voyageait avec elles.
Pendant ces presque trente ans de fin d'époque et d'ersatz, le nombre des soirées reste bas; la plupart du temps, chaque titre n'est joué qu'une ou deux fois. Quand le théâtre reconstruit affiche sa première saison, en 1962-1963, la première surprise est de constater que le public d'opéra n'est pas mort: il était là, il attendait des jours meilleurs.
Le Grand Théâtre reconstruit
L'incendie de 1951 aura finalement été providentiel: en se dotant d'un instrument moderne, l'institution fut forcée de se renouveler. Salle enfin confortable, visibilité garantie, scène immense, effets spectaculaires assurés par une machinerie moderne (pour quelques années du moins), enfin et surtout qualité musicale de classe internationale: l'afflux du public est immédiat et se maintient au delà de la première et légitime curiosité. De deux ou trois fois, il faudra bientôt jouer cinq, six, puis sept fois, sans toujours satisfaire la demande. A tel point que très tôt, la légende naît: on ne trouve jamais de [p. 66] places au Grand Théâtre. Les abonnements deviennent quasiment le seul moyen de s'assurer une place. D'où une nouvelle légende: le Grand Théâtre n'est fréquenté que par une élite.
Ce public, tel qu'il existe actuellement, il faut tenter de le cerner. Des enquêtes et des statistiques nous y aident, autant qu'une simple impression d'entracte. Evaluons. Le nombre d'abord. Chaque spectacle étant joué sept fois en moyenne, et devant des salles toujours pleines, on calcule que près de dix mille personnes y assistent. A qui s'ajoutent les spectateurs qui ont accès aux répétitions générales, et en particulier, pour une bonne moitié des productions, les écoliers et les collégiens. En une saison, plus de cent mille personnes franchissent le seuil du Grand Théâtre.
Le profil socio-culturel ensuite. Un tiers de cadres moyens ou supérieurs, un tiers d'employés, d'enseignants, de commerçants et d'ouvriers, un tiers d'étudiants, de retraités et de sans profession. Public mêlé, pour le moins, ni meilleur ni pire qu'ailleurs: il y a les passionnés, mélomanes et lyricomanes; il y a aussi les mondains, qui sont là parce qu'il faut y être; il y a surtout un public ni très riche ni très pauvre, qui aime, qui est prêt à découvrir et à se laisser surprendre. Les spectateurs à revenus modestes n'hésitent pas à s'offrir des abonnements ou des billets aux prix élevés pour satisfaire à un besoin essentiel de leur vie culturelle. Il y a pas mal de jeunes, qu'attire une intelligente politique d'accueil.
Des abonnés privilégiés?
Public d'élite? Plutôt moyen, sans exclusive sociale. On osera dire populaire, parce qu'au sens propre du terme, il représente la population de Genève, dans sa diversité socio-culturelle et dans toutes ses catégories d'âge. De goût plutôt confortable, voire conformiste, il évolue lentement, sans exclusive paralysante, mais sans inventivité stimulante. Le système des abonnements est donc le seul imaginable dans la structure qui s'est mise en place depuis plus de trente ans. Certains ne veulent y voir que le règne d'inacceptables privilèges, mais c'est le seul qui convienne au public d'opéra, le plus immobile, les plus incurieux des publics. Vous programmez Britten ou Wolf-Ferrari: sans abonnés, votre location reste un désert; avec six mille abonnés, vous forcez vos spectateurs à la découverte, qui sortent bouleversés par Billy Budd, ravis des Quatre Rustres.
Depuis la réouverture de 1962, sur quel système d'exploitation décida-t-on d'établir le Grand Théâtre? Reprenant le [p. 67] mode d'organisation qui prévalait depuis la Société romande de spectacles et qui continue à être en usage, le théâtre n'a de fixes que les choeurs et le ballet, et compte sur le concours précieux de l'Orchestre de la Suisse romande. On pratique la stagione, soit huit titres par saison, plus les soirées chorégraphiques. Pour chaque production on engage une distribution adéquate et on prend le temps de répéter avec soin, en général quatre à cinq semaines. Une règle a prévalu, qui fait encore loi: la même distribution est servie pour toute la série de représentations, à la dernière comme à la première. La qualité d'un théâtre, c'est d'abord cela. Non quelques galas ronflant de vedettes, mais toute la saison, chaque soir également pourvu.
Sans troupe fixe, mais non sans personnel nombreux: outre choristes et danseurs, outre une administration qu'on a su garder efficace parce que légère, c'est toute une ville d'artisans qui travaille à la réalisation des décors et des costumes. Deux cents personnes environ, réparties également entre personnel administratif et technique, et personnel artistique permanent. Si l'on ajoute les musiciens de l'OSR qui consacrent à la fosse plus du tiers de leur activité, si l'on n'oublie pas le personnel temporaire, choristes auxiliaires, figurants, techniciens d'appoint, huissiers et ouvreuses, on arrive à un total de plus de quatre cents emplois.
Comme tous les opéras du monde, le Grand Théâtre coûte cher. Seule la Ville de Genève en supporte la subvention. Ni le Canton ni les Communes ne participent à son financement. Effort souvent jugé disproportionné par rapport à la petitesse de la cité. Mais il est aisé de montrer que peu d'opéras du monde ont un nombre de spectateurs aussi élevé, lui aussi "disproportionné" par rapport à la population. Quant aux retombées économiques de l'institution, une étude menée en 1989 a montré que pour chaque franc accordé effectivement au Grand Théâtre, plus du double était reversé dans l'économie genevoise, sous forme de dépenses directes faites par les employés et les spectateurs.
Une fête en quatre actes
Au cours des quatre mandats directoriaux qui se sont succédé dans le théâtre reconstruit (Marcel Lamy 1962-1965, Herbert Graf 1965-1973, Jean-Claude Riber 1973-1980, Hugues Gall 1980-1995), la qualité artistique s'est hissée à un niveau de classe internationale. Quand on rouvrit le théâtre, c'est Marcel Lamy qui essuya les plâtres. Ses mises en scène étaient sans style, mais il aligna les grands noms pour [p. 68] mettre tout de suite la maison sur un grand pied. Quand vint Herbert Graf avec sa longue expérience de vieux renard du lyrique, on eut, dans des mises en scène qui furent plus de tradition que d'aventure, moins de stars et plus de travail d'équipe. Graf savait prospecter les jeunes talents et leur faire confiance. Il eut aussi le souci de créer un nouveau public autant que d'assurer la relève. S'inventèrent des structures dont l'une est toujours en place: les répétitions générales ouvertes aux écoles, merveilleux outil pédagogique, que bien peu d'autres opéras municipaux et nationaux offrent à la jeunesse avec une telle constance. L'autre structure, le Centre lyrique de jeunes chanteurs, n'eut d'existence qu'éphémère.
A ce propos, il convient de rappeler que les énergies lyriques de la cité sont loin d'être canalisées par le seul Grand Théâtre. En marge de la grande scène, plusieurs compagnies d'opérettes et d'opéras de chambre ont multiplié les productions aux moyens modestes. C'est souvent grâce à elles que de jeunes artistes ont pu acquérir leur métier. Eté après été, Sarah Ventura et Robert Dunand ont animé la Section lyrique du Collegium academicum, devenu Opéra de chambre de Genève.
Jean-Claude Riber misa sur les gloires sûres et réussit des réunions de vedettes. L'aspect visuel fit un bon pas en avant. Josef Svodoba multipliait ses projections et ses escaliers que Riber meublait de ses mises en place.
Avec Hugues Gall, ce fut encore autre chose. De ces prédécesseurs, il n'a gardé que les meilleurs exemples. Comme Lamy et Riber, afficher de grands noms, certes, mais seulement s'ils restent de prix raisonnables et s'ils sont prêts à [p. 69] accepter les règles de la maison: plusieurs semaines de répétitions et assurer tous les spectacles. Mais il y avait mieux à faire: comme Graf, tenter la découverte, offrir des prises de rôle, passer des contrats de confiance avec des gens qu'on fait le pari de lancer. Surtout, n'étant pas metteur en scène lui-même, Gall a eu la liberté d'un Diaghilev pour provoquer la rencontre. Il a inventé de grands coups, avec Maurice Béjart et Rolf Liebermann. Il a eu surtout le mérite d'explorer les talents du lieu, en faisant passer François Rochaix à la mise en scène d'opéra, en invitant à venir tâter du lyrique les Goretta, Soutter et Schmid qui avaient, dans les années 70, réinventé un cinéma suisse. Il a permis à Ken Russel, à Jean-Marie Simon, à Pier Luigi Pizzi, à Johannes Schaaf, à Andrei Serban, à Robert Carsen, à Andreas Homoki de signer des spectacles mémorables.
Un opéra qui compte dans le monde
Ainsi l'Opéra de Genève s'est acquis une réputation. Sur quoi est-elle fondée?
Le Grand Théâtre serait-il un lieu où s'invente le répertoire de demain? Non pas. D'ailleurs, ce n'est plus cela qui fait actuellement l'éminence d'une maison, comme ce fut le cas de Dresde à l'époque de Strauss, de Hambourg sous l'ère Liebermann, de Zurich où se créèrent Hindemith, Berg et Schônberg. Et jamais Genève ne joua ce rôle. La liste des créations mondiales qui s'y firent tient en quelques lignes et ne comporte rien qui ait vraiment fait date.
Tout au moins, le Grand Théâtre a-t-il marqué son intérêt pour la création contemporaine? Pas plus. Aucune des oeuvres marquantes de ces trente dernières années n'y a été donnée. L'opéra de notre temps (Zimmermann, Nono, Ligeti, Penderecki, Tippett, Reimann, Berio, Messiaen) a continué d'exister. Ailleurs, sans que nous en voyions rien.
L'Opéra de Genève aurait-il alors été le lieu d'une recherche originale dans le renouveau de l'interprétation musicale, par exemple dans le répertoire baroque? Non pas. C'est à Zurich qu'Harnoncourt travaille; c'est en France que les Gardiner, Christie, Jacobs ont cherché et souvent trouvé. Aurait-on poursuivi ici un travail cohérent dans l'invention scénique? Sans aucun doute, mais au coup par coup. Sans qu'un style maison ne se crée, comme à Bruxelles grâce à Herrmann, Chéreau, Bondy.
Alors? Comment expliquer la réputation et le succès de la scène de Neuve? Du côté des artistes, on aime venir travailler dans une maison bien gérée et sûre, où le climat n'est ni à la [p. 70] contestation ni à l'assoupissement. Du côté de la critique, on salue la tenue générale des spectacles, l'équilibre des distributions, le goût visuel et musical qui, au delà du panachage du répertoire et de la diversité des esthétiques, témoigne de la riche personnalité du directeur, de la sûreté de son instinct et de son exigence du meilleur. Quant au public, il apprécie des choix artistiques qui ont su équilibrer intelligemment le confort du répertoire et l'exploration de territoires moins courus, faire alterner les titres célèbres et les ouvrages à redécouvrir, servir une tradition sans routine et proposer quelques réinterprétations décapantes. De ce point de vue, la création trouve aussi son lieu, moins dans la découverte d'oeuvres nouvelles que dans la nécessaire remise en cause des classiques. Comme toutes les scènes du monde, le Grand Théâtre de Genève est un opéra-musée. Mais c'est un bon musée, où l'événement est créé autant par la qualité de la collection que par le renouvellement de la muséographie.
P. M.
haut
[p. 71]
Le théâtre des "Marionettes de Genève"
Le Théâtre des Marionnettes de Genève est aujourd'hui une institution reconnue d'utilité publique. Ses spectateurs, fidèles et toujours plus nombreux, apprécient les diverses facettes de l'art délicat qu'il leur propose.
La marionnette, sa spécificité
Un théâtre de marionnettes n'est pas, contrairement à ce que d'aucuns pourraient penser, un théâtre d'acteurs miniaturisés et animés (par des fils, des tiges ou des mains), à l'intention principalement d'un public d'enfants. "A la frontière où s'arrête le pouvoir d'expression du corps humain", écrivait Gaston Baty, "le royaume de la marionnette commence". Dans cet art subtil, la marionnette remplit la fonction symbolique d'une idée en action. La technique utilisée est mise au service de cette idée. Par exemple Titania, Reine des fées du Songe d'une nuit d'été de Shakespeare, sera plus aérienne représentée sous la forme d'une marionnette à fils; l'enfance de Gerda, dans le conte d'Andersen La Reine des Neiges, sera symbolisée par une poupée de chiffons à l'image de son animatrice de chair et d'os (Gerda elle-même). Cette forme de théâtre s'apparente, certes, aux autres arts de la scène, mais sa spécificité dépasse la simple notion de différence technique. A certains égards, on pourrait la comparer à un dessin animé tridimensionnel vécu "en direct", ce qui augmente son impact sur le spectateur.
Weber-Perret, président de l'Alliance culturelle romande, précise: "...Voici un vrai théâtre qui se construit hors de la vie, qui obéit à une logique propre, aux règles implacables, mais sans rapport avec la raison raisonnante. Cette forme dramatique a choisi le parti de la pureté, celui de l'art. Sa singularité est d'abolir les notions de temps et d'espace, de leur en substituer d'autres qui caractérisent l'invention... La séduction exercée est celle d'une imagination libérée."
La marionnette a le pouvoir de représenter les éléments naturels, le vent ou la neige, par exemple, et l'on ne sera nullement étonné de l'entendre parler un langage poétique. Elle prendra une autre fois l'allure d'un objet facétieux, comme le petit Briquet d'Andersen; elle apparaîtra sous l'aspect d'un tigre effrayant dont la taille, énorme par rapport à l'échelle des autres protagonistes, symbolisera la puissance totale et triomphante. Une marionnette, contrairement à l'acteur ou au danseur, ne joue pas dans plusieurs pièces. Elle est créée tout exprès pour le rôle qu'elle est destinée à jouer. Aussi reflète-t-elle les visions conjuguées de l'auteur [p. 72] du texte, du scénographe et du metteur en scène, et prend-elle vie à travers le marionnettiste qui lui insuffle sa propre personnalité.
Tous ces traits caractéristiques sont illustrés dans les spectacles du Théâtre des Marionnettes de Genève. Les adultes, aussi bien que les enfants et les jeunes, y trouvent leur compte, car le répertoire, très éclectique, couvre un large spectre d'intérêts, allant de la comédie à la tragédie, du conte poétique à l'intrigue policière, de la fable à la fiction.
Marcelle Moynier, la fondatrice
Le Théâtre des Marionnettes de Genève n'a pas toujours été une institution. Ses débuts furent modestes et sans l'énergie et la persévérance de sa fondatrice, Marcelle Moynier, il aurait sans doute sombré dans l'oubli, comme certains théâtres de marionnettes établis à Genève antérieurement (on mentionne de tels théâtres dès le XVIIIe siècle).
Marcelle Moynier (1888-1980), petite-fille de Gustave Moynier, membre fondateur et premier président du Comité International de la Croix-Rouge, eut une enfance heureuse et épanouie. Ayant terminé ses études secondaires, elle obtint simultanément le diplôme de diction du Conservatoire de Musique de Genève et celui de rythmicienne avec Emile Jaques-Dalcroze, dont elle fut l'une des premières élèves. Après avoir exercé ses dons de comédienne, cette artiste créa, avec la musicienne genevoise Laure Choisy, un cabaret musical, puis un théâtre d'enfants. De là au théâtre de marionnette il n'y avait qu'un pas qu'elle franchit en 1929, en fondant sa propre troupe: "Les Petits Tréteaux". "Certains ne se contentent pas de passer le temps de la vie", écrit Weber-Perret, "ils imposent leur marque à quelque chose. Ce qui est engrangé devient richesse productive. Marcelle Moynier a ce talent de bâtisseur."
Les premières années furent héroïques. Tout était à inventer. La première représentation eut lieu à la Salle des Abeilles de l'Athénée, en 1930. Au programme, un spectacle pour adultes comprenant Une visite romantique de L. Choisy, qui met en scène Liszt et Georges Sand, et L'Impresario de Mozart. Des acteurs, un orchestre et des chanteurs (dont Hugues Cuénod) s'entassaient derrière la scène, prêtant leurs voix aux marionnettes, tandis que marionnettistes et accessoiristes s'affairaient sur les ponts. On le voit, Marcelle Moynier n'avait pas choisi le chemin de la facilité en créant un théâtre de marionnettes à fils, d'autant plus que l'installation devait sans cesse être transportée d'un local à l'autre.
[p. 73: image / p. 74]
Les Marionnettes de Genève
En 1940, la Compagnie se fixa enfin au 4, rue Constantin, dans l'appartement même de sa fondatrice, et fut rebaptisée de son nom actuel "Marionnettes de Genève".
Dès le commencement, Marcelle Moynier sut s'attacher des talents de premier ordre. C'est ainsi qu'à l'équipe de base comprenant M. Moynier, L. Choisy (écrivain et compositeur) et Ingeborg Ruvina (metteur en scène et chorégraphe), se joignirent Eric Poncy (scénographe), Roger Ferrier et Nicolas Coundouriadès (sculpteurs), Cécile Olivet-Binet (costumière), Germaine Duchêne et Jane Falquet. L'esprit d'entreprise de la directrice, son caractère enthousiaste et ses qualités de coeur surent galvaniser tous ces artistes, qui lui restèrent fidèles contre vents et marées pendant plus de trente ans. D'autres collaborateurs, dont Jacek Stryjenski (peintre décorateur), Fernande Peyrot (musicienne) et les comédiens qui prêtaient leurs voix aux marionnettes (François Simon, Lise Ramu, Michel Cassagne, William Jacques, etc., enregistrés par Boris Vancoff), contribuèrent à l'essor du Théâtre.
Les productions de cette époque sont d'une grande variété, allant de la féérie (La Tempête, Le Songe, de Shakespeare) au spectacle musical (L'Apprenti sorcier de Dukas, Music Hall, etc.), des contes populaires (Le Chat botté, Le Calife Cigogne) aux sketches humoristiques (Humulus le Muet d'Anouilh). Citons encore Les Tréteaux de Maître Pierre de Manuel de Falla, donné en 1945 au Grand-Théâtre de Genève, sous la baguette d'Ernest Ansermet, et l'inoubliable Noël des Anges d'Hubert Gignoux, repris presque chaque saison, de sa création en 1954 aux années quatre-vingt. Les critiques, unanimes, s'émerveillaient de la magie qui se dégageait de la petite scène et louaient la beauté des spectacles réalisés par les Marionnettes de Genève.
La relève
Dès 1964, le Théâtre trouve en Nicole Chevallier une collaboratrice qui, progressivement, prend le relais. Diplômée des études pédagogiques de l'Enseignement primaire genevois et de la méthode Jaques-Dalcroze, elle complète sa formation de marionnettiste, dispensée par M. Moynier, en effectuant un stage professionnel d'un an au théâtre Tandarica de Bucarest (marionnettes à fils et à tiges, mise en scène, écriture). Une équipe jeune et dynamique se forme [p. 75] autour de Marcelle Moynier laquelle, sentant la relève assurée, constitue, en 1971, une fondation qui garantira la pérennité de son Théâtre.
Les buts de la Compagnie se précisent: éveiller les enfants aux valeurs éthiques et culturelles et contribuer ainsi à l'épanouissement de leur personnalité, leur donner le goût du théâtre et les sensibiliser aux problèmes qui les entourent. Cette valeur éducative, le département de l'Instruction publique la reconnaît: il organise des séances pendant les heures de classe; la demande des instituteurs est telle que l'activité du Théâtre quadruple en dix ans, soulignant la nécessité d'un véritable professionnalisme. La troupe se compose alors d'une vingtaine de collaborateurs permanents, dont plus de la moitié sont engagés à mi-temps. Plusieurs sont des artistes ou des enseignants diplômés ayant acquis leur formation de marionnettistes dans le Théâtre même.
Jusqu'ici, Marcelle Moynier assumait seule le mécénat de sa Compagnie. Dès 1970, l'Etat et la Ville de Genève subventionnent le Théâtre (mais ce n'est qu'après la mort de la fondatrice, en 1980, que les subventions couvriront les trois quarts environ de son budget).
Des tournées en Suisse romande et en France voisine sont organisées grâce à la création d'un castelet de marionnettes à tiges, plus maniable. La participation à des festivals internationaux à Londres, Charleville-Mézières et Munich fait connaître le Théâtre à l'étranger. Le répertoire des années soixante-dix—quatre-vingt est surtout orienté vers le jeune public, mais de plus en plus d'adultes sont attirés par cette forme d'art, appréciant la qualité des interprétations qu'en donnent les Marionnettes de Genève. On y trouve des pièces du poète jurassien Denys Surdez et des adaptations de contes populaires de Nicole Chevallier. Plusieurs décorateurs collaborent à ces spectacles, dont Jean-Michel Bouchardy, Yseut et Jean-Claude de Crousaz, Irina Dumitriu, ainsi que des musiciens comme Oswald Russell ou Pierre Métrai.
Un anniversaire
La saison 1979-80 voit la célébration du cinquantenaire du Théâtre. La fondatrice a la joie d'assister au couronnement de son inlassable labeur. Au programme: un Spectacle rétrospectif, un Festival international, une Exposition au Musée Rath: L'Art de la Marionnette, et une Création: Les 30 Bougies de D. Surdez.
Peu auparavant, Marcelle Moynier avait reçu de la Ville la médaille "Genève reconnaissante" pour son apport culturel [p. 76] à la cité. Au lendemain de la Première des 3o Bougies, pendant le repas de clôture des festivités, après avoir remercié tous ceux qui avaient oeuvré à cette réussite, Marcelle Moynier s'éteint subitement. Sa disparition marque la fin d'une époque, mais elle laisse derrière elle un patrimoine artistique considérable et une équipe bien décidée à le faire valoir, tout en restant fidèle à l'esprit d'innovation de la fondatrice. La direction du Théâtre est confiée à Nicole Chevallier.
Un théâtre parfaitement adapté
Peu après ce jubilé, le Conseil municipal vote à l'unanimité les crédits nécessaires à la construction d'un théâtre de marionnettes. Marcelle Moynier en connaissait les plans: sises rue Rodo, dans le quartier de Plainpalais, l'ancienne école enfantine Hugo-de-Senger et sa salle de gymnastique, choisies comme lieu d'accueil, seront transformées en espace théâtral par les architectes A. Corbat et E. Barth. Le nouveau théâtre répondra à plusieurs exigences: la salle n'excédera pas 180 places et sera construite en gradins, car il est impératif que les marionnettes, en général de petite taille, soient bien visibles de partout. Une régie son et lumière mobile permettra de commander les projecteurs et les magnétophones de la scène, de la salle ou du local de régie situé derrière les spectateurs. Les coulisses, jusque-là exiguës, devront favoriser les changements de décors à vue. Les cintres, inexistants à la rue Constantin, seront hauts de six mètres afin d'abriter toiles de fond et poupées. En outre, des salles de classe seront transformées en ateliers, locaux administratifs et salle de répétitions.
Ainsi prend forme la salle Marcelle Moynier. L'atmosphère chaleureuse du lieu, ses banquettes agréables et sa forme en coquille Saint-Jacques, en font un petit bijou. De plus, l'ensemble, doté d'installations techniques professionnelles, constitue un outil de qualité permettant d'innombrables variantes lors des créations. Ce nouvel outil est inauguré en 1984, en présence des autorités et de représentants éminents du monde de la marionnette. Saluons ici, avec gratitude, les efforts déployés par Madame Lise Girardin, alors conseillère administrative déléguée aux Beaux-Arts et à la Culture, et par Monsieur André Chavanne, conseiller d'Etat chargé du département de l'Instruction publique. Les Marionnettes de Genève, reconnues par tous, deviennent une institution genevoise, un théâtre à part entière. De nouvelles voies s'ouvrent. Il est désormais possible [p. 77] d'inviter des troupes étrangères à se produire dans les murs même du Théâtre, ce qui diversifie le programme de chaque saison en augmentant le nombre de spectacles proposés, tout en occasionnant des échanges. Mais une telle salle exige davantage de créations de la part de la troupe, qui se voit contrainte d'abandonner momentanément les tournées pour se consacrer au lancement du nouveau bateau. Une équipe moins nombreuse, mais occupée à plein temps, s'engage dans la voie du professionnalisme.
Au répertoire existant s'ajoutent: Le Chant des Roseaux, Adeline et Sapristi, Souba et le Yak, Le Château de Fer, Poucette d'après Andersen, et Le Songe de Shakespeare, dans une mise en scéne du chorégraphe Oscar Araiz. Les pièces jouées en reprise sont réadaptées à la nouvelle scène, ce qui demande un travail considérable.
Le Théâtre, son organisation, son financement
Depuis 1971, le Théâtre des Marionnettes de Genève est une fondation de droit privé, subventionnée à égalité par le département de l'Instruction publique et par la Ville de Genève. Le Conseil de Fondation, dont le président actuel, M. Jaques Naef, a succédé, en 1981, à Marcelle Moynier, a pour tâche de veiller à ce que le Théâtre produise des spectacles de marionnettes (dans le sens large du terme) à l'intention d'enfants et d'adultes. Il nomme le directeur artistique du Théâtre. Il est informé par ce dernier des projets [p. 78] artistiques et en examine les budgets. Il se porte garant de la saine gestion des subventions que lui accordent l'Etat et la Ville. Il est responsable du patrimoine constitué par les réalisations du Théâtre.
L'Association des Amis des Marionnettes de Genève, présidée par Mme Lisette Perrelet, qui a pour buts de faire connaître au public le Théâtre et de lui accorder l'assistance nécessaire au développement de ses activités, contribue à ses besoins financiers dans la mesure de ses moyens.
Les Marionnettes de Genève font également appel à l'aide de Pro Helvetia (notamment pour leurs tournées) et à la générosité de fondations privées ou de sponsors commerciaux, les subventions régulières de l'Etat et de la Ville n'étant plus indexées en raison de la basse conjoncture.
Le renouveau
En 1990, Nicole Chevallier passe le gouvernail à John Lewandowski, qui assume dès lors les fonctions de directeur artistique du Théâtre. De nationalité américaine, il est compositeur, musicien, marionnettiste; il a dirigé une troupe américaine pendant dix ans et a collaboré avec les orchestres symphoniques de Pittsburgh, Cleveland et Boston pour ses créations. Deux prix d'excellence lui ont été attribués par l'Union Internationale de la Marionnette (UNIMA), qui regroupe plus de cinquante pays. Formateur à l'"Instituto de Actor" de Séville et, aux Etats-Unis, à l'"Eugene O'Neil Theatre Center" et à "Harvard University", il a également contribué à la formation de l'équipe de marionnettes du Riksteatret d'Oslo.
A Genève, John Lewandowski, en animateur expérimenté, suit deux voies parallèles et réussit à perpétuer la tradition des marionnettes à fils, figurative, tout en ouvrant le Théâtre à de nouvelles formes d'expression, décoratives, et en donnant la priorité au symbolisme de ses spectacles. Conscient du rôle éducatif de ce Théâtre, il cherche à montrer aux enfants les aspects complexes de la vie: le Bien et le Mal se confondent souvent; il est parfois difficile d'effectuer le bon choix, de prendre la bonne décision. D'autre part, face à la violence véhiculée par les médias, il s'agit de donner aux jeunes spectateurs une vision plus positive de l'existence, de ce que peut accomplir l'homme lorsqu'il met le meilleur de lui-même au service de la société. Or, ces idées sont mieux servies par des images fortes et belles que par un théâtre "psychologique" qui n'est d'ailleurs pas le fait de la marionnette.
[p. 79]
Les collaborateurs du Théâtre
J. Lewandowski est aidé dans sa tâche par une équipe administrative très compétente, dont Marlyse Imhof est l'âme. Quant aux collaborateurs artistiques, fort nombreux, il convient de les diviser en deux groupes:
— les collaborateurs permanents, parmi lesquels un metteur en scène associé, Irina Niculescu, une troupe composée de cinq acteurs-marionnettistes, un sculpteur et un technicien
— les collaborateurs occasionnels: metteurs en scène invités, écrivains, scénographes, musiciens, chorégraphes, éclairagistes, acteurs et marionnettistes d'autres théâtres, engagés au spectacle, la plupart recrutés à Genève. On peut citer parmi les artistes sollicités: Michel Cassagne, Gérald Chevrolet, Philippe Cohen, Jean-Claude Maret, Tane Suter, etc.
La formation
D'emblée, J. Lewandowski s'attaque au problème de la formation. En effet, en l'absence d'une formation spécifique en Suisse, les nouvelles recrues devraient pouvoir aller pendant quatre ans suivre les cours dispensés par l'une des écoles européennes (Charleville-Mézières en France, Stuttgart en Allemagne, Prague en République tchèque). Par ailleurs, la plupart des élèves sortant de ces écoles sont étrangers et il est très difficile d'obtenir pour eux des permis de travail à [p. 80] l'année. Une autre possibilité serait de faire des Marionnettes de Genève un lieu de formation, mais cela demanderait des fonds spéciaux. C'est néanmoins cette option que prend le nouveau directeur qui, peu à peu, transforme la Compagnie. Les marionnettistes, jusque-là habitués à jouer avec le support d'une bande sonore enregistrée, disent désormais eux-mêmes les textes de leurs poupées, interviennent dans le spectacle, apprennent à utiliser leur corps comme décor mouvant. Une osmose entre les membres de l'équipe s'opère, ceux qui sortent de l'Ecole d'art dramatique s'initiant au métier de marionnettiste avec leurs camarades et leur donnant à leur tour des conseils professionnels. Plusieurs intervenants sont engagés pour des stages ou des activités liées aux spectacles. Ce bagage théâtral permet de réaliser plus rapidement les créations.
Le répertoire
Aujourd'hui, la salle Marcelle Moynier accueille annuellement 30.000 spectateurs. De plus, environ 10.000 personnes sont atteintes par les tournées. Les saisons se composent de huit à dix spectacles, répartis en 250 représentations en moyenne.
Le répertoire actuel du Théâtre comprend des créations pour marionnettes à fils mises en scène avec une remarquable fantaisie par Irina Niculescu, qui en a également élaboré les scénarios: Le Chant des Roseaux (1985), Montagne de Riz (1991), Juan Darien, l'Enfant-tigre (1993), Passions Electriques (1994). A ces pièces s'ajoutent des créations pour techniques diverses: L'Oiseau de Feu (1991) mis en scène par I. Niculescu, Le Bain de Noé (1992) mis en scène par E. Bass, Coppélia (1992) et La Reine des Neiges (1993) mises en scène par J. Krofta, et quelques reprises de l'ancien répertoire. En outre une expérience de feuilleton policier pour marionnettes à fils est en cours avec Les Aventures de l'Inspecteur Kidi de G. Chevrolet.
Une ouverture sur le monde
Chaque saison, le Théâtre accueille des troupes étrangères, faisant ainsi connaître au public genevois des artistes de renom international dans ce domaine. C'est ainsi que le théâtre français "Archimage", de Guy Jutard, qui familiarise les enfants avec la peinture moderne, le "Stuffed Puppet Theatre" de Neville Tranter (Amsterdam), dont l'humour acide accroche les adultes, le "Sandglass Theatre" d'Eric [p. 81] Bass (U.S.A.), nostalgique et poétique, le célèbre "Théâtre Drak" de Prague, le "Riksteatret" d'Oslo, et bien d'autres troupes ont figuré au programme de ces dernières années.
La Compagnie des Marionnettes de Genève joue régulièrement en tournée, dans la région genevoise, en Suisse romande et à l'étranger. Ses représentations hors-les-murs sont une carte de visite pour Genève. D'autre part, les festivals donnent à la troupe l'occasion de se produire devant les professionnels du monde international de la marionnette. C'est ainsi qu'en 1993, invitée à participer au "Puppeteers of America National Festival", elle a traversé l'Atlantique et a remporté un vif succès à Atlanta et à San Francisco, réalisant un rêve caressé depuis longtemps: les tournées de marionnettes à fils.
La tournée de Juan Darien aux Etats-Unis a suscité un vif intérêt pour l'activité de la Compagnie; aussi John Lewandowski envisage-t-il de répéter l'opération tous les trois ans. Ces tournées, très stimulantes pour la troupe, demandent une infrastructure et une organisation soignées, afin que chacun profite au maximum de l'échange culturel qu'elles constituent.
Les projets
Les projets du Théâtre ne manquent pas. L'avenir est aux coproductions qui, tout en favorisant les progrès culturels, permettent de sérieuses économies sur le plan matériel, ce qui n'est pas négligeable en période de crise.
Une coproduction est en cours avec le théâtre Tandarica de Bucarest: les deux troupes préparent ensemble le même spectacle; il y a donc échange au niveau artistique. Genève fournit des matériaux introuvables en Roumanie; Bucarest réalise décors et poupées. Un sculpteur roumain, spécialiste des marionnettes, forme un jeune sculpteur genevois frais émoulu de l'Ecole supérieure d'Art visuel, alors que les cadres administratifs du Théâtre de Genève initient leurs homologues roumains aux techniques occidentales d'administration. Une autre coproduction, musicale cette fois, est envisagée pour 1997 avec l'Orchestre de Chambre de Neuchâtel.
En collaboration avec le théâtre Drak, de Prague, est créée une trilogie sur l'amour, mise en scène par Joseph Krofta. Cette trilogie a déjà vu la réalisaton de ses deux premiers volets: Coppélia (L'amour de la perfection pour elle-même, sans âme) et La Reine des Neiges (l'amour pur, innocent, triomphant). Le troisième volet est prévu pour 1995 ou 1996. [p. 82]
Dans le grenier des Marionnettes de Genève, plus de 700 poupées, véritables oeuvres d'art, attendent le jour bienheureux où un lieu d'exposition les accueillera en permanence. Certaines, trop anciennes, ne joueront plus jamais, mais restent les témoins d'un passé riche et actif. D'autres reprendront probablement quelquefois encore leur rôle, puis s'arrêteront à leur tour. Le Conseil de Fondation et les Amis des Marionnettes de Genève ont à coeur de protéger ce patrimoine et d'en faire profiter les Genevois. Ils espèrent trouver l'occasion favorable à la réalisation de ce projet dans un proche avenir.
Passé, présent, avenir... ainsi va la vie, perpétuel déroulement qui nous entraîne, bousculant nos habitudes et nous remettant sans cesse en question. Cette remise en question est justement le propre de la Compagnie des Marionnettes de Genève qui, s'appuyant sur une tradition profondément enracinée, forge un théâtre de marionnettes moderne, capable de répondre aux préoccupations et aux intérêts du public d'aujourd'hui.
N. Ch.
haut
[p. 83]
La danse
Le 20 décembre 1915, Genève découvre le ballet. Jusqu'ici seules quelques troupes itinérantes de peu d'envergure se sont risquées à se produire dans la cité de Calvin. Et si l'une des plus grandes danseuses du siècle passé, Carlotta Grisi, la créatrice du rôle de Giselle, a vécu quarante-cinq ans à Saint-Jean — elle est d'ailleurs enterrée au cimetière de Châtelaine — c'était pour y couler des jours paisibles, à l'écart de l'agitation des coulisses. Ce 20 décembre 1915, les Ballets Russes de Serge Diaghilev donnent un unique gala au Grand Théâtre. Ils arrivent de Lausanne où la guerre les a confinés six mois. Par l'entremise d'Ernest Ansermet, leur nouveau chef d'orchestre, ils dansent au bénéfice des victimes russes de la guerre. Venu en voisin de Morges, Igor Strawinsky prend pour la première fois la baguette. Il dirige la Suite qu'il a tirée de son Oiseau de feu. Le chef vaudois, lui, est au pupitre pour Soleil de nuit — création mondiale de ce premier ballet du jeune Massine —, pour les Danses polovtsiennes du Prince Igor et pour Carnaval.
Avant de quitter Genève pour Paris, Serge Diaghilev s'attache les services d'une cantatrice du Grand Théâtre qui s'est illustrée dans les rôles-titres de Tosca et de Thaïs notamment. Flora Emilie Treichler, dite Flore Revalles (1889-1966), va se trouver promue partenaire de Nijinsky dans Shéhérazade, L'Après-midi d'un faune, Till Eulenspiegel... Elle participera aux deux tournées nord-américaines des Ballets Russes (1916/1917). La vigueur des interprètes, la luxuriance des costumes émerveille la presse. Dans La Suisse du 21 décembre 1915, Lucienne Florentin loue, à propos de Soleil de nuit, "ces grandes combinaisons linéaires, (ces) vastes mouvements où des masses colorées se déplacent, se pénètrent, se disloquent et se reforment à nouveau; où tout s'enchaîne selon la logique nouvelle d'un jeu dont la diversité ravit d'abord, confond ensuite. Nous touchons ici à un art populaire innocent, ingénu et d'un raffinement inouï." Les Ballets Russes n'oublieront pas cet accueil enthousiaste. Ils feront à nouveau halte à Genève en 1921, 1922 et 1923.
L'entre-deux guerres est une période faste pour la chorégraphie. Les Ballets Russes et la danse d'expression d'Europe centrale suscitent une effervescence. Comme la plupart des grands centres, Genève n'y échappe pas. Dès 1918, le célèbre couple germano-russe Clotilde et Alexandre Sakharoff s'y attache un public fidèle. En 1926 déjà, Lucienne Florentin leur consacre un opuscule admiratif: "Pour les uns, ils sont deux beaux corps se mouvant harmonieusement dans l'espace. Pour d'autres, les libérateurs des rythmes endormis dans nos profondeurs et pour un petit nombre, les successives apparences d'un ordre qui vient de Dieu." Jusqu'en [p. 84] 1950, année où Clotilde fait ses adieux dans La Mort d'Isolde, accompagnée par l'Orchestre de la Suisse Romande placé sous la direction d'Ernest Ansermet, ces deux poètes de la danse suscitent un véritable engouement.
Un Genevois à l'Opéra de Paris
A la faveur de différentes tournées, le public lémanique prend conscience de la mutation que connaît alors l'art chorégraphique. Kurt Jooss, Mary Wigman, Harald Kreutzberg, Trudi Schoop lui font découvrir les sortilèges de la danse d'expression. A l'opposé, le Ballet de l'Opéra de Paris (1930) et les Ballets Russes de Monte-Carlo (1932) viennent défendre et illustrer le renouveau de la danse académique. Ces spectacles constituent une émulation pour les jeunes Genevois qui se rêvent danseur ou danseuse. Jusque-là, il était hors de question d'entreprendre une telle carrière sur place. C'est à Paris qu'Eugène Ponti (1897-1976) a dû aller tenter sa chance, dans le sillage des Pitoëff. Bien lui en a pris: il est désormais Grand sujet à l'Opéra.
Au risque de s'attirer les foudres de l'Institut Jaques-Dalcroze où elle enseigne, Monica Jaquet (née en 1909) donne à la Comédie un premier récital de danse libre (1940). Dès 1942, Willy Servin et sa partenaire Josette Coran lui emboîtent le pas. Pour renouveler la formule, M. Jaquet et W. Servin s'associent même à quatre autres artistes dans la perspective d'un "gala" au Conservatoire (1945). Fort bien accueilli, ce spectacle est développé en un "ballet da camera", l'année suivante. Là, les danseurs ne se contentent plus de juxtaposer des solos: ils développent des chorégraphies de groupe tels Les Sept Péchés capitaux. "Notre pays romand est-il vraiment, comme on le dit, une terre ingrate pour les chorégraphes indépendants?" s'interroge le critique Jean Delor (La Suisse, 6 avril 1946). "Dans cette terre, une graine a germé, elle a donné ses premières pousses. Le public me semble tout disposé à lui donner, pour qu'elle prospère, les soins qu'elle mérite."
Cours de danse au Conservatoire
Le fait est que les années de guerre marquent comme un tournant pour le développement de la danse à Genève. En 1941, le Conservatoire de Musique ouvre une classe de ballet. Une année plus tard, le Grand Théâtre fait appel aux Flay, duo alémanique formé par les époux Willy (1909-1984) et Delly (1904-1970) Flay. Bien qu'une petite troupe ait été épisodiquement en activité dans l'illustre maison, c'est avec [p. 85] les Flay que la danse va connaître un premier essor, place Neuve. Loin de se satisfaire des seuls divertissements d'opéra, ils se piquent de régler, quand l'occasion leur en est laissée, de véritables soirées de ballet (Le Beau dimanche, musique de Pierre Wissmer, 1944; Daphnis et Chloé, 1945; Le Festin de l'araignée, 1948; etc.).
L'incendie du Grand Théâtre, en 1951, ne les dissuade pas de poursuivre sur cette voie. A l'enseigne du "Ballet de Genève" et à leurs risques et périls, ils multiplient les créations (Valses nobles et sentimentales, argument d'Ernest Ansermet, 1951; Cendrillon, sur une partition d'Ami Châtelain, 1955; etc.). Professeurs au Conservatoire de Musique dès 1943, à la tête d'une école privée également, les Flay enseignent plusieurs générations de Genevois.
Lui aussi danseur, chorégraphe et professeur, mais encore pianiste et compositeur, le jeune Ulysse Bolle (né en 1924) se pose en rival. Après quelques récitals, il se lance courageusement — témérairement selon ses détracteurs — dans une série de créations plus complexes (telle Estampes, musique d'Ulysse Bolle, 1943). C'est en accomplissant son école de recrues qu'il échafaude Hippolyte (musique de Henri Scolari, 1945), un ballet-soirée inspiré d'Euripide et réunissant une quarantaine d'interprètes, parmi lesquels beaucoup d'amateurs. Que ce soit au Grand Théâtre, où, en 1950, il succède brièvement aux Flay, ou encore au Théâtre de la Cour Saint-Pierre, Ulysse Bolle tente de donner corps à ses hautes ambitions; cela jusqu'en 1958, date à laquelle il se tourne vers d'autres activités.
[p. 86]
Le Maître des étoiles
A l'instar des Flay et d'Ulysse Bolle, plusieurs professeurs ouvrent des écoles. En 1948, Ludmilla Gorny (née en 1924), danseuse d'origine russe, quitte le Théâtre municipal de Lausanne pour s'établir à Genève en compagnie de son mari, le peintre Alexis Chiriaeff. Elle crée une académie dans la Vieille Ville. Une occasion d'émigrer en Amérique se présentant, quatre années plus tard, elle interrompt l'oeuvre en cours. "Ce que j'ai fait au Canada, j'aurais aimé l'avoir fait en Suisse", dira-t-elle par la suite à la Tribune de Lausanne (4 mai 1969), alors que, fondatrice des Grands Ballets Canadiens, elle comptera parmi les personnalités de la danse les plus en vue outre-Atlantique.
L'incendie du Grand Théâtre, le 1er mai 1951, contraint la Société romande des spectacles à déplacer ses activités au Grand Casino. Durant dix ans, Valentine Kousnetzoff (1911-1985), la nouvelle maîtresse de ballet, règle tous les divertissements d'opérette et d'opéra, de La Veuve joyeuse à Carmen. Ainsi qu'il l'écrit dans La Suisse du 20 juin 1985, Jean Delor apprécie chez elle l'exactitude des mises en place, la qualité des chorégraphies, où le goût se joignait à une ingéniosité nécessitée par des conditons scéniques souvent difficiles. En pédagogue passionnée, elle transmet "aux jeunes générations les principes qu'elle-même [a] reçus de l'illustre Olga Preobrajenska, dont elle fut l'une des élèves favorites".
En 1952, l'Ukrainien Youra Tcheremissinoff s'installe à son tour à Genève pour y prodiguer un enseignement de haute qualité. Son école figurera longtemps parmi les plus actives de la ville. Futur soliste du Ballet du Grand Théâtre, Pierre Polliand y fait ses classes. Autant Tcheremissinoff travaille dans la discrétion, autant le Russe Boris Kniaseff (1900-1975) suscite une large attention. Après une année passée à Lausanne, Kniaseff, "le maître des étoiles", ouvre un cours dans une ancienne salle de jeu du Casino, rue de Monthoux (1954). Dans un cadre somptueux — miroirs aux cadres dorés, jades, brocarts... —, il développe sa fameuse "barre à terre"; un système qui a l'avantage d'alléger l'effort et d'assurer un meilleur contrôle du placement grâce au contact avec le sol. Excessif en tout, Boris Kniaseff exerce une emprise totale sur ses élèves dont certains, Lausannois ou Parisiens, l'ont suivi au bout du lac. Pendant près de quatre ans, il fait de Genève un centre international de la danse. Après quoi, en éternel baladin, il reprend la route: Rome, Athènes...
[p. 87]
Tournées de l'Opéra de Paris
L'immédiat après-guerre et surtout les années cinquante valent à la danse un élargissement de son public grâce à la venue de brillantes compagnies étrangères. En 1946 déjà, les Ballets des Champs-Elysées dansent, au Grand Théâtre, Les Forains de Roland Petit. A l'Opéra de Paris — tournées quasi annuelles dès 1946 également —, s'ajoutent des ensembles récemment créés, mais déjà fort réputés, à commencer par l'American National Ballet Theatre (1950), le Ballet du Marquis de Cuevas (1951) ou le London Festival Ballet (1957). Toutefois, les balletomanes n'hésitent pas à se rendre à Lausanne où l'offre est plus riche encore: New York City Ballet (1952), Martha Graham (1954) et, avec la création du Festival international de Lausanne (1956), un florilège de grandes compagnies, Royal Ballet britannique en tête.
La réouverture du Grand Théâtre, en 1962, marque le début d'une ère nouvelle. Genève dispose désormais d'une compagnie professionnelle de haute qualité. Les danseurs sont nettement mieux formés que par le passé. Marcel Lamy, le directeur général (1962-1965) fait appel à Janine Charrat (née en 1924) qui inaugure son "règne" avec Tu auras nom... Tristan, ballet qu'elle commente en ces termes: "J'ai eu, en le réalisant, l'impression émouvante que «je posais une première pierre» consacrant à la fois les espoirs de tous et... ma propre renaissance". La danseuse a été victime, une année plus tôt, d'un terrible accident sur un plateau de la Télévision française. Ses débuts genevois représentent aussi son retour sur la scène.
Pour le temps présent
Quelques mois plus tard, Janine Charrat retient à nouveau l'attention avec Pour le temps présent, partition d'Armin Schibler distinguée lors du premier Concours international de musique de ballet de Genève (1963). Et au printemps 1964, en complément à Giselle, elle présente sa troisième et dernière création genevoise: Alerte... puits 21, musique de Pierre Wissmer, une relecture du mythe d'Orphée. Le Monde (14 mai 1964) en donne la description suivante: "L'Eurydice d'Alerte... Puits 21 est une infirmière secouriste, descendue dans l'enfer d'une mine secouée par un coup de grisou. Elle disparaît lors d'une nouvelle explosion plus violente et son fiancé la cherche à travers les fumées et la panique. Janine Charrat, avec son style inimitable, exprime la douleur, l'effroi, les hallucinations." [p. 88: image / p. 89]
Au terme de deux saisons seulement, Janine Charrat met fin à son mandat. Elle se déclare déçue des conditions de travail: trop peu de représentations (deux séries de trois annuellement), aucune tournée. C'est que le Ballet du Grand Théâtre est destiné avant tout à l'ornementation chorégraphique des opéras. C'est d'ailleurs dans Don Carlos, le 10 décembre 1962, que les danseurs ont occupé la scène pour la première fois.
Prenant la relève, Serge Golovine (né en 1924) s'en vient avec quelques-unes des solistes de sa propre compagnie: Liliane van de Velde, Geneviève Chaussat, Monique Yanotta... Il ne néglige pas les ballets qui ont fait leurs preuves comme Le Spectre de la rose de Fokine et Les Forains de Roland Petit, voire La Belle au Bois-Dormant de Petipa. Mais il les encadre de créations: Ressac et Répercussion, musique de Pierre Métrai; Contraste, d'Armin Schibler; L'Entre-monde, de Jacques Guyonnet. Sa vision du Mandarin merveilleux de Bartok fait scandale. Un conseiller municipal interpelle le Conseil administratif à propos de ce qu'il appelle des "petites saletés pornographiques"...
Concours de musique de ballet
La direction de Golovine provoque un regain d'intérêt pour la danse, en particulier auprès des jeunes que séduisent les chorégraphies, les musiques et les décors audacieux choisis. Un effort didactique est marqué par le biais de démonstrations gratuites. Mais en 1968, le maître de ballet remet en question son propre travail et présente brusquement sa démission. S'ensuit un interrègne au cours duquel le chorégraphe chilien Ottavio Cintolesi crée Manu-Tara, partition de Jean Derbès primée au Concours international de musique de ballet de la Ville de Genève 1967. Par la suite, les lauréats dudit concours devront se contenter d'une création en concert, les chorégraphes ne montrant plus guère d'intérêt pour les oeuvres couronnées.
Deux jeunes danseurs de l'Opéra de Paris, d'origine genevoise l'un et l'autre, sont également appelés à la rescousse (1969). Norbert Schmucki (né en 1940) est alors coryphée au Palais-Garnier. Bien que diversement appréciés du public, ses Arachnéa et Echeveau font l'effet d'une "révélation" sur une partie de la critique. Gilbert Mayer (né en 1934) a quitté sa ville natale à l'âge de 14 ans pour entrer à l'Ecole de danse de l'Opéra. Ayant atteint le sommet de sa carrière d'interprète, il est Premier danseur. Au Grand Théâtre, il présente Interférences et Sérénade. Il ne peut deviner qu'une quinzaine [p. 90] d'années plus tard, devenu professeur à l'Opéra, il se verra proposer au surplus la responsabilité artistique de la danse au Conservatoire de Musique de Genève!
"Si un ensemble tel que celui du Grand Théâtre veut maintenant gravir un échelon de plus, estime Jean Delor dans La Suisse (2 mars 1969), il lui faut absolument un chef de premier ordre, jeune, dynamique... génial, quoi! Il faudrait — opération délicate — capter un oiseau rare à son envol..." S'il s'est envolé depuis longtemps, c'est bien un oiseau rare qui est sollicité pour la direction artistique du Ballet genevois.
De ses années passées au Metropolitan Opera, Herbert Graf, le patron du Grand Théâtre (1965-1973), conserve en effet l'amitié d'un des chorégraphes-phares de ce siècle: George Balanchine, le fondateur du New York City Ballet. Balanchine accepte de prêter son concours. Il délègue place Neuve un... Genevois d'adoption. Alfonso Catâ (1937-1990), bien que d'origine cubaine, a vécu à Genève depuis l'âge de 10 ans. Il y a suivi les cours de Willy Flay et de Boris Kniaseff. A 15 ans, il a assisté, ébloui, à Lausanne, à un spectacle du New York City Ballet. Et quelques années plus tard, il a eu la joie d'être engagé par cette prestigieuse compagnie.
Arrivée de "Mister B."
Epaulé par George Balanchine qui se plaît à passer plusieurs mois par an à Genève, Alfonso Catâ constitue une nouvelle compagnie et bâtit un répertoire: d'Apollon Musagète aux Quatre Tempéraments, d'Agon à Episodes. La compagnie genevoise entre de plain-pied dans l'ère de l'abstraction chorégraphique. A ce florilège balanchinien, Catâ ajoute quelques chorégraphies de sa façon telle Sonatine (musique de Pierre Métrai) ou Images 60-70 (Jacques Guyonnet). Le corps de ballet, déjà racé, est renforcé à l'occasion par des solistes venus de New York.
"Mister B.", ainsi que le nomment les danseurs, insiste pour que soit fondée une école de danse; souhait déjà exprimé par Golovine. Le développement local du ballet est à ce prix. Sa direction est assurée conjointement par Alfonso Catà et par Beatriz Consuelo, ex-étoile du Marquis de Cuevas et première danseuse au Grand Théâtre. Celle-ci en poursuivra l'exploitation à titre personnel lorsqu'en 1975, il sera décidé de ne pas conserver cette académie, signe manifeste du peu de cas que l'on fait souvent de la danse dans les maisons d'opéra. [p. 91]
A l'initiative de Mme Anita Oser et du compositeur Pierre Métral, est fondé parallèlement l'ERA — Etudes et Rencontres artistiques —, une institution qui se propose de "travailler à la recherche de formules d'expression adaptées à notre temps pour tout ce qui touche à la scène et au spectacle". Rue Charles-Bonnet, un vaste studio accueille tout d'abord Serge Golovine (1969), puis Philippe Dahlmann. Jusqu'en 1974, l'ERA polarise l'attention en mettant sur pied différents stages et spectacles.
Danse contemporaine à Patiño
Prenant le relais, la Salle Simon I. Patiño, autre expression d'un mécénat aussi courageux qu'éclairé, joue un rôle considérable. Elle assure la promotion de la danse contemporaine à Genève. Les artistes les plus électrisants s'y succèdent: Trisha Brown en 1976, Douglas Dunn et Dominique Bagouet en 1977, Carolyn Carlson et Karole Armitage en 1980, etc.
A noter que Dominique Bagouet, comme Karole Armitage, ont dansé au Grand Théâtre, le premier sous l'autorité d'Alfonso Catâ, la seconde sous celle de Patricia Neary. En 1973, en effet, appelé à diriger le Ballet de l'Opéra de Francfort, le maître de ballet cède la place à Miss Neary (née en 1942), autre disciple de Balanchine. Sous sa direction, la compagnie municipale ouvre davantage encore ses programmes à d'autres chorégraphes: Alvin Ailey, John Cranko, Birgit Cullberg... Patricia Neary se risque même à chorégraphier une partition du compositeur vaudois Julien-François Zbinden: Jazzific 59-16 (1974).
Grève des danseurs
La jeune maîtresse de ballet s'efforce de faire "tourner" sa troupe en France, en Italie, en Espagne. A Genève même, trop peu de spectacles sont agendés. "Cette situation a tendance à engendrer un découragement général dans la compagnie, explique-t-elle dans Construire (N° 12, mars 1977). Passer son temps à répéter, ce n'est pas possible. Les danseurs ont besoin de donner le meilleur d'eux-mêmes devant un public." La constitution d'une Association pour le Ballet de Genève, appelée à fournir à cette troupe un soutien moral, promotionnel et financier (1977), ne parviendra pas à retenir Patricia Neary et son maître George Balanchine. En 1978, le duo américain, alléché par la perspective de disposer [p. 92] de davantage de danseurs — 42 au lieu de 34 —, d'un budget nettement plus élevé et d'un nombre accru de représentations, répondra à l'offre de Zurich. C'en est terminé de Genève, tête de pont du New York City Ballet en Europe, avec ses vingt-sept ballets de Balanchine!
La venue de Peter van Dyk, nouveau responsable de la compagnie, est précédée d'une grève des danseurs, un soir de "première" (novembre 1977). Choqués par les méthodes expéditives de Jean-Claude Riber, directeur général de 1973 à 1980, les artistes refusent de passer une audition en vue d'un éventuel réengagement. Il faudra la médiation de l'Office de conciliation pour que le conflit qui, au Conseil municipal, prend une tournure politique, soit réglé. Avec Peter van Dyk (né en 1929), c'est une autre vision de la danse qui s'épanouit. D'Idéal, le premier pas de deux qu'il offre en guise de carte de visite (1978), à la Symphonie inachevée par quoi il terminera sa seconde saison, un classicisme lyrique s'impose.
La présence d'une compagnie professionnelle exerce d'heureux effets sur l'enseignement. Serge Golovine, de retour à Genève en 1974, et Beatriz Consuelo font des émules. Une kyrielle de danseurs du Grand Théâtre ouvrent à leur tour des écoles: Claudine Kamoun et David Allen, Noëlle Winkelmann et Maria Galeazzo, Jean Martinelli, Peter Heubi, Geneviève Chaussat... D'autres comme Corinne Marguet, Anne Sarlat, Christl Siesz et, plus tard, Laura Smeak entrent au Conservatoire. Brigitte Matteuzzi, quant à elle, fait connaître "la jazz dance".
[p. 93]
Ballet théâtral avec Araiz
Enfants, Frédéric Gafner et Jérôme Meyer, deux purs produits de l'enseignement genevois, font l'un et l'autre leurs débuts dans Le Baiser d'Oscar Araiz. C'est que le Ballet du Grand Théâtre connaît sous l'égide du chorégraphe argentin (né en 1940) que Hugues Gall a appelé à ses côtés, huit années de fructueuse stabilité. Son premier programme, en octobre 1980, donne immédiatement le ton. Des danseurs qui affichent une disparité physique avec laquelle jouer scéniquement, un style faisant intervenir mouvements modernes et pas académiques... un renouveau se manifeste indubitablement. Pour la première fois, d'ailleurs, des cours de danse contemporaines sont donnés, place Neuve. Le goût du chorégraphe pour une danse théâtrale aux références expressionnistes débouche sur la création d'un chapelet d'oeuvres fortes: Rhapsodie, Tango, Iberica, Mathis der Maler, Les Sept péchés capitaux et même El Publico — d'après Garcia Lorca, donné en création à la Comédie.
Fini, en effet, le temps de la vingtaine de représentations annuelles. Le Ballet du Grand Théâtre paraît se multiplier. Galas extra muros à Genève — Tango est dansé avec un vif succès au Grand Casino — en Suisse romande et en France voisine; tournées au loin — Amérique latine, URSS, Cuba, Chine... Emissions de télévision... En 1988, cependant, désireux de se "ressourcer", Oscar Araiz renonce à la direction de la compagnie. Il transmet le flambeau au Yougoslave Gradimir Pankov (né en 1938), lequel, tout en poursuivant cette politique de "sorties", s'emploie à relever le niveau technique et à élargir la palette chorégraphique. Ainsi fait-il appel à quelques "piliers" du répertoire contemporain tels Jiri Kylian, Christopher Bruce et Mats Ek, ainsi qu'à de jeunes créateurs dont certains, comme Ohad Naharin, apportent un sang totalement neuf à Genève.
Recherches contemporaines
Si le "modernisme" de ces programmes suscite la nostalgie des nombreux amateurs de ballets classiques, il rencontre, en revanche, l'adhésion des fidèles du Festival de la Bâtie, du Théâtre Off — dans l'ancien Palais des expositions —, de la Salle Patiño ou de la Salle de Plainpalais. L'offre s'accroît singulièrement au cours des années quatre-vingts. Une Association pour la danse contemporaine est d'ailleurs créée en 1986. Elle présente à Genève les démarches créatrices qu'elle tient pour les plus intéressantes du moment. Conseillère [p. 94] artistique, Noemi Lapzeson, ex-soliste de Martha Graham et du London Contemporary Dance Theatre, monte elle-même des spectacles à l'enseigne de "Vertical Danse". Dans son sillage, plusieurs danseuses développent leurs propres recherches: Laura Tanner, Fabienne Abramovich...
Dix années durant (1983-1993), le public de la danse contemporaine trouve, au Festival de Vernier, comme un rendez-vous annuel avec le meilleur de la production internationale: Suzanne Linke, Kilina Cremona, Bill T. Jones / Arnie Zane, Daniel Larrieu, etc.
La multiplication des cours, des stages et des spectacles suscite un intérêt accru pour la danse. Un concours classique est organisé à l'intention des élèves par l'Association des écoles de danse de Genève, sur un plan local d'abord (1987), puis national (1990) et international enfin (1994). Lauréate de ce concours, Samatha Allen a l'occasion d'aller se perfectionner aux Etats-Unis. Elle ne tarde pas à être admise au sein du New York City Ballet.
Le Ballet Junior
En 1980 déjà, une compagnie de jeunes en fin de formation est fondée par Beatriz Consuelo. Le Ballet Junior est fort sollicité, en Suisse comme à l'étranger. Sa tête d'affiche, Frédéric Gafner, le fils de Beatriz Consuelo et de Claude Gafner, danse aujourd'hui chez Merce Cunningham. A sa suite, d'autres éléments du Ballet Junior mènent de fructueuses carrières: Prisca Harsch chez Béjart, puis Gallotta; Sarah Ludi chez Anne Teresa De Keersmaeker, Andrea Megarese au Frankfurter Ballet de William Forsythe, Yann Aubert à Stuttgart, Patrice Delay au Ballet royal des Flandres, Nicolas May à Hagen, Ken Ossola au Nederlands Dans Theater et Gregory Batardon au Ballet du Grand Théâtre où les passeports suisses sont devenus bien rares...
J.-P. P.
haut
[p. 95]
Genève et son cinéma
A en croire d'insaisissables statistiques, Genève serait en ce début des années 1990 la ville d'Europe où l'on va le plus au cinéma. Il n'est pas moins notoire qu'elle reste un lieu très marginal pour ce qui est de la création cinématographique. Laissons à la psychologie sociale le soin de se pencher un jour sur cet étrange paradoxe et bornons-nous à constater une carence au niveau des infrastructures: pas de studio, pas d'industrie cinématographique digne de ce nom. Dans un tel contexte, chaque film tient du miracle et ne peut être que le fait de francs-tireurs. D'un autre côté, avec un choix de films provenant du monde entier que lui offrent une trentaine de salles, le cinéphile du bout du lac n'a guère de quoi se plaindre: il est nettement mieux loti que la moyenne, ne serait-ce qu'helvétique. Si nul n'oserait ainsi vraiment affirmer que Genève "rayonne" dans le domaine du Septième Art, celui-ci y paraît encore bien vivant au moment de boucler son premier siècle.
Côté production, consommation ou passion, le cinéma genevois a désormais son histoire. On s'accorde à en faire remonter les débuts à l'Exposition Nationale de 1896, où furent projetées les premières images animées du Cinématographe Lumière, venu en voisin de Lyon. Dans la foulée de l'événement, d'obscurs "tourneurs de manivelles" commencèrent aussitôt à cinématographier toutes sortes de sujets, événements ou paysages locaux, tandis que s'ouvrait sur la plaine de Plainpalais (angle rue du Vieux-Billard — avenue du Mail) la première salle de cinéma du pays: l'"Alpineum" de Maurice Andréossi. Ce dernier dut cependant fermer en 1899, laissant le nouveau-né faire ses premiers pas en tant qu'attraction foraine.
La production: l'Artisanat ou l'Exil
La première tentative de cinéma de fiction helvétique dont on ait retrouvé la trace (à défaut d'une copie) est vaudoise et date de 1908: Genève était pourtant déjà partie prenante dans Une aventure de Redzipet, réalisée par le "primitif" Albert Roth-de Marcus, par le biais du fantaisiste Paul-Jean Motz qui y tenait le rôle-titre. Mais tout commence réellement avec la Première Guerre mondiale. Démobilisé pour cause de santé, le célèbre comique français Max Linder vient tourner, en 1915, deux de ses films, dans un atelier du Petit-Lancy. Deux ans plus tard, c'est le cinéaste-aventurier danois Alfred Lind qui débarque dans le même studio de fortune pour y tourner le Cirque de la mort, film qu'il emmènera avec lui sitôt la guerre terminée... pour lui faire acquérir la [p. 96] nationalité allemande. Mais cette fois, une véritable impulsion a été donnée et ses jeunes collaborateurs, Léon Tombet et Robert Florey (ce dernier, un Français à l'aube d'une belle carrière hollywoodienne), réalisent, en 1919-1920, quatre petits films alternant entre comédie sentimentale et burlesque à l'américaine: Jackie se marie, Isidore a la déveine, Une heureuse intervention et Isidore sur le lac. Hélas, le marché est déjà encombré et l'initiative ne rencontre qu'indifférence. Les réalités financières ont raison de l'enthousiasme de Tombet, tandis que Florey décide de voir plus grand ailleurs. Reprenant le flambeau, leur ami Charles-Emile Sauty ne "flambera" lui aussi qu'une saison: en 1923, il réalise tour à tour un burlesque (Polydor détective), un documentaire (A travers Genève) et un mélodrame (Zora l'endiablée), produisant, à temps perdu, l'amusant long-métrage Le Satyre du Bois-Gentil du Morgien Alfred Gehri, avec en vedette le journaliste et futur politicien d'extrême-droite Georges Oltramare. Mais Sauty ne parvient pas à rentrer dans ses frais et doit mettre la clef sous la porte de la grande verrière du Petit-Lancy, laquelle retrouvera dès lors une affectation plus prosaïque.
Un peu plus tard, en 1924, le critique (à La Suisse et ami d'Oltramare) Jean Choux tourne, sur la Riviera vaudoise, La Vocation d'André Carel (ou La Puissance du travail), petit mélodrame édifiant qui marque aussi les débuts à l'écran d'un autre Genevois, l'illustre Michel Simon. Tous deux s'empresseront de poursuivre leur carrière à Paris, où les attire une avant-garde autrement stimulante. Ils s'y retrouveront en 1931 pour Jean de la Lune, d'après Marcel Achard, puis leurs chemins se sépareront, menant l'un vers l'oubli et [p. 97] l'autre vers la gloire. Autre talent du crû à choisir l'exil, le touche-à-tout Jean Gehret fait l'acteur chez Jean Renoir en attendant de passer à la réalisation (en 1946). Marqué par ces défections répétées, le cinéma genevois entre alors dans une longue période de léthargie qui s'étend sur près de quatre décennies.
Une longue période de léthargie
Seul, mais inébranlable, Jean Brocher assure l'intérim en bâtissant de 1927 à 1955 une "oeuvre" artisanale, hygiénique et moralisatrice riche de quinze longs-métrages (hors-commerce et commandités par diverses institutions). De La Bourse et la vie à Le Bal de Castel, tout y est réputé irregardable!
Genevois d'adoption, le Neuchâtelois Arthur Porchet a quant à lui réalisé en 1922-23 un drame alpestre (L'Appel de la montagne) avant de devenir l'opérateur romand le plus coté du moment. Lui aussi va poursuivre sa carrière à l'étranger, en France et en Espagne. Il est de retour en Suisse à l'aube de la guerre — avec ses fils Adrien et Robert, nés à Genève et qu'il a formés — pour réaliser quelques médiocres bandes patriotiques, telle cette Oasis dans la tourmente (1941) à la gloire de la Croix-Rouge. De cet étrange parcours, on retiendra, ici, surtout qu'en 1928, Porchet a également fondé, avec l'ingénieur-chimiste Alfred Masset, l'entreprise Cinégram S.A.: celle-ci est aujourd'hui encore l'un des principaux laboratoires de film (développement, tirage, etc...) de Suisse.
Comme la Première, la Deuxième Guerre mondiale amène à Genève son lot de réfugiés. Louis Jouvet et Max Ophuls projettent de tourner ensemble, au Grand-Théâtre, L'Ecole des femmes de Molière, mais ils se brouillent et laissent le film inachevé. Autre hôte de marque, le Belge Jacques Feyder réalise son décevant dernier film Une femme disparaît (1942) en partie dans les environs de Genève, où il aura sa première. Mais ce ne sont pas ces sursauts isolés qui permettront de lancer une dynamique de production locale. Pendant presque vingt ans, Genève devra se contenter d'abriter le siège du très officiel "Ciné-Journal Suisse", deuxième du nom — avant que l'avènement de la télévision ne sonne le glas de ce type d'actualités projetées dans les salles en avant-programme.
C'est seulement en 1955 qu'un court-métrage réalisé par un certain Jean-Luc Godard annonce un renouveau: adapté d'une nouvelle de Maupassant et filmé en grande partie sur [p. 98] l'Ile Rousseau, Une femme coquette fait souffler un vent de jeunesse sur l'austère cité de Calvin. Le cinéaste suisse (qui est né à Paris, mais a fait ses écoles à Nyon) reviendra en 1960 pour son second long-métrage, Le Petit soldat, sans doute le meilleur film jamais tourné à Genève. Un argument d'espionnage sur lequel plane l'ombre de la Guerre d'Algérie (sujet alors tabou en France) introduit l'image d'une ville cosmopolite et riche d'intrigues de toutes sortes. Entre-temps, seule une tentative peu convaincante de polar, La Peur du silence (1958), aura vu le jour. Son auteur, Claude Rudane joue de malchance: son film est mis sous séquestre pour n'avoir pas respecté certaines demandes d'autorisation et aucun de ses projets suivants ne pourra être mené à terme. Le cinéaste zurichois Nicolas Gessner sera plus heureux avec sa comédie policière Un milliard dans le billard (1965), située au bout du lac, mais filmée également à Lausanne et Paris. Une production internationale et un franc succès public lui ouvrent les portes d'une carrière internationale. Cette période creuse voit aussi le bourlingueur genevois Paul Lambert ramener d'un de ses voyages son plus fameux documentaire, le long-métrage Fraternelle Amazonie (1964).
"L'Ecole Genevoise"
C'est durant la décennie suivante que Genève connaît son heure de gloire cinématographique. Sur les talons de la "Nouvelle vague" française — à laquelle participe Godard — germe, dans la plupart des pays européens, le mouvement des "nouveaux cinémas", jeunes, libres, inventifs et irrévérencieux. En Suisse, le ton est donné par les Genevois Alain Tanner, Claude Goretta et Michel Soutter, qui rongeaient leur frein au service de la Télévision Suisse Romande, nouvellement installée à Genève. En compagnie de Jean-Louis Roy (auteur, en 1966, du film d'espionnage L'Inconnu de Shandigor, ouvrage-charnière du cinéma suisse) et Jean-Jacques Lagrange, ils constituent d'abord le "Groupe 5", plate-forme de production indépendante qui bénéficie d'appuis à la TSR puis, le succès venant, voleront de leurs propres ailes vers une reconnaissance à l'étranger. Charles mort ou vif, La Salamandre, Le Retour d'Afrique, Jonas qui aura 25 ans en l'an 2000 (Tanner), Le Fou, L'invitation, Pas si méchant que ça (Goretta), Haschich, James ou pas, Les Arpenteurs et L'Escapade (Soutter) forment le premier volet local de ces oeuvres non négligeables, marquées à l'origine par l'esprit contestataire de Mai 68. La banlieue et la campagne Genevoise y font leur apparition, tandis que sont révélés des [p. 99] comédiens tels que François Simon, Jean-Luc Bideau, Jacques Denis et Roger Jendly, ainsi que le musicien Arié Dzierlatka et l'opérateur Renato Berta. De ce bref moment de grâce émerge même une compagnie de production digne de ce nom, Citel Films, cependant bientôt reconvertie dans le marché, plus sûr, de la distribution.
La reconnaissance d'une "école de Genève" profite à d'autres jeunes cinéastes locaux lesquel, moins doués, rentreront néanmoins vite dans le rang... de la télévision: les Yvan Butler (La Fille au violoncelle), Simon Edelstein (Les Vilaines manières), Alain Bloch et autre Jean-Bernard Menoud. Enfin, les années 80 voient l'arrivée d'une nouvelle génération qui peine à trouver ses marques: Léo Kaneman, Bertrand Theubet, Daniel Calderon, Pierre Maillard, Michel Rodde, Véronique Goël et Patricia Plattner. Dans une tentative d'échapper à un cinéma souffrant d'amateurisme, fortement subventionné et sans audience, Dominique [p. 100] Othenin-Girard (After Darkness, 1984) se lance dans l'aventure du cinéma hollywoodien de "série B", mais est de retour quelques années plus tard. Parmi les derniers venus qui ont encore l'avenir devant eux, on peut citer Daniel Schweizer, Jacob Berger, Nicolas Wadimoff et Antoine Plantevin. Seul à porter le flambeau du cinéma d'animation (genre délaissé, dont la première tentative, L'Histoire de Monsieur Vieux-Bois d'après Rodolphe Tôpffer, remonte à 1921), Georges Schwizgebel poursuit quant à lui une remarquable série de courts-métrages commencée en 1974.
Les étrangers dans la Cité
Longtemps négligée par le cinéma international, notre ville est devenue, à partir des années 60, le cadre occasionnel de productions étrangères. Mais qui se souvient aujourd'hui des La Mort de Belle (Edouard Molinaro), Sette uomini d'oro (Marco Vicario), Il dolce corpo di Deborah (Romolo Guerrieri), In Search of Gregory (Peter Wood) et Mister Superinvisible (Anthony Dawson)? Genève y apparaît invariablement comme une ville prospère et bourgeoise, lieu d'affaires et d'intrigues. Les organisations internationales, les banques et la rade semblent avoir la faveur des cinéastes. Vision qui peut prêter à sourire — de même que les fréquentes fantaisies topographiques que se permettent les auteurs —, mais indicative d'une réputation. Plus récemment, La Diagonale du fou (Richard Dembo, 1984), Le Caviar rouge (Robert Hossein), L'Insoutenable légéreté de l'être (Philip Kaufman), Mangeclous (Moshe Misrahi), I Love $ (Johan Van der Keuken) et Rouge (Krzystof Kieslowski, 1994) ont quelque peu creusé cette image trop caricaturale. Ancien assistant de Tanner, le Français Bertrand van Effenterre est finalement le seul étranger à avoir réalisé une fiction réellement ancrée dans le cadre genevois (Erica Minor, 1973), tandis que le documentariste François Reichenbach s'est fourvoyé dans l'image touristique pour l'un de ses derniers travaux de commande, sobrement intitulé Genève.
Mentionnons encore que Genève a aussi servi de point de départ, de passage ou d'arrivée fugitif dans les films suivants: Vie privée (Louis Malle), Vaghe stelle dell'Orsa (Luchino Visconti), Kaleidoscope (Jack Smight), The Cassandra Crossing (George Pan Cosmatos), Bloodline (Terence Young), The Holcrofi Covenant (John Frankenheimer), F / X (Robert Mandel) et Indochine (Régis Wargnier). Seule Zurich, carrefour de l'espionnage international dans l'imaginaire des scénaristes, peut, dans notre pays, rivaliser avec ce palmarès.
[p. 101]
Projection-Passion
Mais la vie du cinéma, c'est aussi son public, autrement dit les salles et leur fréquentation. Genève a toujours bénéficié d'un parc de salles enviable (si l'on considère la taille de la ville) et d'une distribution qui échappe au provincialisme. Le plurilinguisme helvétique et le statut de ville internationale y sont sans doute pour quelque chose, permettant en particulier la diffusion de films venus d'horizons très divers, dans leur langue originale avec sous-titres.
Le nombre des salles est resté remarquablement constant depuis les années quarante — entre 25 et 32 salles, offrant autour de 8.000 places — pour une fréquentation un peu plus fluctuante: alors que durant les années fastes (de 1956 à 1964), on avait pu compter plus de quatre millions d'entrées payantes, ce chiffre est aujourd'hui retombé aux deux millions des années de guerre. Mais il faut reconnaître que le public genevois a mieux résisté que la plupart de ses homologues étrangers aux assauts successifs de la télévision, de la vidéo et du câble.
La première véritable salle de cinéma (le "Grand Cinématographe Suisse") a ouvert ses portes en 1906 déjà, suivie quelques années plus tard par l'"Apollo-Théâtre" et le "Royal Biograph". Depuis, nombre de salles sont nées, ont vécu et ont disparu (les Elysée, Studio 10, Molard, Ecran, Classic et autres Corso traînent encore dans nos mémoires de cinéphile), alors que d'autres (Rex, Scala, Rialto) se sont transformées en "multiplex". Certaines (Empire, Splendid) se sont spécialisées, au milieu des années 70, dans le cinéma dit pornographique: purgatoire inévitable, mais pas éternel. Les plus anciens cinémas actuellement encore en exploitation sont le "Central" et l'"Alhambra", dont l'ouverture remonte [p. 102] aux années 1910. Enfin, tel un grand vaisseau échoué, le "Manhattan" de l'architecte Saugey attend sa remise à flots après une rude bataille qui déboucha sur sa protection par "classement" (1993).
Sans doute stimulé par un bouillonnement plus large de l'avant-garde artistique, le premier ciné-club du pays a vu le jour à Genève en 1928, mais n'a guère fonctionné que durant deux ans. Suit une longue traversée du désert. Avec l'installation à Lausanne de la Cinémathèque Suisse (1950), le désir de revoir d'anciens films et de militer pour une culture cinématographique se fait à nouveau sentir. En 1951, les étudiants Goretta et Tanner fondent le Ciné-Club Universitaire. Mais c'est à la faveur de la contestation de 68 que l'idée se généralise: des ciné-clubs apparaissent dans les collèges et autres écoles, à la Maison des Jeunes et de la Culture (MJC) de Saint-Gervais, à la Cité universitaire (Salle Patiño), etc... Surtout, c'est la création en 1973 du Centre d'Animation Cinématographique (CAC), salle "de répertoire" patentée, doublée (salles "Michel Simon" et "Henri Langlois") depuis son déménagement de la rue Voltaire à la Maison du Grütli, en automne 1988. Sans doute victime des progrès de la vidéo, le mouvement s'est malheureusement nettement tassé à la fin des années 80. Ses derniers-nés, Fonction: Cinéma (à la Maison du Grütli) et Spoutnik (à "L'Usine"), se sont chargés de défendre un cinéma résolument non-commercial.
Les sièges des maisons de distribution ont eu, quant à eux, tendance à quitter Genève — premier port d'attache de toutes les compagnies américaines, en particulier — pour Zurich. Longtemps privé d'un festival de cinéma "chez lui", le spectateur genevois a pu depuis les années septante prospecter dans la région: cinéma documentaire à Nyon, de comédie à Vevey, fantastique à Avoriaz (1973-1993), d'animation et italien à Annecy. Enfin, en 1988, un Festival de Genève a vu le jour à l'initiative de l'homme d'affaires Roland Ray. Lancé en plein âge d'or du "sponsoring", ce festival qui s'est donné pour mission de révéler les jeunes acteurs européens tarde toutefois à trouver une véritable identité.
La formation: parent pauvre
L'enseignement théorique du cinéma n'a jamais fait que balbutier à Genève: cours d'"Information Générale (IG)" au Cycle d'Orientation, cours facultatif dans certains collèges, incursions sans lendemain à l'Université. Si l'on considère les [p. 103] progrès de cet enseignement aux Etats-Unis ou en France, on s'aperçoit que la situation est grave: l'oubli de l'histoire de l'image se double d'un analphabétisme visuel de moins en moins tolérable.
Depuis 1977, l'Ecole Supérieure d'Art Visuel (ESAV) dispense des rudiments d'histoire et de théorie, mais sa section cinéma est essentiellement axée sur la pratique. A l'heure qu'il est, la Suisse ne dispose, à vrai dire, pas d'une cinématographie assez forte pour justifier une véritable école de cinéma. La tradition veut que nos cinéastes les plus ambitieux aillent se former à l'étranger.
Quant à la critique genevoise, trop soumise aux aléas de la presse quotidienne, son niveau moyen a toujours été plutôt faible. La presse spécialisée, elle, est restée quasiment inexistante exception faite de "Travelling" (1963-1980), revue petit format, mais riche d'approches les plus diverses. De parution irrégulière, elle fut un temps éditée à Genève avant de transférer définitivement son siège à Lausanne.
Que reste-t-il d'un siècle de cinéma à Genève? Peut-être pas grand-chose, mais tout de même la certitude qu'il y a eu, autour de 1970, un "moment" qui a compté. Et puis cet engouement apparemment intact pour les salles obscures, sur lequel peut se fonder une mémoire, une culture, voire un avenir. Avec une création qui s'est éteinte et rallumée assez souvent pour nous convaincre de ses ressources, le 7e Art genevois, même toussotant, devrait pouvoir relever le défi d'un second centenaire. N'en déplaise aux Cassandre, sa mort n'est pas pour demain.
N. Cr.
haut
[p. 104]
Arts et divertissements à la radio et à la télévision
"Les gens ont déjà des phonographes. Ils ne s'intéresseront pas à ces appareils à friture, bons pour les techniciens..." déclaraient, vers 1923, les opposants à la future radiodiffusion genevoise. Il ne faudra qu'une dizaine d'années pour contredire cette opinion, car, vers 1933, la Radiodiffusion est déjà devenue un phénomène qui touche la plus grande partie de la population de la région. D'un système utilitaire au début (radio-guidage d'avions), on est très vite passé à la réalisation de programmes permettant à la culture, au spectacle, à la musique, au divertissement et à l'information d'entrer dans tous les foyers. Et en attendant l'image, qui ne sera transmise que trente ans plus tard, l'imagination va suppléer immédiatement et efficacement à l'absence du petit écran.
Aujourd'hui, l'apport de la radiodiffusion et de la télévision aux arts de la scène devrait être considérable, mais il fait l'objet de polémiques. Côté auditeurs et téléspectateurs, les critiques sont nombreuses et parfois virulentes. Côté responsables, l'audimat, la comparaison avec les stations étrangères et les radiodiffusions et télévisions locales sont un souci permanent. Quelles que soient les critiques qui leur sont adressées, il est juste d'admettre que ce sont bien la radiodiffusion et la télévision qui, en diffusant des pièces de théâtre et des concerts, ont permis à un public nombreux d'accéder à la culture alors que, faute de moyens financiers, il ne pouvait se rendre dans les salles de spectacle.
L'existence de ces deux médias est due à des pionniers, puis à des responsables officiels qui ont très vite compris combien il est important de diffuser des manifestations scéniques, en plus de toutes les autres formes d'expression. Approchant à peine les trois quarts de siècle pour l'un et les quarante ans pour l'autre, ces deux nouveaux moyens d'expression n'en ont pas moins une histoire complexe et souvent passionnante.
Le destin éphémère des ondes électromagnétiques, porteuses des émissions dans l'espace, nous a fait perdre beaucoup d'émissions réalisées dans les années du "direct". Depuis 1934, les machines d'enregistrement permettent heureusement de garder un grand nombre de témoignages de l'activité des deux médias. Mais l'état de conservation des archives sonores et visuelles nécessite un travail de restauration long et coûteux qui a commencé dans les années soixante et s'est un peu renforcé récemment. C'est à ce prix que seront préservés des témoins de l'activité des médias électroniques de ce pays, essentiels à la connaissance de l'histoire. [p. 105]
La radiodiffusion à Genève
La technique — Un métier nouveau
Réduite, au début, à sa plus simple expression, la prise de son est effectuée avec un seul microphone. Faire "passer" un message artistique dans des conditions aussi rudimentaires relève de l'exploit. Aucun appareil d'enregistrement n'étant apparu sur le marché, les émissions doivent se faire exclusivement en direct. Et très tôt, la diffusion d'oeuvres scéniques et musicales par la TSF, devenue la Radiodiffusion, pose des problèmes inconnus jusqu'alors. Les artistes sont méfiants. Comme au début du phonographe, ils critiquent sévèrement la qualité des premières émissions. De plus, ils sont paralysés par une nouvelle source de trac: le microphone. Cet instrument diabolique ne tolère aucune défaillance; s'il s'en produit une en direct, elle sera vite oubliée, mais plus tard, quand elle sera gravée sur disques, elle figurera pour longtemps dans les archives sonores... Mais bientôt les artistes comprennent qu'en une seule diffusion la radio touche des dizaines de milliers d'auditeurs, bien plus que dans la plus vaste salle de spectacle. Et puis l'augmentation des microphones, en nombre et en qualité, va permettre d'améliorer progressivement les émissions.
Il n'en est pas encore de même au niveau de la réception. Au début, les "sans-filistes" construisent souvent eux-mêmes leurs récepteurs et guettent toutes les améliorations technologiques possibles. Car les émissions sont difficiles à capter, les casques d'écoute blessent les oreilles, les haut-parleurs sont anémiques et les phonographes sont nasillards. Le bras lecteur électrique de disques (pick-up) n'étant pas encore commercialisé, on se contente de placer un microphone directement à la sortie du pavillon du phonographe. Cela ne gêne pas trop les mélomanes courageux qui reçoivent déjà des transmissions d'importance européenne, comme celles de Bayreuth.
Au studio, le technicien de service communique avec les artistes au moyen d'un tableau lumineux qui donne des ordres impératifs: "soliste trop près", "soliste trop loin", "accompagnement trop faible", "BON"! Un autre tableau interdit l'entrée du studio par les mots: "SILENCE, EMISSION"! L'émetteur de Sottens donne enfin, en 1931, une plus grande portée au rayonnement des ondes. Les émissions durent huit heures par jour; la propagande auprès des auditeurs et la lutte contre les perturbations (parasites) s'organisent et sont confiées à la Fondation Pro Radio. Quelques amateurs tentent des transmissions lointaines [p. 107] avec l'Amérique. La mise en service de la télédiffusion (réception par fil) améliore la qualité de la réception à domicile.
Peu à peu diverses salles de théâtre, de concerts, des églises sont reliées au studio par des lignes téléphoniques qui permettent de transmettre les manifestations qui s'y déroulent. L'apparition de graveurs sur disques de qualité, en 1934, va enfin permettre la constitution d'archives sonores "maison" et la diffusion en différé de certaines émissions. Complément attendu de ces équipements, une première voiture de reportage, reçue en 1936, offre de nouvelles possibilités d'émissions ou d'enregistrements hors des studios: de quoi combler les auditeurs sportifs qui entendent pour la première fois la retransmission en direct du Tour de Suisse cycliste et de nombreuses autres manifestations.
Des pionniers aux spécialistes
Pendant la Guerre 1939-45, les techniciens sont surchargés. Les producteurs cherchent "comment faire mieux et plus avec moins d'argent..." Une consolation cependant: Radio-Genève occupe sa "Maison de la Radio" en 1940. Les conditions de travail sont maintenant à la mesure des problèmes posés par l'augmentation du nombre des émissions, par l'audience du studio genevois et par les légitimes ambitions de ses dirigeants. Dès 1950, des nouveautés techniques capitales améliorent sensiblement la qualité des diffusions: le disque de longue durée, la bande magnétique, la modulation de fréquence et plus tard le transistor. La qualité s'améliore aussi chez l'auditeur, car les récepteurs permettent des performances remarquables. [p. 108]
Les années 1954 et 1955 voient se dérouler à Genève une importante série de conférences internationales: Conférence sur l'Indochine, Conférence des Quatre Grands, Conférence sur l'utilisation de l'énergie atomique à des fins pacifiques. Ces manifestations vont nécessiter l'aide des autres studios suisses car, pour satisfaire les demandes de tous les correspondants de nombreux pays, Radio-Genève doit mettre à disposition des locaux et des techniciens par dizaines et réaliser des transmissions par centaines.
Bientôt, la miniaturisation des appareils et le magnétophone portatif multiplient les possibilités de travail "hors les murs", souvent dans des conditions acrobatiques. L'apparition du disque compact audio-numérique prélude à la future numérisation de toutes les installations. La stéréophonie fait son apparition en 1986 et sera bientôt utilisée sur toutes les chaînes. Elle contribue au plaisir d'une réalité acoustique nouvelle et à une définition plus précise des espaces scéniques.
Les programmes
En 1925, les programmes se composent d'informations, de chroniques, mais aussi de comédies et de transmissions musicales de l'Orchestre de Genève, trio composé d'un violon, d'un violoncelle et d'un piano! Suivront de près des émissions pour les enfants par Oncle Henri (Henri Baumard), des cultes (Frank Thomas), des reportages sportifs par Squibbs (Me Marcel Suès) dont la voix aiguë captivera les auditeurs. De nombreuses émissions consacrées aux travaux de la Société des Nations préfigurent la future mission internationale de Radio-Genève. La première Messe de minuit est transmise en 1927 et sera captée par près de 2.000 récepteurs.
La même année est constituée l'Association des Amis de Radio-Genève et un jeune ingénieur, Henri Ramseyer, commence une étonnante carrière au studio genevois. Chargé de travaux techniques, il annonce aussi les programmes et diffuse des disques commerciaux (souvent prêtés par des magasins de la ville à condition qu'on cite la marque et les prêteurs). Devenu l'homme-orchestre du studio, il sera rapidement et affectueusement surnommé "Anatole", alors que sa collègue de Radio-Lausanne répondra au prénom d'"Hortense".
Les auditeurs écoutent avec plaisir les concerts du Café du Nord, où se produit l'excellent violoniste François Capoulade; l'orchestre est dirigé par Isidore Karr. De son côté, Edmond Appia anime les galas de la Couronne et dans le domaine des variétés l'orchestre, Illaraz se produit au [p. 109] Fantasio. Vers 1928, commencent des diffusions régulières de "jeux radiophoniques", cabarets, concerts symphoniques, cultes et messes.
Une convention est conclue avec l'Orchestre de la Suisse romande, en 1932, qui permet à la Radiodiffusion de diffuser des concerts et de faire appel à l'orchestre pour des enregistrements. La même année, on crée des concours d'oeuvres littéraires ou musicales spécialement écrites pour la radio. La troupe du théâtre de la Comédie donne chaque semaine des extraits de ses spectacles, en choisissant des oeuvres ou des scènes aussi "radiogéniques" que possible. En 1933, la Radiodiffusion est devenue une grande vedette, mais elle n'oublie pas sa mission pédagogique et des essais d'émissions radioscolaires ont lieu aux studios de Lausanne et de Genève. Peu à peu se précisent les deux principales activités de la radiodiffusion: la production d'émissions propres et la transmission d'événements artistiques de l'extérieur.
Toujours plus et toujours mieux
Apparaissent alors des personnages importants qui, comme en cinématographie, vont réaliser et coordonner la partie artistique des émissions. Dans le domaine des productions parlées (et généralement théâtrales), le metteur en ondes dirige les acteurs, groupés parfois sous l'appellation "Troupe du radio-théâtre". Il est assisté par un spécialiste du bruitage. Ce personnage indispensable est capable de produire, en direct, une grande quantité de bruits à l'aide des matériaux les plus imprévus. Il sait imiter à la perfection le crépitement du feu au moyen d'une feuille de cellophane habilement froissée; il tire des coups de feu sur commande, ouvre et ferme des portes, fait grincer des fenêtres, met en marche des moteurs et bien d'autres choses encore, en parfaite synchronisation avec le texte. En musique, le régisseur ne dirige pas les artistes, qui ont leur propre style d'exécution et sont souvent conduits par un chef d'orchestre. Il s'agit surtout, ici, de réaliser un équilibre correct et pour ce travail, le régisseur doit naturellement posséder une excellente oreille. Les amateurs d'émissions de variétés ne sont pas oubliés et peuvent se divertir à l'écoute des célèbres sketches "Fridolin et son copain" écrits par Ruy-Blag. Et chaque soir, Anatole diffuse un disque amusant et très attendu: Le Petit train, qui devient l'indicatif de fin des programmes du soir de Radio-Genève. A l'occasion des dix ans de Radio-Genève, en 1935, Arthur Honegger produit Radio-Panoramic, première d'une série de commandes à des compositeurs suisses. En 1937, l'Orchestre
[p. 110] de la Suisse Romande est attribué à Genève; Radio-Genève en bénéficie, sa production musicale atteint un niveau très élevé, grâce en particulier à Ernest Ansermet.
Faisant oeuvre de mécène, Radio-Genève s'efforce de produire des oeuvres rares ou peu jouées: grands classiques du théâtre, oeuvres lyriques oubliées, oeuvres anciennes ou contemporaines qui n'ont pas trouvé la faveur d'éditeurs ou d'associations de concerts. Les chorales, fanfares et harmonies du Canton se produisent périodiquement et dans le domaine des variétés, l'orchestre Bob Engel, le groupe vocal "Les Ondelines de Radio-Genève" et divers spectacles de cabaret animent certaines soirées. De nombreuses vedettes de la scène, du music-hall et de l'écran se produisent au Kursaal; Radio-Genève profite de leur présence, les invite dans ses studios pour des interviews ou pour les faire participer à des émissions.
Expansion et rayonnement
En 1938, commencent des retransmissions de certains spectacles du Grand-Théâtre. Dès le début de la Deuxième Guerre mondiale, des émissions spéciales sont destinées aux soldats et à leurs familles. Après une brève fermeture du studio, les émissions reprennent et de nombreux artistes suisses rentrent au pays et font bénéficier de leur talent les deux studios romands. D'ailleurs, depuis peu, Radio-Genève n'utilise plus que des comédiens professionnels.
Peu à peu, tous les genres sont abordés: arts, sciences, littérature, musique, théâtre, information, religion, sports, etc. Avec des moments particulièrement importants: Exposition nationale suisse de 1939, Entrée en guerre des pays voisins, Mobilisation générale et élection du général Henri Guisan, Six-cent-cinquantième anniversaire de la Confédération en 1941, émissions pour la Croix-Rouge, Festival de musique de Lucerne, Concours international d'exécution musicale à Genève, etc.
Pendant la guerre, Radio-Genève atteint une audience européenne, en particulier grâce à sa chronique sur la situation internationale, tenue par René Payot. Il renseigne objectivement les auditeurs de l'étranger, qui captent souvent Radio-Genève au péril de leur vie. Le 8 mai 1945, jour de l'armistice, Radio-Genève diffuse un oratorio de Frank Martin, In Terra Pax, enregistré en prévision de la paix.
Le nombre d'émissions nées à cette époque est impressionnant et quelques titres évoqueront certainement des souvenirs chez nos aînés: le Mercredi symphonique, Questionnez, on vous répondra, l'Heure variée, le Rail, la route, [p. 111] les ailes, l'Heure universitaire, les Travaux de l'UNESCO, les causeries-auditions, les émissions publiques de variétés organisées par les Amis de Radio-Genève, désormais présidés par André Fasel. La pièce policière du lundi, animée dès 1946 par le trio Durtal-Gallois-Picoche, imprimera un style nouveau à cette catégorie de productions. En raison de son succès, ce trio, devenu célèbre, quittera parfois le microphone pour se produire sur scène. En 1948, Colette Jean commence une longue collaboration avec Radio-Genève, par des "Bonjours matinaux", bientôt suivis d'innombrables émissions de variétés. Le Prix Italia, créé en 1949 à Venise, récompensera souvent des productions de Radio-Genève. Le besoin d'informations internationales augmentant sans cesse, des correspondants sont désignés à Paris et à New York. Des émissions nouvelles continuent d'apparaître: Université des ondes (1949), Club d'essai de Radio-Genève (1954), Année Mozart (1956), Sur les scènes du monde (1959), Diorama de la musique contemporaine (1964), etc.
Intégré en 1964 à la Radio Suisse Romande, puis en 1973 à la Radio-Télévision Suisse Romande, le studio de Genève participe à des opérations importantes: "Vive la Radio" pour les 25 ans de la Communauté radiophonique des programmes de langue française (1980), mise en place d'un programme de nuit (1981), expérimentation d'un programme en langue anglaise (1982), premier programme en stéréophonie (1986). Malgré les diverses restructurations qu'il a subies, dont la plus récente est la séparation de la radiodiffusion et de la télévision, le studio de Genève, même privé d'une partie de ses moyens, continue d'exister en 1994.
La télévision à Genève
La technique — Le début d'une grande aventure
En 1952, faute de caméras électroniques et surtout d'émetteur, les premières productions sont réalisées sur des caméras Paillard-Bolex 16 mm et sont projetées devant un public qui ignore qu'il s'agit d'une diffusion en circuit fermé... Le son est enregistré sur les premiers magnétophones autonomes Nagra, et post-synchronisé selon le système du "son couché", simple piste magnétique collée sur la pellicule cinématographique. L'année suivante un émetteur fourni par l'Institut de physique et un télécinéma permettent enfin de diffuser les sujets tournés sur film, en les transformant en images électroniques. L'acquisition, en 1954, d'une caméra à son optique et l'arrivée d'un premier car de reportage (primitivement [p. 112] attribué à Lausanne) donnent aux techniciens la mobilité qu'ils attendent et la possibilité d'utiliser des caméras électroniques pesant... 40 kilos! La longueur des câbles autorise des liaisons jusqu'à 300 mètres.
En 1955, un studio de télévision est aménagé au boulevard Carl-Vogt, dans une extension de la Maison de la Radio. Longtemps provisoire et rudimentaire, l'équipement des locaux techniques sera très vite baptisé "la Régie Pavatex". Ce qui n'empêche nullement un travail très intense, dont la production d'une dramatique par semaine. Les émissions sont diffusées par le nouvel émetteur de la Dôle, dans une qualité nettement améliorée. Utilisé dès 1958, le Kinéscope permet désormais d'enregistrer sur pellicule cinématographique certaines productions électroniques. Mises en archives, des émissions pourront être conservées ou reprises pour des diffusions ultérieures ou pour des échanges avec l'étranger. En 1960, le magnétoscope fait son apparition. Il permet l'enregistrement magnétique d'images de toutes provenances, cinématographiques ou électroniques. Mais les équipements sont complexes, lourds et encombrants, et l'image électronique a encore quelques progrès à réaliser.
La maîtrise du métier
Le satellite Telstar autorise, dès 1962, des transmissions qui couvriront bientôt la planète entière; les performances techniques de ce nouveau moyen de télécommunication prendront tout naturellement le nom de Mondiovision. Si les [p. 113] techniciens sont enthousiastes, les dirigeants sont inquiets, car le satellite ouvre la voie à la réception d'un grand nombre de chaînes et va permettre au téléspectateur, déjà très critique, de comparer facilement ce qui se fait ailleurs! L'adoption du système PAL en 1967 et l'introduction de la couleur en 1968 sont des étapes techniques capitales. Et en 1969, un événement à peine croyable se déroule en direct en Mondiovision: le spectacle des premiers hommes sur la lune.
L'acquisition d'un premier car couleur en 1971 et l'adaptation des installations à cette nouveauté très attendue nécessite un travail considérable, effectué avec compétence par le personnel technique. Très appréciée également, l'installation dans la Tour du quai Ernest-Ansermet, en 1972, donne à la Télévision un instrument de travail technique, artistique et administratif enfin comparable à ceux d'autres pays. En 1977, apparaissent des équipements de vidéo légère: les nouvelles caméras électroniques pèsent cinq kilos, les magnétoscopes portatifs quinze kilos, mais surtout les techniciens ne sont plus gênés par des fils. Le son stéréophonique est utilisé dès 1988 et bien d'autres nouveautés techniques vont se succéder jusqu'à nos jours, dont on ne citera que les principales: format d'écran 16/9, numérisation des transmissions, télévision à haute définition, multiplication du nombre de chaînes, récepteurs adaptés à la compression des signaux diffusés.
Les programmes — Faire de la télévision
Un sondage d'opininon réalisé en 1959 aux Etats-Unis a permis de dresser la liste des objets considérés comme les plus nécessaires par les personnes interrogées, par ordre d'importance: la télévision, l'armoire frigorifique, la cuisinière, la machine à laver et... le lit. En tête des "nécessités" dans certains pays, la télévision est aussi la cible privilégiée des définitions, des plus élogieuses aux plus méprisantes: spectacle du monde à domicile, reflet de la réalité, instrument d'information, de culture et de divertissement, propagatrice de débilité, moyen de crétinisation des masses, etc. Il est certain que l'apparition de la télévision a provoqué des modifications profondes dans les rapports humains et familiaux, les idées et les goûts, des plus élevés aux plus médiocres.
A Genève, malgré la modestie des premiers moyens à disposition, les sujets ne manquent pas. Ainsi, en 1952, les programmes comportent des championnats sportifs, des conférences internationales, les Fêtes de Genève, Raymond Lambert, etc. On assiste à l'arrivée, à Cointrin, de Charlie [p. 114] Chaplin fuyant l'Amérique de Mac Carthy. La première speakerine de la télévision genevoise se prénomme Arlette. Faute de moyens d'enregistrement, les "dramatiques" ont lieu exclusivement en direct et les incidents qui se produisent parfois sont inquiétants et irréparables. C'est ainsi qu'un soir, un comédien saute du premier au troisième acte d'une pièce et que tous ses camarades enchaînent avec lui. Les téléspectateurs ont dû se passer du deuxième acte! Mais bientôt on utilisera une caméra à son optique pour certaines productions théâtrales ou pour filmer "en sonore" des diffusions musicales importantes comme le Concours international d'Exécution musicale.
Déjà très appréciés, les jeux et les concours occupent une place de choix dans les programmes. "Echec et mat", qui passionne les téléspectateurs, devient hebdomadaire dès 1957. La même année, le premier Concours Eurovision de la chanson ouvre une longue série de manifestations qui nécessitent des dispositifs scéniques et techniques de plus en plus complexes. Mais les moyens financiers sont faibles, ils ne permettent pas encore de payer les déplacements des célébrités que la Télévision souhaite enregistrer. Pour cette raison, les interviews ont souvent lieu à l'aéroport de Cointrin, généralement entre deux avions. On enregistre des productions lyriques dans les locaux du boulevard Carl-Vogt et désormais l'alternance des spectacles (dramatiques, comédies, opéras, opérettes), des concerts et des productions cinématographiques s'établit peu à peu. Comme dans d'autres pays, on constate que la demande de films est en constante augmentation, conséquence du goût du public pour les fictions.
"Abracadabra" marque, en 1960, le début des émissions de variétés. En 1963, les diffusions commencent à 19 heures et parmi les émissions produites, on se souviendra encore de quelques titres: Madame TV, Carrefour, Calendrier de l'histoire, Oui ou non, la Suisse au vingtième siècle, Soir-Information, Continents sans visa, les Causeries d'Henri Guillemin, etc. Certaines manifestations d'une ampleur exceptionnelle sont diffusées par la Télévision, absorbant la plus grande partie des forces de l'entreprise. C'est le cas pour l'Exposition Nationale Suisse de 1964, la Fête des Vignerons en 1977 et pour diverses joutes sportives qui mobilisent longuement le car et son équipe spécialisée dans les transmissions extérieures. Ces périodes de travaux intenses valent à de nombreux collaborateurs de recevoir la juste récompense de leur talent et de leurs efforts sous la forme de distinctions nationales et internationales: Prix Eurovision, Prix Italia, Rose d'or de Montreux, Prix Ondas, Prix du Festival de Cannes, etc. [p. 115: image / p. 116]
Des moyens pour quel avenir?
L'introduction, en 1965, de la publicité à la Télévision va lui donner de nouvelles et bienvenues ressources financières. Le nombre d'heures d'émissions continue à augmenter et dès 1978, on peut enclencher son récepteur à 17 heures. Les transmissions d'opéras donnés au Grand Théâtre de Genève débutent, en 1979, par une représentation de La Flûte enchantée de Mozart. L'événement est transmis en Eurovision pour la télévision et en stéréophonie pour la radio. Mais la concurrence se renforce et les téléspectateurs pourront capter une chaîne de télévision par abonnement installée en Suisse romande, au bénéfice depuis 1983 d'une concession provisoire.
Depuis plusieurs années, les émissions se multiplient et certaines productions ont atteint une audience importante auprès d'un public cultivé: Emissions pour la jeunesse, Destins, Un jour une heure, Table ouverte, Tell quel, Spécial cinéma, Temps présent, Viva, Festivals de jazz et de musique classique, Télescope et bien d'autres émissions. Mais l'audimat commande et comme dans d'autres pays, on peut déplorer l'invasion de jeux, séries et feuilletons dont la débilité se mesure souvent au nombre d'épisodes. "Agrémentées" de rires automatiques et d'applaudissements enregistrés, ces productions prennent de plus en plus de place dans les programmes. Le vocabulaire professionnel s'enrichit de mots nouveaux: reality show, talk show, sitcom, produit, audience, part de marché. Et que dire de la publicité (20 pour cent du budget), de la place exagérée qui lui est accordée, de sa qualité discutable et du fait de son intrusion insupportable au milieu des émissions? La présence très marquée de la violence est signalée partout, comme la maladresse des émissions consacrées à la sexualité. Une réaction se dessine en vue de maîtriser ces tendances et la Télévision Suisse Romande modifie ses programmes dans le sens d'un ton général plus jeune, en tentant d'atteindre à un équilibre plus judicieux entre ses productions. Un grand espoir est né. Sera-t-il confirmé dans l'avenir?
Epilogue
Les structures mises en place en 1992 ont-elles un véritable avenir? La Télévision ne doit-elle pas repenser fondamentalement son programme? Un service public qui proclame son indépendance doit-il continuer d'imiter les chaînes étrangères? Ces questions ont une grande importance car aujourd'hui le "paysage audiovisuel" mondial se modifie au [p. 117] gré de la lutte de géants que se livrent certaines entreprises. Divers constructeurs sont devenus des distributeurs et ne cachent pas leur intention d'être un jour des diffuseurs de sons et d'images. Déjà des diffuseurs étrangers convoitent l'auditoire suisse.
L'apparition d'organismes privés "libres" jette une ombre inquiétante sur les diffuseurs officiels dans de nombreux pays. Le service public semble très menacé par l'arrivée de technologies dont le développemenmt est stupéfiant. Satellites, fibres optiques, banques de données géantes, diffusion à domicile de sons et d'images par abonnement, télévision interactive, réalité virtuelle et éventuel partage des redevances ne sont que quelques aspects d'un avenir très proche avec lequel la Suisse devra compter. Il est donc hautement probable que nos médias électroniques seront obligés avant longtemps de modifier encore leurs structures, leurs comportements et leurs prestations.
A. F.
haut
[p. 118]