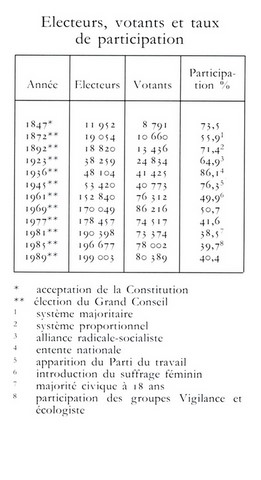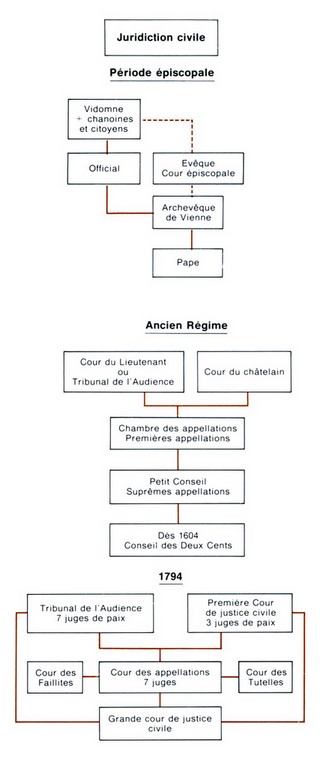La loi et la justice
Jacques Droin / Pierre Duparc / Raymond Foëx
Bernard Lescaze / Pierre Pittard / Dominique Poncet
Barbara Roth-Lochner / Jean de Senarclens
Les anciennes législations
[p. 135]
Le droit romain
Après la soumission des Allobroges, vers 120 avant notre ère, Genève entra pour plus de cinq siècles dans l'orbite de Rome. Il était donc normal que le droit romain y fût reçu. Sous deux réserves cependant. La première vient de la survivance de coutumes antérieures: qu'on invoque un hypothétique "droit ligurien" ou un incertain droit alpin, on doit retenir la probable persistance d'usages locaux dans un "droit vulgaire", phénomène connu dans diverses parties de l'Empire romain. La deuxième réserve dépend de l'application progressive du droit romain: ce dernier, réservé aux seuls citoyens romains, donc à un petit nombre, était complété par un droit prétorien et un droit pérégrin, bons pour les provinciaux ou les étrangers. Il y eut ainsi une propriété classique quiritaire, pour les citoyens, et une propriété provinciale ou pérégrine. Au cours du IIe siècle cependant, on relève une tendance à l'uniformisation du droit par les magistrats et dans les constitutions impériales; et en 212, un édit de Caracalla concéda le droit de cité à presque tous les pérégrins. Des usages locaux subsistèrent d'ailleurs, comme nous l'avons dit.
Les sources du droit impérial furent essentiellement des constitutions de l'empereur, auxquelles il faut ajouter, par exemple, les avis des prudentes, des jurisconsultes. La diversité des règles juridiques, leur accumulation, rendit nécessaire la réunion de celles-ci et leur classement méthodique. On rédigea donc des codes: le grégorien vers 291, l'hermogénien vers 293, et surtout le Code théodosien en 438. Ce dernier sera le véritable véhicule du droit romain à la fin du Bas-Empire et au-delà pendant le haut Moyen Age.
Les lois barbares
L'arrivée des Barbares bouleversa le système juridique romain. A Genève ce furent les Burgondes, après 443. Pour eux, qui venaient en troupes, en familles, il n'était pas concevable d'abandonner leurs coutumes, les règles qui régissaient leur statut personnel et familial, leur droit privé. D'autre part, les Gallo-Romains étaient convaincus de la supériorité de leur législation, mais ne pouvaient l'imposer. Chacun resta sur ses positions, conserva sa loi personnelle: c'est le système de la personnalité des lois, où le jus sanguinis remplace le jus soli, système qui ne pouvait être inconnu de Rome, comme on l'a vu à propos des pérégrins. [p. 136]
Les sources du droit de cette époque sont appelées lois, parce qu'elles furent mises par écrit sur l'ordre des rois burgondes; mais en fait ce sont des coutumes rédigées. Pour ses sujets burgondes, Gondebaud fit établir, vers 480-490, la Lex Burgundionum, encore appelée Liber constitutionum, Lex gundobada ou loi gombette; ce noyau primitif, ou Priores leges, fut complété par des constitutions royales de 501 à 534. La loi gombette survécut à la chute du royaume burgonde. Pour les sujets gallo-romains, Gondebaud fit rédiger, vers 502-508, une Lex romana Burgundionum, appelée parfois "Papien", par incompréhension et déformation du nom du jurisconsulte Papinien. Cette loi a comme composants essentiels le Code théodosien et les écrits de quelques jurisconsultes, mais comporte quelques variantes coutumières. Ce système présenta assez tôt beaucoup d'inconvénients, en particulier des incertitudes sur l'appartenance à telle ou telle loi après le brassage des populations et conflits de lois. Agobard, évêque de Lyon au IXe siècle, déplore le régime de la personnalité des lois, qui disparaît entre la fin du IXe et le XIe siècle.
La coutume
Alors s'élabora un droit nouveau. La personnalité des lois est remplacée par la territorialité des statuts, c'est-à-dire que tous les habitants d'un même territoire sont soumis aux mêmes règles. Mais, d'une part, ce changement se fait avec un morcellement géographique prodigieux; d'autre part, toutes les règles sont coutumières, la coutume étant un ensemble d'usages pratiqués de mémoire d'homme dans une région et ayant force contraignante. Ces règles coutumières sont d'une grande diversité; on peut les répartir en deux grands types, et Genève est à la limite de deux zones. Au nord et à l'est s'étendent les pays dits coutumiers, comme le Pays de Vaud, le comté de Bourgogne, le Valais; au sud les pays dits de droit écrit sont également coutumiers, mais imprégnés de droit romain, comme la Savoie et le Dauphiné. Genève, sous l'influence savoyarde, se rattache jusqu'au XIVe siècle aux pays de droit écrit. Une renaissance du droit romain s'était d'ailleurs manifestée grâce aux travaux des juristes de Bologne sur les textes nouvellement connus du Corpus juris civilis de Justinien et la pénétration de ce droit sur le revers occidental des Alpes au cours des XIIe et XIIIe siècles est bien connue. Mais assez tôt, dès les Franchises et dès le XIVe siècle, Genève va prendre ses distances vis-à-vis du droit romain comme de la Savoie.
[p. 137]
Les Franchises
Les anciennes Franchises de Genève sont connues par une rédaction officielle faite sous les auspices de l'évêque Adhémar Fabri (que l'on devrait normalement appeler Aimar Favre) en 1387. La date est tardive, puisque la communauté des habitants s'est organisée au cours du XIIIe siècle; mais les Franchises n'ont pas été octroyées par Adhémar Fabri: elles existaient antérieurement et leur mise par écrit est peut-être liée à des modifications du contenu et au financement d'une nouvelle enceinte. Dans le désordre de la présentation, trois groupes d'articles, trois aspects, peuvent être dégagés.
Comme dans tous les textes de ce genre, la procédure tient une place importante et permet de préciser quelles sont les institutions judiciaires. Le vidomne est le juge ordinaire des causes civiles et des délits mineurs; devant son tribunal est maintenue l'ancienne procédure coutumière, orale et en français, sommaire et sans frais, rejetant les formes rigoureuses du procès écrit; en outre pour le jugement, et surtout en matière pénale, au juge et à ses assesseurs sont associés de simples citoyens. Enfin, on trouve une tarification détaillée des peines suivant les délits, rappelant le "wergeld" barbare. Ainsi apparaissent le rejet des influences romaine et savoyarde, et le droit d'être jugé par ses pairs.
Les articles relatifs aux questions économiques forment un deuxième groupe. Plusieurs contiennent de simples règles de police relatives à l'urbanisme, aux poids et mesures, à certaines professions. D'autres sont caractérisés par un esprit libéral et favorable aux échanges commerciaux, par exemple le prêt à intérêt est pratiquement admis, puisque les usuriers peuvent transmettre leurs biens par succession.
Le troisième groupe d'articles est d'ordre politique, organisant une répartition des compétences entre l'évêque et la communauté. Sans compter les règles de procédure, on peut citer par exemple: le rôle des habitants en matière de sécurité publique avec la fermeture des portes et la garde nocturne; l'obligation de payer les contributions; le droit des habitants de nommer des syndics pour les représenter.
Quelques articles enfin, peu nombreux, traitent de points de droit civil: abandon par l'évêque du droit de bâtardise sur la succession des enfants illégitimes, mesure favorable au remariage des veuves avec suppression du délai de viduité. Mais il est évident que le droit de la famille et beaucoup de points relatifs à la condition des biens sont absents des Franchises. Les usages et coutumes en vigueur en ces matières, passées sous silence, relevaient du droit romain. [p. 138]
Ainsi apparaissent la variété et l'originalité des Franchises de Genève: règles coutumières, droit des affaires et droit romain mêlés.
P. Dc
haut
Les lois de l'ancienne République
L'adoption de la Réforme, comme la rupture des liens qui unissaient Genève à son prince-évêque et au duc de Savoie, entraînèrent un bouleversement des institutions genevoises. Ce dernier s'opéra graduellement entre 1527 et 1543.
Ces véritables révolutions politique, juridique et religieuse se marquèrent dans trois textes qui demeurèrent, jusqu'à la fin de l'Ancien Régime, en décembre 1792, la base du droit genevois, malgré plusieurs modifications, adjonctions ou suppressions. Il s'agit d'abord des Ordonnances ecclésiastiques, approuvées dans leur ultime version le 3 juin 1576, en Conseil général, mais qui datent, pour l'essentiel, du 20 novembre 1541. Ce texte était l'une des conditions mises par Calvin à son retour à Genève. Il règle, en quatre titres, l'organisation de l'Eglise de Genève et ses rapports tant avec la communauté des fidèles qu'avec le pouvoir politique. On y trouve aussi bien des dispositions de nature purement ecclésiastique sur les sacrements, les catéchismes ou les chants que des règles précises sur les empêchements au mariage, sur l'organisation du Consistoire, de même que sur la visitation des prisonniers. Mélange de droit ecclésiastique, de droit du mariage, de discipline, ces ordonnances, qui devaient être publiquement lues tous les cinq ans dans les temples à l'ensemble des fidèles assemblés, ont exercé une influence durable sur la vie de l'Eglise de Genève.
Deuxième texte fondateur, les Edits politiques, ratifiés par le Conseil général le 29 janvier 1568 dans leur version revisée par rapport à leur première version, approuvée le 28 janvier 1543, qui organisent les pouvoirs politiques dans la Seigneurie. Il s'agissait là d'une oeuvre originale en grande partie, bien qu'elle ne fit que compiler et améliorer des institutions mises en place au cours de la décennie précédente. Trois hommes y contribuèrent essentiellement. D'une part, Jean Calvin, d'autre part, le conseiller Claude Roset, d'une ancienne famille genevoise, enfin le docteur Fabri, jurisconsulte originaire d'Evian. La revision de 1568 fut conduite par Germain Colladon, conseiller juridique de la Seigneurie dans de nombreuses affaires civiles et pénales.
La structure des Edits politiques est relativement simple, puisque le texte prévoit, pour chaque institution ou charge, la [p. 139] manière de procéder à son élection, la forme du serment que doivent prêter tant les électeurs que l'élu, enfin quelques indications sur la nature des fonctions, prérogatives ou compétences attribuées. On ne peut qu'être frappé de constater qu'à la précision, voire la minutie, qui règle tant la procédure de désignation que les libellés des divers serments s'oppose un flou relatif quant à l'étendue des pouvoirs de chaque organe particulier. En réalité, les conflits de compétence, s'ils existent, sont peu nombreux, car au-delà des textes, il faut bien comprendre que la pratique constitutionnelle équivalait à une coutume bien établie.
De 1568 à 1707, le Conseil général ne fut convoqué qu'à trois reprises pour modifier ces édits (en comprenant la revision de 1576). La modification la plus importante fut celle votée le 2 avril 1576, qui autorisait les Petit et Grand Conseils à prélever des impôts sans ratification du Conseil général, ou qui semblait les autoriser car, au cours du XVIIIe siècle, cet édit et surtout sa portée réelle seront violemment contestés. [p. 140]
Troisième texte de base: les Edits civils, à la rédaction desquels prirent également part, entre autres, Claude Roset, Jean Calvin et Pierre Viret, dont la version originale fut approuvée en Conseil général le 15 novembre 1542. Ces premiers édits réglaient avant tout des questions de procédure civile. Complétés en 1546, 1558, ils furent entièrement revus par Germain Colladon, qui s'inspira également des Coutumes de Berry, et procéda à la confection d'un véritable code, comportant 32 titres, contre 5 en 1542. Ces Edits civils furent ratifiés en même temps que les Edits politiques. A l'exception d'un édit concernant les héritiers sous bénéfice d'inventaire, adopté en Conseil général en 1573, aucune modification de ces Edits ne fut votée par les citoyens avant le XVIIIe siècle. Une importante revision eut lieu le 5 octobre 1713. La législation genevoise, sous l'ancienne République, se caractérise donc par une grande stabilité, qui n'excluait pas des modifications réservées à la seule approbation des Petit et Grand Conseils. A la fin du XVIIIe siècle, les Genevois se méfient des codes, et le procureur général François-André Naville, dans son Etat civil de Genève, qui constitue un commentaire unique des Edits civils, se félicite de ce que les Edits ne rassemblent que "les lois essentielles" et non un code civil complet.
Le Code genevois et la Déclaration des droits et devoirs de l'homme social
Sous le nom de Code genevois, les citoyens adoptent cependant, le 14 novembre 1791, une "collection complète de lois politiques" dont le principal rédacteur est l'ancien procureur général Du Roveray, d'où le nom de code Du Roveray. Les troubles politiques de 1782 et 1789 avaient amené cette mesure. Ce code prévoyait une revision des Edits civils, mais les événements politiques ne le permirent pas. Les six années qui séparent l'adoption du Code genevois de l'annexion (avril 1798) sont marquées par de grandes turbulences politiques. De nombreux projets législatifs aboutissent, sous l'impulsion des comités de sûreté, de salut public ou de législation comme sous celle de simples membres de l'Assemblée nationale.
Le 6 juin 1793, est adoptée une Déclaration des droits et devoirs de l'homme social, qui reconnaît au citoyen le droit de propriété, la liberté, l'égalité, la sûreté, la garantie sociale et le droit de résistance à une autorité tyrannique. Une nouvelle constitution est promulguée le 5 février 1794, [p. 141: image / p. 142] (modifiée en 1796). Elle prévoit l'élaboration d'un Code pénal et d'un Code civil. Ni l'un ni l'autre ne verront le jour, malgré les efforts du Comité rédacteur des lois permanentes animé par trois hommes: Louis Odier, Julien Dentand et Jean-François Butini. On peut mesurer le changement de mentalité, quant au rôle de la loi, en méditant cette phrase extraite du rapport introductif au projet de code civil: "Ils tombent malheureusement dans une grande erreur, ceux qui croient qu'il suffit d'un petit nombre de lois pour statuer sur les intérêts respectifs des citoyens".
La période française
Dans le Traité de réunion du 26 avril 1798, il fut spécifié que les lois civiles genevoises resteraient en vigueur sur l'ensemble du territoire de l'ancienne République, désormais fondue dans le département du Léman jusqu'à l'entrée en vigueur des lois françaises. Ces dernières garantirent, par exemple, l'usage du patois devant les justices de paix. Rapidement les anciennes lois genevoises cédèrent la place, sur le plan pénal, au Code des délits et des peines du 3 Brumaire an IV, puis au Code pénal de 1810 et au Code d'instruction criminelle de 1808, sur le plan civil au Code Napoléon de 1804.
L'introduction du Code civil français fit disparaître ce qui pouvait subsister de l'ancienne législation genevoise. Le nouveau code introduisait un principe fondamental, celui de la séparation du civil et du religieux. Pour Genève, ce principe représentait une nouveauté inouïe, car les lois genevoises, même à l'époque révolutionnaire, avaient conservé un lien étroit entre l'Eglise et l'Etat. Le Code civil consacrait aussi le double principe de la liberté et de l'égalité des personnes et des fonds, alors que les Genevois venaient à peine d'effacer, malgré les Révolutions, les distinctions entre habitants de la ville et de la campagne.
La Restauration
Le 31 décembre 1813, un groupe de citoyens proclama la Restauration de l'ancienne République de Genève. Les Français étaient encore aux portes de la ville, les Autrichiens approchaient. Il fallut assurer à la ville une nouvelle constitution politique, un territoire non morcelé, des appuis pour l'admission dans la Confédération suisse. [p. 143]
La Constitution de 1814, fidèle reflet des pensées politiques de ses auteurs Joseph des Arts et Ami Lullin, rétablit plusieurs des anciennes institutions: syndics, Petit Conseil, auditeurs, mais ils se refusèrent à redonner au Conseil général ses anciens pouvoirs. Ils établirent en lieu et place un Conseil représentatif, élu chaque année partiellement au suffrage censitaire. A bien des égards, la Constitution de 1814, adoptée le 22 août, marque un recul sur la Constitution de 1794. Certaines de ses dispositions sont archaïques, comme celle rétablissant les châtelains à la campagne et qui fut abrogée dès 1816! Surtout, cette constitution ne respecte pas entièrement la séparation des pouvoirs, et en concentrant l'essentiel du pouvoir politique entre les mains du Conseil d'Etat et du Conseil représentatif, elle limite singulièrement les droits des citoyens. Mal accueillie par l'opposition libérale, elle fut remplacée par la Constitution de 1842.
Des "lois éventuelles pour le cas où la Ville et République de Genève acquerrait du territoire" furent jointes à la Constitution. Elles prévoyaient que le patrimoine des anciens Genevois, administré par la Société économique, ainsi que ceux des anciennes fondations de bienfaisance, comme l'Hôpital général, étaient réservés aux anciens Genevois. Cette inégalité fut aggravée puisque les nouveaux Genevois, environ un tiers de la population, n'eurent droit qu'au cinquième des sièges au Conseil représentatif. Mais le protocole du Congrès de Vienne du 29 mars 1815 rendit caduque cette dernière disposition.
Sur le plan civil et pénal, la loi du 6 janvier 1815 établit une organisation judiciaire provisoire, confirmée par celle du 15 février 1816, qui supprima les jurys, maintint les différents codes et lois en matière civile et commerciale, comme en matière pénale. Seules des adaptations concernant notamment le mariage (revisions en 1816, 1821 et 1824) et la procédure civile (loi Bellot du 29 septembre 1819) furent introduites, de même que la publicité des droits réels.
La Constitution de 1842
"Œuvre cohérente et clairement rédigée qui forme le plus parfait contraste avec celle de 1814", a-t-on écrit de la constitution élaborée sous la pression des événements du 22 novembre 1841 et des opinions libérales d'un groupe révolutionnaire, l'Association du Trois Mars. Elle consacre le principe du suffrage universel qui ne sera désormais plus remis en question. "La souveraineté réside dans le peuple" (article, titre I). Mais il s'agit d'une démocratie représentative, [p. 144] dans laquelle il appartient au Grand Conseil de voter les lois, sans possibilité de référendum. La Ville de Genève retrouve l'autonomie qu'elle a possédée à l'époque française et forme désormais une commune. Méconnue, la Constitution de 1842 était en réalité novatrice dans sa conception de l'équilibre des pouvoirs et, à bien des égards, la Constitution de 1847 s'en est inspirée.
La Constitution de 1847
L'esprit libéral de la Constitution de 1842 fut renversé par une application conservatrice. Il en résulta la révolution radicale du 5 octobre 1846 et la nomination d'un gouvernement provisoire, puis d'une constituante. Cette dernière, sous l'impulsion de James Fazy, rédigea une nouvelle constitution, approuvée en votation populaire le 21 mai 1847, qui régit encore aujourd'hui la République et Canton de Genève. Bien qu'elle ait fait l'objet de plus d'une centaine de revisions constitutionnelles depuis sa promulgation, cette constitution reste, fondamentalement, celle qu'avait voulue James Fazy. Elle définit plus clairement la souveraineté du peuple, précise un certain nombre de droits individuels, admet la jouissance de droits politiques pour les assistés. Surtout, la constitution rétablit formellement le Conseil général, composé de tous les électeurs, et qui est compétent pour l'élection du Conseil d'Etat. Bien sûr, on ne réunira plus le Conseil général en réunion publique, sorte de Landsgemeinde urbaine, mais le scrutin se déroulera en un seul lieu, pour lequel on édifiera le Bâtiment électoral.
Le titre de syndic est abrogé, seul subsiste celui de conseiller d'Etat; leur nombre est d'ailleurs réduit à sept.
Le jury, supprimé par la Restauration, est rétabli. En matière religieuse, la Constitution de 1847 apporte de grandes innovations. Elle proclame la garantie de l'exercice des cultes et prévoit, selon un système démocratique, l'élection du Consistoire, devenu l'organe de gouvernement de l'Eglise, par les citoyens protestants. Il s'agit en fait d'une véritable laïcisation de l'Eglise nationale protestante de Genève, puisque l'élément laïque devient prépondérant dans l'organisation de l'Eglise, la Compagnie des pasteurs perdant son droit d'élire les pasteurs. Enfin, la Société économique est dissoute, mais il faudra attendre 1868 pour voir définitivement abolie la distinction entre anciens et nouveaux Genevois dans les institutions d'assistance. Rien ne définit mieux l'esprit de la constitution que le libellé de son article 1: "La souveraineté réside dans le peuple; tous les pouvoirs [p. 145] politiques ne sont qu'une délégation de sa suprême autorité". Toutefois, il faut bien être conscient que la démocratie fazyste est, comme celle de 1842, une démocratie représentative, dans laquelle les pouvoirs législatifs sont réservés au Grand Conseil. Il faudra attendre la loi constitutionnelle du 26 avril 1879 pour voir introduit le référendum facultatif, qui permet aux citoyens de rejeter, en votation populaire, une loi approuvée par le Grand Conseil. Quant au droit d'initiative, il ne sera adopté que le 6 juin 1891. A partir de cet instant, on peut considérer Genève comme une démocratie semi-directe.
De revision en revision
Entre 1847 et 1984, on ne compte pas moins de cent dix revisions constitutionnelles, dont le rythme ne cesse de s'accélérer. Il faut mentionner, parmi les principales revisions constitutionnelles qui exercent aujourd'hui encore un effet durable sur l'organisation des pouvoirs publics, celle du 6 juillet 1892 introduisant le système proportionnel pour l'élection des députés au Grand Conseil; celle, capitale, du 15 juin 1907, supprimant le budget des cultes et introduisant par là le principe de la séparation de l'Eglise et de l'Etat, transformant les rapports séculaires entre ces deux institutions; celle, enfin, parmi d'autres, du 5 octobre 1962 établissant l'incompatibilité entre les fonctions de conseiller d'Etat et toute autre activité lucrative, à la suite d'une initiative populaire.
Code des obligations, Code civil, Code pénal
L'unification, toute relative et tardive, du droit fédéral a entraîné l'abrogation des lois d'inspiration française. L'entrée en vigueur du Code des obligations de 1881, puis celle du Code civil de 1907 (en vigueur dès 1912) a consacré l'unification du droit privé suisse, commandée par les exigences mêmes de la vie moderne. On sait que le Code civil, oeuvre du célèbre juriste Eugène Huber, s'est inspiré des législations cantonales. Il s'agit d'un code adapté aux moeurs et aux mentalités helvétiques. Il convient de noter que, dans son projet, E. Huber n'avait pas retenu comme mode de tester le testament olographe. A l'instigation de la représentation genevoise aux Chambres fédérales, le testament olographe, courant à Genève, fut inscrit dans le code, et il est devenu, aujourd'hui, la façon la plus courante de tester. [p. 146]
Le Code civil a tout de même laissé aux lois cantonales certains domaines du droit privé (suppression ou maintien de la réserve des frères et soeurs, art. 472 CC, par exemple) et a réservé expressément les usages locaux (art. 5 CC). De nombreuses revisions du Code civil et du Code des obligations, touchant notamment le droit du travail, le droit de la famille, le droit du mariage, le droit des sociétés anonymes sont en cours ou viennent d'aboutir. Quant au Code pénal suisse de 1937, entré en vigueur le 1er janvier 1942, il a notamment consacré le principe de l'abolition de la peine de mort, que Genève, pour sa part, avait déjà supprimée en 1874.
C'est dans le domaine de la procédure que la souveraineté cantonale se marque le plus, puisque chaque canton a la compétence de promulger ses propres codes de procédure civile, pénale et administrative.
La loi de procédure civile élaborée en 1819 par P.-F. Bellot a été modifiée à plusieurs reprises, la dernière fois en 1920.
Le Code de procédure pénale a été entièrement refondu grâce à Me Dominique Poncet et adopté le 29 septembre 1977. Il s'agit d'un code qui garantit les droits de l'inculpé d'une façon très étendue, ainsi que les droits de la défense, à tel point que les juges d'instruction se sont parfois plaints qu'ils avaient moins de droits qu'un inculpé. Du moins, ce Code de procédure pénale est-il conforme aux conventions qui découlent tant des droits de l'homme que des garanties individuelles assurées au justiciable. Il fait honneur à la tradition juridique libérale de Genève.
Activités législatives
Les délibérations du Grand Conseil, comme celles des Conseils municipaux, sont publiées dans un Mémorial qui, à sa manière, témoigne de l'activité législative, mieux encore que le recueil systématique des lois puisqu'on y trouve mention des projets de lois retirés ou rejetés. Les milieux politiques et économiques se plaignent souvent d'une inflation législative telle qu'on a peine à se retrouver dans le maquis des lois. D'autres époques — la Révolution genevoise de 1792 par exemple — ont aussi connu ce phénomène. Il peut être intéressant de le quantifier:
- en 1886, le Grand Conseil eut à examiner 37 projets de lois et 8 arrêtés législatifs
- en 1936, 33 projets de lois et 34 arrêtés législatifs. Le Mémorial compte 1.435 pages [p. 147]
- en 1951, 37 projets de lois et 26 arrêtés législatifs. Le Mémorial compte 1.398 pages
- en 1961, 239 projets de lois, dont 161 émanent du Conseil d'Etat. Le Mémorial compte 3.143 pages
- en 1971, 151 projets de lois, dont 103 émanent du Conseil d'Etat. Le Mémorial compte 4.039 pages
- en 1981, 218 projets de lois, dont 121 émanent du Conseil d'Etat. Le Mémorial compte 5.541 pages.
Mais toutes ces lois, tous les règlements d'application sont toujours adoptés conformément aux procédures légales, car Genève est un Etat de droit, un Rechtsstaat, dont les citoyens n'hésitent pas à recourir au Tribunal administratif ou au Tribunal fédéral si leurs droits constitutionnels sont violés. Et le nombre des arrêts genevois, dans la jurisprudence du Tribunal, n'est pas mince...
Le pouvoir législatif
Le pouvoir législatif sort de sa chrysalide
On ne peut parler de pouvoir législatif proprement dit que lorsque le principe de la séparation des pouvoirs est appliqué. Sous l'ancienne République, la confusion des pouvoirs entre les Conseils empêche de reconnaître au Conseil des Deux Cents le pouvoir législatif, au sens actuel du terme. La première assemblée législative digne de ce nom fut l'Assemblée nationale, prévue par la Constitution de 1794.
Sous la Restauration, le Conseil représentatif, de 250 membres, dont l'élection au suffrage censitaire constituait un chef-d'oeuvre de complications subtiles, avait le pouvoir législatif, mais il ne possédait pas le pouvoir d'initiative des lois, dévolu au Conseil d'Etat, lequel siégeait dans le Conseil représentatif, contrairement à la règle de la séparation des pouvoirs. Il possédait en revanche un droit de revision dont il usa assez largement.
La Constitution de 1842 posa le principe de la démocratie représentative. Le pouvoir législatif y était exercé par un Grand Conseil de 176 députés, élus au suffrage universel, selon le système majoritaire, par dix arrondissements électoraux. Ce Grand Conseil acquérait aussi l'initiative des lois et élisait le Conseil d'Etat.
La Constitution de 1847, tout en rétablissant le Conseil général, maintint le principe de la démocratie représentative. Au pouvoir législatif, qui conservait le nom de Grand Conseil, furent attribués le vote des impôts, du budget, du compte rendu, l'initiative des lois concurremment avec le Conseil d'Etat, l'exercice du droit de grâce, le soin d'élire les magistrats du pouvoir judiciaire et les députés à la Diète, plus tard les députés au Conseil des Etats. Le Souverain (Conseil général) élisait le Conseil d'Etat et le Grand Conseil, et se prononçait sur les modifications constitutionnelles. Il fut prévu de le consulter tous les quinze ans sur l'opportunité d'une revision totale de la constitution. Cette disposition est d'ailleurs toujours en vigueur.
Evolution du Grand Conseil
Au cours des ans, le Grand Conseil a perdu plusieurs de ses attributions en raison de l'extension des droits populaires. C'est ainsi que depuis 1879 les lois qu'il vote peuvent faire l'objet de référendums, qu'il a perdu le droit d'élire les députés au Conseil des Etats et les magistrats du pouvoir judiciaire (sous réserve des élections complémentaires dans ce dernier [p. 149] cas), que ses compétences en matière financière ont été restreintes par l'obligation qui lui est faite de prévoir la couverture de la dépense proposée par une recette correspondante qui ne peut être obtenue par l'emprunt, et qu'enfin, depuis 1891, le peuple possède aussi le droit d'initiative.
D'autre part, le Grand Conseil voit ses compétences augmenter: en effet, le pouvoir exécutif est soumis à un contrôle accru du législatif, qui dispose pour cela de nouveaux moyens parlementaires: l'interpellation, la motion, la résolution, la question écrite.
A l'origine, le Grand Conseil était élu tous les deux ans, alternativement avec le Conseil d'Etat; durée portée à trois ans, puis, dès 1957, à quatre ans; cependant qu'il fut décidé, en 1927, que l'élection du Conseil d'Etat aurait lieu la même année, quatre semaines après celle du Grand Conseil, de façon à assurer une meilleure stabilité gouvernementale.
Le mode d'élection
Pour l'élection du Grand Conseil, le Constituant de 1842 avait divisé le canton en dix arrondissements élisant chacun leurs députés proportionnellement à leur population, nombre qui fut réduit à trois en 1847: la Ville de Genève, la rive gauche du lac et du Rhône, la rive droite.
Plus les moyens de transport se multipliaient, plus s'amplifiaient les revendications d'ouverture de nouveaux locaux de vote. Les trois bureaux de 1847, où les électeurs se rendaient selon leur lieu de domicile, furent portés à sept en 1878, à vingt-quatre en 1879, puis remplacés par le vote à la commune en 1886. C'est en 1933 que disparut le système des arrondissements électoraux remplacés par le collège unique. Au temps des arrondissements, un candidat pouvait se présenter dans chacun d'eux; en cas d'élection multiple, il disposait d'un droit d'option, qu'il exerçait généralement en faveur de son arrondissement de domicile.
L'âge d'éligibilité fixé à 25 ans fut abaissé à 20 en 1967, et suivit l'abaissement de la majorité civique en 1979 (18 ans).
L'introduction du suffrage féminin permit, dès 1961, l'élection de dix femmes, chiffre allant en augmentant pour atteindre trente-deux en 1989.
Un député est immédiatement et indéfiniment rééligible, il n'existe de limite ni d'âge ni de durée de mandat. En 1986, le doyen d'âge du Grand Conseil était le député Jean Vincent, du Parti du travail, élu pour la première fois en 1936, et qui siégea sans discontinuer sur les bancs du Grand Conseil de 1945 à 1986.
[p. 150]
Le système majoritaire
Le système majoritaire assure la prédominance d'un parti ou d'une entente de groupes. L'emporte celui qui obtient le plus de voix; il peut s'agir soit d'une majorité absolue (la moitié des suffrages + un), soit d'une majorité relative (le plus de voix). Genève a connu, pour les élections législatives, et connaît encore pour l'exécutif, un système hybride de la majorité relative qualifiée: pour être élu, il faut recueillir le tiers des voix; si ce chiffre n'est pas atteint un second tour est organisé dans lequel la majorité simple suffit.
La représentation proportionnelle
La représentation proportionnelle, ou système dit du quotient, assure une représentation équitable des différentes tendances exprimées par le vote. Elle postule l'existence de partis politiques qui présentent des listes de candidats dont les élus constituent des groupes parlementaires.
A la suite des événements du 22 août 1864, qui vit l'élection d'Arthur Chenevière contre James Fazy, et de l'émeute sanglante qui suivit, l'idée d'une réforme électorale se propagea, sous l'influence de l'Association réformiste genevoise et de son président Ernest Naville. L'historien Amédée Roget s'y montre favorable dès 1869 et en 1882, le député Falletti propose le système de la représentation légale de la minorité. Mais ce n'est qu'après de longs débats et un essai pratique tenté le 13 décembre 1891 que la représentation proportionnelle fut introduite en votation populaire, le 6 juillet 1892. Au niveau communal, le système proportionnel ne sera introduit qu'en 1912, pour les communes dépassant 3.000 habitants, parallèlement au quorum de 7 pour cent établi pour éviter l'éparpillement des élus. Un projet de généralisation à l'ensemble des communes n'a pas trouvé grâce devant le Grand Conseil. Quant au quorum, il est combattu aujourd'hui par des pétitionnaires soucieux d'assurer la représentativité des secteurs les plus minoritaires de l'opinion.
Si Genève ne connaît pas la possibilité du cumul d'un candidat, contrairement au plan fédéral, en revanche, on a institué le système de l'apparentement des listes, selon lequel les listes de plusieurs partis sont considérées comme formant une seule liste, ce qui représente un avantage pour le calcul des sièges, si ces partis déclarent leur volonté d'apparentement avant le scrutin.
[p. 151]
Organisation du Grand Conseil
Chaque année le Grand Conseil nomme son bureau, formé d'un président, de deux vice-présidents et de deux secrétaires. Alors que, précédemment, il était fréquent de voir un membre occuper la présidence pendant plusieurs années, cette commune a fait place à la rotation entre partis et entre députés. Alfred Vincent et Paul Lachenal se partagèrent l'honneur d'avoir été appelés à six reprises à cette charge. Cent quarante-cinq députés s'y sont succédé; plusieurs démissionnèrent en cours d'année. La présidence la plus éphémère fut occupée pendant dix-huit jours par un député qui, absent lors de son élection, la refusa à la séance suivante. Dès 1963, des femmes ont fait partie du bureau. Depuis 1965, quatre d'entre elles ont occupé le siège présidentiel.
Le secrétaire permanent du Grand Conseil est assuré par un fonctionnaire, le sautier. A l'origine, ce terme désigne un garde-champêtre. Dès la Réforme, le sautier est en fait le concierge de la maison de ville où, jusqu'en 1920, il avait son logement. Chef des huissiers, portant une livrée aux couleurs de la Ville, il était aussi chargé de l'exécution des ordres du Conseil, qu'il attendait assis sur une sellette en forme de lion, conservée dans la salle du Conseil d'Etat. Lors de manifestations auxquelles le Conseil d'Etat participe "in corpore", le sautier le précède et porte la masse. Ordonnateur du cérémonial des prestations de serment, il dirige le secrétariat du Grand Conseil, assisté d'un chef de service, d'huissiers, de secrétaires et de mémorialistes, et assure la liaison entre le législatif et l'exécutif. Depuis 1818, il observe l'éclosion de la première feuille du marronnier de la Treille.
Le Conseil représentatif avait confié à l'un de ses membres les plus éminents, Etienne Dumont, le soin de lui présenter un projet de règlement sur son organisation, dont l'application devait permettre un déroulement harmonieux et efficace de ses séances. Dumont rédigea un texte remarquable dont l'essentiel a été conservé dans les lois successives d'organisation du pouvoir législatif.
Discussion des lois
La tâche essentielle du Grand Conseil est de légiférer, c'est-à-dire de créer des lois ou de modifier celles qui existent. La distinction d'origine entre la loi qui est de portée générale et l'acte législatif qui se rapporte à un objet déterminé a été abandonnée en 1960. [p. 152]
Un projet de loi étant déposé, sa discussion immédiate peut avoir lieu, à la suite de quoi ledit projet peut être accepté, rejeté ou renvoyé en commission, ce qui est le cas le plus fréquent. Le nombre de commissaires, chaque groupe devant être représenté par un membre au moins, varie selon l'importance de l'objet traité.
L'activité du Grand Conseil se reflète dans celle de ses commissions. C'est là généralement que se fait le travail effectif, davantage que dans les séances plénières. Actuellement le corps législatif comprend 20 commissions permanentes et 9 commissions ad hoc, auxquelles un ou plusieurs projets ont été renvoyés. Parmi les commissions permanentes, la plus importante est probablement celle des finances, chargée d'examiner les comptes et la gestion de l'Etat, le budget et les demandes de crédit. Une mention spéciale doit être accordée à la commission de grâce, car le droit de gracier, qui est une remise de peine n'effaçant pas la condamnation, constitue une des attributions essentielles de la souveraineté. Mais c'est au seul Grand Conseil qu'il appartient de décider une amnistie, laquelle est un pardon général effaçant la condamnation. [p. 153]
La commission des pétitions est saisie des plaintes, demandes ou voeux présentés par des personnes physiques ou morales qui exercent ainsi un droit constitutionnellement garanti. Elle soumet ses conclusions au Grand Conseil et si le dossier est renvoyé au Conseil d'Etat, le pouvoir exécutif doit répondre dans un délai de six mois. En septembre 1991, 104 pétitions étaient à l'étude, dont 50 attendaient la détermination du Conseil d'Etat...
Une loi fait l'objet de trois débats pendant lesquels, hormis pour le rapporteur, le temps de parole est limité à dix minutes et à trois interventions. Le premier débat porte sur la prise en considération du projet, au cours du second, ce dernier est examiné article par article avec amendement et sans amendement, chacun d'eux faisant l'objet d'un vote distinct. En troisième débat, le projet est repris article par article, puis intervient le vote d'ensemble. La votation se fait à main levée. En cas de doute, il est procédé par assis et levés, les voix étant alors comptées par le sautier. Un vote nominal doit avoir lieu quand la demande en est appuyée par dix députés.
A partir de la publication de la loi dans la Feuille d'avis officielle, les citoyens disposent de quarante jours pour demander le référendum. A l'expiration de ce délai, le Conseil d'Etat promulgue la loi et en fixe l'entrée en vigueur. Lorsqu'il s'agit d'une loi constitutionnelle ou qu'un référendum a abouti, il appartient au Conseil d'Etat de faire procéder à la consultation populaire qui doit avoir lieu au plus tard une année après la décision du Grand Conseil.
A côté de son droit d'initiative, le député dispose aujourd'hui de celui de présenter une proposition de résolution ou une motion, de développer une interpellation, de poser une question écrite. La résolution est une déclaration qui n'entraîne aucun effet législatif. L'interpellation est une question contresignée par cinq députés au moins, posée oralement sur un objet déterminé; la réponse donnée par le Conseil d'Etat permet à l'interpellateur de répliquer, puis au gouvernement de dupliquer. La motion est une proposition invitant le Conseil d'Etat, soit à étudier une question déterminée, soit à en charger une commission. Dans le permier cas, le Conseil d'Etat est tenu de répondre dans un délai de six mois, délai que le gouvernement n'observe pas toujours, puisqu'au début de la session d'automne 1990, 135 rapports du Conseil d'Etat étaient attendus pour des objets s'étalant entre le 16 août 1978 et le 22 juin 1990. Il ne semble d'ailleurs pas que les députés en tiennent rigueur au gouvernement puisqu'ils ont rejeté tout récemment un projet visant à introduire certaines règles plus contraignantes. [p. 154]
Tout député peut poser au Conseil d'Etat une question écrite sur un objet déterminé, à laquelle, sauf cas exceptionnel, il doit être répondu dans les deux mois. Au début de la même session, 89 réponses étaient attendues pour des questions s'échelonnant entre le 18 mars 1982 et le 25 juillet 1990.
Le Grand Conseil dispose de certains droits en matière de biens immobiliers. Toute aliénation du domaine public doit lui être soumise. C'est également lui qui déclare d'utilité publique un ouvrage permettant au gouvernement d'appliquer la procédure d'expropriation à l'égard d'un propriétaire privé.
Il statue sur le traitement des fonctionnaires. Si le Conseil d'Etat entend conclure un traité ou adhérer à un concordat, il en soumet au préalable le texte au pouvoir législatif qui l'approuve ou le rejette en bloc.
Quand il est de la compétence du Grand Conseil de procéder à une élection, qui peut être tacite, son vote doit être précédé d'une inscription publique.
Publication des débats
Le Mémorial des séances ne fut publié qu'à partir de 1828, d'abord sous forme d'un procès-verbal résumé, devenu par la suite un compte rendu sténographique dont l'enregistrement a lieu depuis 1957. Mais ce n'est qu'en 1833 que le Conseil représentatif décida que ses séances seraient publiques.
Le Recueil authentique des lois et arrêtés du gouvernement paraît depuis 1814, avec un index chronologique et une table des matières. Depuis 1958, la Chancellerie d'Etat édite le Recueil officiel systématique de la législation genevoise en vigueur, comportant des textes légaux et réglementaires de portée générale postérieurs à 1814.
Quant à la Feuille d'avis officielle, trois fois par semaine, depuis 1752, elle contient avis officiels et annonces.
Honneur et argent
A l'origine, le mandat de député était considéré comme un honneur et ne donnait lieu à aucune indemnité. Plusieurs tentatives d'accorder un jeton de présence se heurtèrent à l'hostilité du corps électoral. Les temps ont changé. Périodiquement certains groupes politiques proposent de transformer le Parlement de milice en une assemblée semi-professionnelle, ce qui a cependant toujours été rejeté jusqu'ici. Mais indemnités de séances plénières et de commissions, [p. 155] frais de transport et autres sont aujourd'hui fixés par le règlement du Grand Conseil et adaptés périodiquement. Pour 1991, si l'on ajoute aux montants ainsi versés les salaires du personnel affecté au service du Grand Conseil, les dépenses du Parlement genevois atteignent, pour son fonctionnement, un montant de près de quatre millions de francs.
P.P.
haut
La justice dans le passé
L'exercice de la justice a toujours été l'une des principales attributions du pouvoir. Il n'est donc pas étonnant que la conquête de ce droit ait été la première ambition de tous ceux qui se sont efforcés de dominer Genève. On ne sait rien, ou presque, de l'organisation judiciaire genevoise à l'époque des rois burgondes et une idée précise de l'organisation de la justice à Genève ne peut être donnée qu'à partir de la période épiscopale, soit à une époque où le principe de la territorialité du droit, partant de la juridiction, est solidement établi.
[p.156]
La période épiscopale
Prince de Genève, l'évêque y rend la justice, soit directement, soit indirectement.
L'officier chargé d'exercer cette fonction au nom de l'évêque est le vidomne — ou vidame, vice-dominus. (Ce titre et cette charge existent aussi dans d'autres diocèses.) La procédure suivie devant la cour du vidomne est orale, simple et familière puisqu'elle se déroule en français et non en latin, comme pour mieux écarter le droit savant. Elle fait un recours constant à la coutume. C'est dire que la cour du vidomne est une première instance en matière civile fort appréciée des habitants de Genève. Depuis 1306, le vidomne connaît de toutes les causes civiles, à l'exception de celles dont l'évêque veut prendre connaissance en vertu de son "droit d'évocation". Dès 1290, l'exercice de la justice civile est inféodé au comte de Savoie qui s'est fait octroyer par l'évêque l'office du vidomne: cette charge pouvait en effet s'engager ou se vendre comme un héritage féodal.
La cour du vidomne est composée de chanoines et de citoyens pour les affaires civiles. En matière pénale, le vidomne a la compétence de ce qu'on appelle les "maléfices mineurs", les délits correctionnels. Quant aux "maléfices majeurs", ils sont, depuis 1364, du ressort des syndics, alors qu'auparavant, ils relevaient de la cour épiscopale, où siégeaient déjà quelques citoyens. L'appel est interjeté devant le juge des appellations épiscopales, l'évêque seul ayant le droit de grâce, privilège régalien.
A la suite de la rediffusion du droit romain au nord des Alpes au début du XIIIe siècle, l'évêque nomme un nouveau juge, l'official (mentionné dès 1225), juge ecclésiastique dont la compétence ne s'arrête pas aux clercs. Les causes civiles jugées par le vidomne lui sont portées en appel, mais il juge aussi parfois en première instance. La procédure de l'officialité est formelle, écrite, savante puisqu'elle se déroule en latin et qu'elle applique les règles du droit romano-canonique en vigueur dans l'Eglise. De l'official, on peut faire appel à la cour de l'archevêque de Vienne et de là, au pape.
Mainmise sur la justice
La communauté des citoyens s'efforce d'élargir les prérogatives que lui reconnaissent les Franchises. La période troublée qui précède l'introduction de la Réforme est essentielle puisqu'en se saisissant de l'exercice de la justice, les citoyens affirment leur volonté de se constituer en Etat [p. 157: image / p. 158] libre et souverain. La naissance de la Seigneurie se marque dans la mainmise sur la justice.
En 1527, le poste de vidomne s'étant trouvé vacant, le duc de Savoie tente de le repourvoir, comme il en a le droit, mais les syndics font la sourde oreille. Pendant ce temps, les parties en procès prennent pour arbitres les syndics. Ce recours à l'arbitrage des syndics, qui se substituent ainsi au vidomne, devient obligatoire le 18 septembre 1527, par décision du Conseil des Deux Cents. Puis, en février 1528, un tribunal formé d'un syndic et de six assistants est établi formellement pour siéger en lieu et place du vidomne, reprenant l'ensemble de ses compétences. Enfin, le Conseil général approuve, le 14 novembre 1529, la formation d'une Cour de justice — dénommée Cour du lieutenant ou Tribunal de l'audience — présidée par un lieutenant de justice (suppléant du syndic) assisté de quatre, puis six assistants ou auditeurs. Dès 1530, on sépare les fonctions de membre du Petit Conseil et celle d'auditeur, en même temps qu'on abolit les appels à Vienne et à Rome. Logiquement, on aurait dû appeler au Petit Conseil, mais dès le 21 mai 1532, on établit une Chambre des appellations, formée des quatre syndics et de quatre conseillers. En 1568, le système sera définitivement mis en place: une première juridiction d'appel, les Premières appellations, composée de sept membres (dont quatre du Deux Cents) précède une seconde instance, les Suprêmes appellations, qui comprend tous les membres du Petit Conseil à l'exception de ceux qui se sont prononcés aux Premières appellations. Mais dès 1604, il y a possibilité de recourir contre une sentence des Suprêmes appellations au Conseil des Deux Cents.
Pour les territoires de la campagne, le châtelain remplace le lieutenant et la voie de recours contre les ordonnances du châtelain est ouverte aux Premières appellations, puis aux Suprêmes, enfin aux Deux Cents. En 1536, il est prévu six châtelains, mais après 1754, il n'en subsiste plus que deux: Peney et Jussy (voir aussi le volume II de cette Encyclopédie, pages 69, 72 à 74).
La procédure devient écrite et d'une lenteur telle que dès le XVIe siècle, on propose à plusieurs reprises de remédier à ce défaut par "l'abréviation de la justice". Sans résultat. Si l'on consulte les Edits civils, on constate que les dix premiers titres sont exclusivement consacrés à la procédure civile, qui permet de nombreux recours, incidents, transports sur place et atermoiements. L'examen des procédures civiles genevoises confirme les nombreux témoignages du temps sur une justice coûteuse, lente et pas toujours inaccessible à certaines faveurs.
[p. 159]
La justice pénale
Au rebours, la justice pénale est toujours expéditive, parfois trop. Fondée sur l'arbitraire des peines, et non sur une loi pénale, elle ne fait appel qu'à des règles de procédure. Genève suit d'ailleurs la procédure inquisitoire, écrite, secrète, non contradictoire, qui ne laisse que peu de garanties à l'accusé, lequel n'est même pas toujours autorisé à recourir aux services d'un avocat. Pour le droit de fond, en tant que ville impériale, Genève aurait pu appliquer la Caroline, l'ordonnance criminelle de Charles Quint, de 1532. D'ailleurs les avis de droit s'y réfèrent parfois, encore qu'ils fassent surtout allusion, notamment ceux de Germain Colladon, aux règles romaines.
La juridiction criminelle appartient aux syndics de la communauté dès le Moyen Age, comme on le voit par les Franchises de 1387. L'évêque, qui possède la haute justice, c'est-à-dire le droit de condamner à mort, mais ne peut faire verser le sang, fait exécuter les condamnés par le châtelain de Gaillard, officier du comte de Genève, généralement à Champel. Il faut remarquer qu'à l'origine les syndics ne font pas non plus procéder eux-mêmes à l'exécution de la sentence qu'ils ont prononcée. Ils jugent avec l'aide du Petit Conseil et aucun appel n'est possible contre leur sentence. Cependant, en 1527, en l'absence du vidomne, seul habilité à transmettre un condamné à mort des mains des syndics au châtelain de Gaillard, il fallut procéder à une exécution. Le châtelain de Gaillard, désormais officier du duc de Savoie, refusa de se saisir du condamné. Genève nomma son propre exécuteur des hautes oeuvres, qui exécuta le condamné. De ce jour, on peut considérer que la Seigneurie de Genève possède le droit de haute justice. Pas totalement toutefois, car le droit de grâce appartient à l'évêque, qui l'exerce encore en 1532, puis, après la Réforme, au Conseil des Deux Cents, ce que confirment les Edits de 1568. Ce n'est qu'à partir de 1713 que l'on peut en appeler d'une sentence criminelle du Petit Conseil devant les Deux Cents.
D'autres causes sont dévolues à la juridiction du Consistoire, formé de laïcs appelés "anciens" et de pasteurs, notamment les causes matrimoniales, mais aussi des affaires concernant la moralité, les bonnes moeurs ou le comportement des Genevois. Le Consistoire ne peut prononcer que des peines ecclésiastiques, en particulier l'excommunication, soit la privation de la sainte cène. Mais il peut, dans les cas graves, déférer les coupables à la justice séculière du Conseil qui prononce alors des peines corporelles parfois lourdes: fouet, bannissement, etc. De même, la violation des [p. 160: image / p. 161] ordonnances somptuaires, d'abord du ressort du Consistoire, est ensuite attribuée à la Chambre de la réformation (des moeurs) qui peut elle aussi prononcer des peines légères, comme des amendes, mais surtout distribue des admonestations et des remontrances.
L'institution du jury
Sous la Révolution genevoise, ces anciennes institutions judiciaires sont balayées et remplacées, au civil et au pénal, par une Cour de justice, un Tribunal de police, un Tribunal des faillites, un Tribunal de l'audience, une Cour criminelle, etc. Cette multiplication d'organes divers aux compétences mouvantes dure peu. Il faut en revanche retenir que la procédure inquisitoire est abandonnée au profit de la procédure accusatoire, contradictoire, permettant une meilleure défense en matière pénale, et que le jury est institué par la Constitution de 1794. On distingue plusieurs jurys. D'une part, un grand jury d'accusation, qui joue le rôle de l'actuelle Chambre d'accusation. D'autre part, un jury de jugement, analogue au jury moderne. L'instauration du jury a été considérée comme un progrès car elle permet à chacun d'être jugé par ses pairs. C'est pourquoi la décision prise à la Restauration de supprimer le jury sera mal acceptée et la révolution radicale rétablira le jury de jugement.
La Restauration et l'ordre judiciaire
Sous l'Annexion, Genève suit le système français et, lors de la Restauration, revient à un système mixte, inspiré de l'Ancien Régime, avant que les juges, à partir de 1842, soient élus par le Grand Conseil.
Les tribunaux établis par la Constitution de 1814 sont composés principalement de conseillers d'Etat et de membres du Conseil représentatif, lesquels sont délégués par ces institutions pour exercer leur tâche judiciaire.
Le premier degré de juridiction est formé par le Tribunal de l'audience, dont le seul nom fleure l'Ancien Régime. Les auditeurs qui le composent sont de jeunes magistrats au début de leur carrière. Chargés de tâches administratives (comme la propreté de la ville, la surveillance des marchés ou le contrôle des poids et mesures), ils exercent aussi des fonctions judiciaires telles que la conciliation, la juridiction non contentieuse ou encore l'instruction préalable en matière pénale. Leurs attributions sont donc très proches de celles des auditeurs sous l'Ancienne République. [p. 162]
Un Tribunal de recours coiffe l'appareil judiciaire. Il statue sur les recours en réforme et les recours en nullité, et c'est lui qui dispose du droit de grâce.
On peut dire toutefois qu'à partir de 1832, la physionomie de la justice genevoise commence à prendre la tournure qu'elle connaît à l'heure présente. Les magistrats de l'ordre judiciaire sont indépendants, élus et soumis à réélection. Deux degrés de juridiction civile sont maintenus, tandis que les organes de la justice pénale sont différenciés suivant la gravité des causes, avec un organe de cassation qui vise à assurer le respect de la loi par les juridictions pénales. Enfin, les causes mineures possèdent leur propre juridiction.
En 1847, la nouvelle Constitution apporte deux modifications: le rétablissement de la justice de paix, connue sous la période française, et celui du jury, considéré à tort ou à raison — le débat reste ouvert et controversé aujourd'hui — comme une conquête démocratique.
Justice d'hier
Ce qui distingue la justice d'hier de celle d'aujourd'hui, c'est, en matière pénale, sa rapidité et sa sévérité. En matière civile, ce serait plutôt le nombre d'instances de recours possibles qui contribuait à l'allongement de procès dont certains pouvaient durer plusieurs dizaines d'années.
Il est difficile de connaître le niveau de professionnalisme des juges. La loi ne comportait aucune exigence précise à cet égard. Mais force est de constater que les auditeurs étaient souvent choisis parmi de jeunes avocats. Or les auditeurs forment la pépinière naturelle des futurs conseillers d'Etat, donc des futurs juges. On peut donc admettre que la plupart des membres des Premières appellations ou du Tribunal de l'audience avaient une formation juridique, de même que le Procureur général.
Un personnel nombreux de secrétaires, de greffiers, de tabellions, de notaires, d'avocats gravitait autour des cours de justice, mais jamais il n'a eu l'éclat de celui qui entourait, en France voisine, les cours des Parlements. Il n'y avait pas à Genève l'équivalent des parlementaires français, de ces grands officiers de justice. L'exercice de la justice n'était, pour les magistrats genevois, qu'une fonction, importante certes, mais parmi d'autres. Il ne faut pas l'oublier si l'on veut bien comprendre l'ancien système judiciaire de la République.
B. L.
haut
[p. 163]
La justice actuelle
Les tribunaux du canton de Genève
Différents tribunaux ont été créés à Genève, en vertu de la Constitution de 1847, sur le modèle français. Contrairement à ce qui existe dans les autres cantons, celui de Genève forme une entité unique, de sorte qu'il n'existe pas de tribunaux de communes ou de districts.
L'organisation de ces tribunaux ressort, dans ses grandes lignes et sous une forme simplifiée, des tableaux ci-après. Elle est l'aboutissement d'une longue évolution. Ce qui la différencie plus particulièrement de l'organisation d'autres cantons ou d'autres pays est le rôle du Procureur général.
Les juges et les auxiliaires de la justice
La justice est rendue par des magistrats, désignés par le peuple tous les six ans; dans l'intervalle, le Grand Conseil est habilité à nommer les magistrats en cas de vacances ou d'augmentation de postes.
Les juges qui composent les juridictions énumérées plus loin (à l'exception de la Chambre des tutelles-justice de paix et des tribunaux de prud'hommes) doivent, pour être nommés, posséder un brevet d'avocat; ils sont donc nécessairement licenciés en droit. Cette exigence n'est pas requise des différents assesseurs qui siègent à la Chambre d'accusation, au Tribunal de police et au Tribunal des baux et loyers. Les magistrats juristes doivent tout leur temps à leur fonction, et celle-ci est incompatible avec la profession d'avocat, de notaire et avec toute fonction administrative salariée. Les magistrats sont assermentés devant le Grand Conseil.
Ils sont soumis à la surveillance du Conseil supérieur de la magistrature, composé du Président du département de Justice et Police, du Procureur général et des présidents des différentes juridictions.
Les auxiliaires de la justice sont d'abord les avocats, dont le rôle est décrit plus loin de manière détaillée.
A Genève, à la différence d'autres cantons, il existe des huissiers judiciaires, assermentés devant le Conseil d'Etat après avoir effectué un stage de cinq ans et subi un examen professionnel. Ils sont chargés notamment d'assurer le service près des tribunaux, de dresser des protêts en matière d'effets de change et d'organiser les ventes aux enchères.
Les maires et adjoints des communes exercent certaines fonctions à eux dévolues par le Code de procédure pénale et [p. 154] ils sont tenus gratuitement de chercher à prévenir les procès et à concilier les parties. Enfin, il faut relever l'existence des Offices des poursuites et des faillites, spécialement organisés pour remplir les fonctions que leur assigne la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite.
Le fonctionnement de la justice
Le principe de la séparation des pouvoirs, rappelé plus haut, est strictement appliqué à Genève. Le pouvoir judiciaire tient à sa totale indépendance par rapport aux deux autres pouvoirs, le législatif et l'exécutif, sauf naturellement en ce qui concerne l'organisation matérielle des juridictions qui relève du département de Justice et Police et de celui des Finances. S'il est vrai que les magistrats reçoivent leur traitement de l'Etat, il n'en reste pas moins qu'ils sont entièrement libres à l'égard de celui-ci: le ministère public, contrairement au système français, ne reçoit aucun ordre quelconque du chef du département de Justice et Police quant à l'opportunité d'une poursuite pénale, et, en matière civile, les juges n'hésitent pas à condamner l'Etat dans les causes où celui-ci est partie à un procès.
Comme dans tous les pays du monde, c'est l'aspect pénal de la justice qui est le plus connu du public. Les journaux font en effet régulièrement mention des audiences de la Chambre d'accusation, de la Cour d'assises, des Cours correctionnelles et du Tribunal de police, car il est communément admis que le public doit être renseigné sur les crimes et délits, et que les condamnations ou les acquittements prononcés intéressent l'ensemble des citoyens. A de rares exceptions près (faillites retentissantes, augmentations des loyers, évacuations d'immeubles, etc.), tous les litiges relevant du droit civil et du droit administratif leur échappent. Le juge n'apparaît donc que comme le magistrat chargé d'emprisonner ou de punir. Pourtant les procès entre particuliers, qu'ils concernent le droit de la famille, les relations commerciales, les différends entre l'administration et les particuliers, etc., constituent aussi le pain quotidien des magistrats, même si aucune publicité ne s'attache à cette partie de leur activité. Il importe de souligner à cet égard que les juges s'efforcent toujours de concilier les parties — ce qui est également une part méconnue de leurs fonctions — et qu'ils ne sont pas seulement les machines à rendre les jugements que d'aucuns imaginent.
[p. 165]
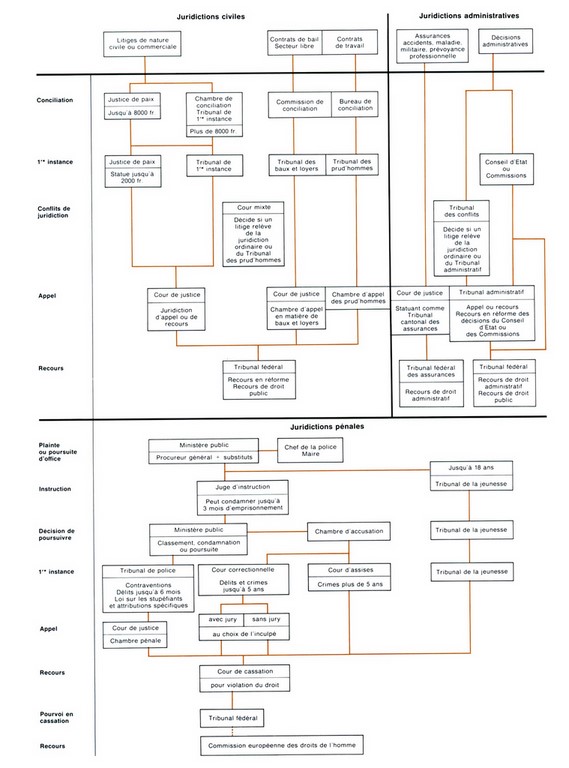
Une justice intègre, peut-être lente
Si l'on reconnaît généralement que la justice est indépendante à Genève et rendue d'une manière impartiale, le reproche lui est souvent fait d'être lente. Il est certain que le système judiciaire est lourd et compliqué: le législateur l'a voulu pour que les intérêts des justiciables soient protégés. En matière pénale, le Code de procédure adopté en 1977 a prévu de nombreuses voies de recours contre les ordonnances des juges d'instruction et permis des appels et des pourvois contre les décisions des juridictions de jugement; des abus ont été commis dans ce domaine et les magistrats, comme les hommes politiques, sont conscients que la faculté de recourir trop facilement profite peut-être à l'inculpé au détriment de sa victime; aussi des aménagements seront-ils apportés dans ce domaine. En matière civile, il faut reconnaître que des jugements sont rendus parfois avec un retard incompatible avec une bonne administration de la justice; mais les magistrats sont des hommes et ils peuvent avoir des défaillances; par ailleurs, il ne faut pas nier le fait que certaines parties et leurs avocats ont aussi intérêt à faire parfois un usage immodéré des moyens de procédure. Tant le Conseil d'Etat que le Grand Conseil cherchent, avec le Pouvoir judiciaire, à lutter contre des procédés qui sont de nature à faire douter de la justice.
Dans cette perspective, il faut mentionner également les efforts qui sont accomplis pour que les jugements rendus soient exécutés, notamment en matière d'évacuation de "squatters". Certes, il convient dans ce domaine de tenir compte des contingences économiques et sociales, mais il faut veiller à ce que les décisions judiciaires soient respectées, faute de quoi la justice est discréditée et un laisser-aller s'installe, inadmissible dans un Etat fondé sur le droit. De même, en ce qui touche aux condamnations pénales, il est nécessaire que les peines prononcées soient exécutées et que les autorités chargées de l'exécution des peines n'accordent pas trop facilement des libérations anticipées qui ne remplissent pas les conditions strictes exigées par le législateur. Le peuple estime — parfois à juste titre — que les condamnations sont trop légères: la liberté redonnée trop rapidement nuit à l'effet exemplaire que la peine doit avoir. Peut-être peut-on voir ici une cause du déclin actuel du droit de grâce que le Grand Conseil, à la suite du Conseil des Deux Cents, détient au nom du peuple. Pour être utilisé à bon escient, ce droit ne devrait pas trouver un substitut dans les décisions trop nombreuses des organes d'application des peines.
J. D.
haut
[p. 167]
Une institution genevoise: le Procureur général
Pourquoi le Procureur général de la République et canton de Genève est-il un magistrat indépendant du gouvernement? Pourquoi, "maître de l'action publique", a-t-il le droit de "classer" une affaire? Pourquoi représente-t-il le pouvoir judiciaire face au pouvoir exécutif et au pouvoir législatif? Pourquoi reçoit-il librement citoyens et étrangers pour écouter leurs doléances et intervenir s'il y a lieu? C'est l'histoire qui explique ces particularités, dont la réunion est unique.
L'origine de cet office: le Conseil général du 8 février 1534
Pendant deux siècles, les Genevois ont résisté de concert avec leur évêque aux prétentions et aux entreprises de la Maison de Savoie. Mais lorsqu'elle réussit à placer l'un des siens sur le siège épiscopal, l'entente se rompit. Les premières victimes du conflit furent Philibert Berthelier, champion de l'indépendance appuyée sur l'alliance avec Fribourg, décapité en 1519, et Ami Lévrier, pourtant membre du Conseil épiscopal, qui s'opposait au jugement des causes civiles par le vidomne, organe du duc, et qui sera, sur ordre de Charles III, arrêté, emmené à Bonne et exécuté en 1524. L'évêque Pierre de la Baume attribue néanmoins la justice civile aux syndics, déjà chargés des causes criminelles, en 1527, en contrepartie de sa propre accession à la bourgeoisie. Toutefois, la crise s'aggrave, attisée par les progrès de la Réforme. A qui, des syndics ou de l'évêque, appartiendra-t-il de statuer sur le sort des meurtriers du chanoine Werly ? Estimant son autorité bafouée, Pierre de la Baume quitte la ville en juillet 1533.
Quelques mois plus tard, un certain Nicolas Porral est blessé par Nicolas Pennet, gardien des prisons épiscopales, tandis que Claude Pennet tue un citoyen nommé Bergier. On les cherche et on les trouve cachés en haut d'une tour de Saint-Pierre. Les syndics soupçonnent Jean Portier, secrétaire de l'évêque, d'avoir fomenté ces agressions. Une perquisition chez lui fait découvrir "des blancs-seings scellés du cachet du duc de Savoie et certaines lettres de constitution d'un gouverneur de Genève ou d'un lieutenant de l'évêque, avec pouvoir de juger de toutes les affaires criminelles", selon l'historien Jean-Antoine Gautier, qui poursuit: "Comme le cas était grave et qu'il s'agissait de choses qui allaient directement contre les libertés de la ville", on résolut "d'établir un Procureur général pour être instant dans le [p. 168: image / p. 169] procès qu'on ferait aux prévenus: Jean Lambert fut choisi pour faire cette fonction et fut ensuite confirmé Procureur général de la Ville, le jour de la création des syndics", par le Conseil général réuni le 8 février 1534, qui décida aussi que "dans un cas de cette nature, où il ne s'agissait pas moins que de la perte entière de ce que les citoyens avaient de plus cher, il ne fallait point exécuter les lettres de grâce que l'évêque ne manquerait pas d'accorder à Portier, et qu'on devait lui former son procès sans perte de temps". Il fut effectivement condamné à mort le 10 mars 1534 et exécuté. Le procureur fiscal de l'évêque est donc écarté au profit d'un magistrat émanant de la communauté, quand bien même Jean Lambert paraît n'être intervenu, dans la procédure dirigée contre Portier, que comme auxiliaire du Lieutenant de la justice.
Les premiers pas du Procureur général au XVIe siècle
Les Edits de 1543 prévoient, à propos du Procureur général, "que, en touttes causes qui appartiendront au bien et proffit de la Ville et à la conservation de l'état public, il soyt instant pour suivre comme procureur du commung, mesme aux causes criminelles qui en dépendront, qu'il soyt adjoint au Lieutenant".
Quant à son élection, elle est confiée au Petit Conseil sous réserve de la seule ratification du Conseil des Deux Cents. Mais elle reviendra au Conseil général en vertu de l'Edit de 1568. Pourquoi? C'est le professeur Georges Werner gui a trouvé la clé de ce problème. Il a découvert que, chargé de demander réparation des menées de Philibert Berthelier — fils du martyr de l'indépendance genevoise, et devenu "libertin" — le Procureur général Magistri s'était heurté, devant les juges de Lausanne, où Berthelier s'était réfugié, à la dénégation de sa qualité pour agir, puisqu'il "n'avait pas été établi dans son emploi par toute la communauté, mais seulement par le Conseil des Deux Cents". Et le fugitif de soulever le même argument devant le bailli bernois de Ternier, lequel prononça qu'on "n'écouterait point ce qu'il aurait à dire jusqu'à ce qu'il apportât une procuration du Conseil général de Genève". Ainsi fut fait le 28 mars 1557.
C'est en conséquence de ces incidents que le Procureur général sera élu par le peuple, comme nous dirions aujourd'hui. De plus, les Edits civils de 1568 l'assimilent au Lieutenant, dans les causes "criminelles et d'injure", où "demeurera le Lieutenant instant ou soit le Procureur [p. 170] général, ou tous deux ensemble, s'il fait besoin, jusqu'à ce que la sentence soit donnée". Cette situation se perpétuera jusqu'aux Edits de 1713, qui assignent au Lieutenant seul les nobles et lourdes tâches du juge, et au Procureur général seul d'être "instant dans tous les procès criminels jusques à sentence diffinitive", compétence qui lui est restée depuis lors.
L'essor de sa magistrature au XVIIe siècle
Les Edits politiques de 1568 exigeaient du Procureur général "qu'il veille sur les ordonnances et qu'elles soient bien observées..."; "qu'il assiste à la Cour du Lieutenant aux plaids, pour sçavoir et entendre s'il y aura intérêt pour le public en quelque cause... qu'il entrevienne et forme ses conclusions"; et qu'il agisse, on l'a vu, comme "procureur du commung"; "en touttes choses qui appartiendront au bien et proffit de la Ville".
Il était en outre chargé du recouvrement des amendes au nom de la Seigneurie, de la surveillance des tutelles et de la police des constructions.
Fort de ces missions importantes et diverses, le Procureur général, membre du Conseil des Deux Cents et du Conseil des Soixante, obtient, sur sa demande, l'entrée au Petit Conseil pour y exercer sa fonction de gardien des ordonnances. Telle est l'origine du fameux droit de remontrance, qu'il va exercer, dans l'intérêt public, soit de son propre mouvement, soit à la requête de citoyens, soit au profit du Conseil des Deux Cents.
C'est ainsi qu'en 1592, le Procureur général Philibert Blondel, se faisant le porte-parole de la population appauvrie par la guerre, préconise la prolongation d'un moratoire. Le Petit Conseil l'écoute et le Conseil des Deux Cents s'inspire de ses suggestions.
Il sera moins heureux lorsqu'il interviendra, l'année suivante, pour flétrir la modicité des contributions des conseillers à l'emprunt public auquel chacun devait souscrire selon ses moyens.
En 1596, le Procureur général Daniel Roset proteste contre l'envoi, par le Petit Conseil, du Syndic François de Chapeaurouge auprès du roi de France, sans que le Conseil des Deux Cents en ait été informé — remontrance qui "déplut extrêmement", au point que son propre père, l'illustre Michel Roset, fut chargé de l'en blâmer. De même, le Procureur général Jacques Des Arts reproche au Petit Conseil, en 1611, des démarches diplomatiques [p. 171] entreprises sans en référer au Conseil des Deux Cents. Lui fut "renvoyé avec douces paroles".
Quant à la remontrance du Procureur général Pierre Gallatin, en 1649, sur l'âge requis pour être élu au Conseil des Deux Cents — il préconisait celui de vingt-cinq ans au moins — elle est rejetée sans discussion par le Premier Syndic.
En 1667, un grave conflit oppose le Petit Conseil au Conseil des Deux Cents, qui prétend siéger encore, alors que le premier Syndic Colladon avait levé la séance, et qui appelle à sa présidence l'Auditeur Jean Sarasin. Sur quoi le Petit Conseil se saisit de sa personne et l'incarcère. Le Conseil des Deux Cents s'assemble et s'insurge par la voix du Procureur général Pierre Lullin. Le Syndic Grenus exhorte les conseillers à se disperser, "à peine de l'indignation de la Seigneurie". Ils se réuniront tout de même le lendemain, à Saint-Pierre, avec une foule de citoyens et bourgeois et seront harangués par le Procureur général, qui justifie l'attitude du Conseil des Deux Cents, tout en demeurant respectueux des prérogatives du Petit Conseil. Ce discours pondéré apaise les esprits. Les syndics se résolvent à libérer Sarasin. La Vénérable Compagnie des pasteurs s'emploie à restaurer la concorde. Le pasteur Mestrezat, le Premier Syndic Colladon et le Procureur général Pierre Lullin s'assurent les uns les autres de leur bonne foi et de leur souci du bien public. Il est décidé de ne pas relater ces événements dans les registres du Conseil.
Il arrive aussi que le zèle des conseillers se refroidisse: en 1683, le Procureur général Pictet se voir réduit à requérir que "les absents et les tardifs, qui étaient en grand nombre, soient amendés".
Il n'y a pas eu que des grincements. Lorsque le Syndic Le Fort fait rapport, en 1688, sur sa négociation à Paris à propos des dîmes, c'est le Procureur général Pierre Trembley qui lui témoigne "la reconnaissance qu'on a de ses services". En 1691, nos députés à Zurich et à Berne sont aussi remerciés par le Procureur général au nom du Conseil.
En 1696, le Procureur général Grenus intervient au sujet des négociants étrangers, c'est-à-dire des nombreux réfugiés dont la concurrence irritait. Quoiqu'il ne fût pas d'accord sur les plaintes portées devant lui, il les transmit, ce qui eut pour effet que tout nouveau commerce dut être désormais expressément autorisé par le Petit Conseil.
Dans un autre sens, en 1698, le Procureur général Abraham Mestrezat élève la voix contre des mesures trop protectionnistes projetées par le Petit Conseil. Il obtient gain de cause.
[p. 172]
Le Procureur général dans les troubles du XVIIIe siècle
Le Procureur général Jean Buisson — qui avait été élu contre Pierre Fatio — combat devant le Petit Conseil, en 1704, un nouveau droit d'entrée sur les vins "étrangers", quand bien même il n'y était personnellement pas opposé. Ses remontrances ont néanmoins pour conséquence que les restrictions sont toutes rapportées. Ce droit de remontrance, exercé avec des issues diverses et parfois supporté avec agacement par les syndics, va néanmoins être inscrit dans les textes en 1707. Il faut dire qu'en ce temps-là les autorités craignaient les rassemblements improvisés de citoyens et les "pétitionnements", signes avant-coureurs de la subversion: une pétition, pourtant forte de six cents signatures, présentée par un certain De La Chenaz, est simplement jetée au feu par le Premier Syndic, Jean de Normandie, le 17 janvier 1707. Le peuple s'émeut de ce "brûlement". Pierre Fatio se dresse contre les syndics et le Procureur général Jean Du Pan. Les assemblées se multiplient. Alertées, Leurs Excellences de Berne dépêchent des troupes. Pierre Fatio est arrêté, condamné à mort et arquebusé le 7 septembre. Mais au cours de cette effervescence, le Conseil général, convaincu par le syndic Jean-Robert Chouet, avait admis, le 26 mai 1707, que "la voie des signatures est dangereuse" — "chacun ayant toujours pu et pouvant s'adresser, et remettre même si bon lui semble, sa proposition par écrit à Messieurs les Syndics, qui ont la direction et le gouvernement de l'Etat, ou au Procureur général, qui a aussi le droit, de par l'Edit, de faire des instances et remontrances, et particulièrement sur les plaintes et sur les réquisitions que chacun ou plusieurs citoyens peuvent lui faire, sans qu'à cet égard il doive différer de les faire à cause du petit nombre de ceux qui s'adressent à luy". Comme le professeur Werner le souligne, il ne s'agit pas là d'une concession accordée aux mécontents, mais bien plutôt du rappel d'un mode d'expression préexistant, consacré dans l'Edit afin de canaliser les critiques et suggestions populaires. Le 12 juin 1713, le Procureur général Louis Le Fort prend la parole pour "abattre l'impôt sur le caffé".
Le mémoire du Procureur général Le Fort
En janvier, en août et en décembre 1715, il fait usage à trois reprises de son droit de remontrance, contre un nouvel [p. 173] impôt, dit "du papier marqué" (timbré). Il ne sera pas suivi. Mais son insistance détermine le conseiller Jacob de Chapeaurouge à prendre la plume, peut-être à l'instigation des syndics, pour combattre ce qu'il tient pour un pernicieux abus: l'entrée du Procureur général au Petit Conseil pour s'y exprimer sur des sujets de son choix. Tout en concédant que le Procureur général Louis Le Fort est "sage et bien intentionné", le conseiller de Chapeaurouge s'effraie du danger que représenterait un Procureur général "turbulent et ambitieux", qui dominerait les Conseils et imposerait ses vues, alors qu'il ne devrait être qu'un "officier subalterne établi pour poursuivre, sous les ordres des syndics, les intérêts publics".
Le Procureur général Louis Le Fort répondit fermement, par un mémoire aussi pertinent que solide, fondé tant sur les Edits que sur l'usage, que sa mission de gardien des ordonnances s'exerçait de manière générale à l'égard de tous, citoyens, conseillers et syndics, indépendamment de toute répression pénale éventuelle, l'autorisation préalable de la Seigneurie n'étant requise que lorsqu'il risquait d'engager des frais et dépens en qualité de procureur fiscal.
Tandis que Chapeaurouge va jusqu'à écrire que le Procureur général "est l'homme des Syndics et des Conseils contre les particuliers", Le Fort affirme hautement que "la vigilance du Procureur général doit s'étendre sur toutes les personnes" qui sont soumises aux ordonnances et que, "comme il n'y en a aucune depuis la première jusqu'à la dernière de l'Etat qui ne soit sujette à la Loi, son attention s'exerce dans les Conseils, hors des Conseils, aussi bien que par devant Monsieur le Lieutenant". Il estime juste que pour être assurés que leurs voeux soient bien transmis jusqu'au Conseil des Deux Cents, les citoyens puissent s'adresser non seulement aux syndics, mais aussi au Procureur général, dont c'est le devoir d'agir "avec tout le zèle et toute l'application dont il est capable", de sorte que "ses instances doivent être pressantes et ses remontrances vives suivant le cas et la matière, car ce n'est qu'en cela uniquement que consiste tout son pouvoir; aucune considération ni d'intérêt ni d'autorité ni de respect ne doit le détourner de son devoir, ni prévariquer ni dissimuler ou se taire lorsqu'il l'appelle à parler". En résumé, "il est donc l'homme du peuple en opposition avec les Conseils, lorsque ceux-ci attentent à sa liberté et il doit être l'homme des Conseils et des Syndics de la République lorsque le peuple de cette même République se révolte ou se rebelle contre leur juste autorité". Lorsqu'il se fut aperçu que Le Fort avait répondu victorieusement au factum du conseiller de Chapeaurouge, [p. 174] le Petit Conseil s'avisa qu'il aurait mieux valu s'inspirer de la maxime "quieta non movere". Il enjoignit aux intéressés de rechercher et de retirer les copies de leurs exposés et leur enjoignit "de ne conserver aucune aigreur à ce sujet, mais de vivre en bons amis". La controverse fut ainsi tenue en sourdine. Il reste que le Procureur général Louis Le Fort a exprimé à cette occasion, de manière nette et impérissable, la conception genevoise de sa magistrature, de gardien indépendant de la loi et de l'ordre public et de porte-parole des citoyens et des Conseils. Il sera d'ailleurs expressément approuvé tant par le conseiller Jean-Louis Chouet que par les historiens Antoine Tronchin et Edouard Mallet, lequel définit le Procureur général: "magistrat populaire chargé généralement de maintenir les droits et le profit de la communauté, et spécialement de poursuivre la répression des délits".
Il importe d'ajouter que l'usage s'établit qu'en début d'année, au nom du Conseil des Deux Cents, le Procureur général complimentât et remerciât les syndics "des soins et des peines qu'ils se sont donnés" pour l'Etat. Il abordait parfois des thèmes plus généraux; son allocution est alors jointe au registre du Conseil, comme le "discours très convenable" fait en 1745 par le Procureur général Galiffe "pour recommander l'amour du travail dans la noble vue de servir sa patrie", en un temps où l'on se trouvait "dans l'embarras pour remplir les emplois".
Les Procureurs généraux se consacrent désormais de plus en plus aux poursuites pénales, qui leur sont réservées depuis 1713. Leur rôle politique n'est toutefois pas oublié: l'agitation de 1734 commencera par la remise d'une liste de revendications à chacun des Syndics et au Procureur général. On relèvera qu'en dépit de la colère populaire, il n'intentera pas de poursuites contre le Syndic de la Garde, Jean Trembley, qui avait donné l'ordre de "tamponner" (boucher) les canons de Saint-Gervais pour empêcher d'éventuels insurgés de s'en servir.
Le Règlement de la Médiation du 7 avril 1738, élaboré par les envoyés de Sa Majesté très Chrétienne et des louables Cantons de Zurich et de Berne, maintient notamment l'élection du Procureur général par le Conseil général, le droit de représentation et l'exclusivité de la poursuite pénale; il confirme les Edits de 1568 mis à jour.
[p. 175]
Les grondements de la tourmente révolutionnaire
En 1762, le Procureur général Jean-Robert Tronchin se distingue en requérant que l'Emile et le Contrat social soient lacérés et brûlés, tout en prédisant qu'un épais nuage s'élèverait de leurs cendres. Une quarantaine de citoyens "représenteront" au Conseil que l'écrivain n'a pas été entendu avant d'être condamné. Le Petit Conseil se refuse à rouvrir le procès, se prévalant de son droit de veto, dit "droit négatif", que Tronchin justifie, dans ses Lettres écrites de la Campagne, estimant que "ce pouvoir de s'opposer aux innovations va directement au grand but que se propose une société politique, celui de se conserver, en conservant sa constitution". On sait que Rousseau n'a pas dédaigné d'y riposter, par ses Lettres écrites de la Montagne.
Natifs, Représentants et Négatifs s'affrontent de nouveau. Après le refus d'un projet de règlement proposé par les Puissances médiatrices, en 1766, un Edit plus favorable aux Natifs est voté par le Conseil général le 11 mars 1768. La majorité y salue l'"Edit de conciliation", tandis que les Négatifs, bien décidés à ne pas l'appliquer, le qualifient d'"Edit des pistolets".
Rebutés et déçus, les Natifs se tournent vers la France. Vergennes, ministre de Louis XVI, les encourage en leur écrivant directement. En décembre 1780, le Procureur général Jacques-Antoine Du Roveray stigmatise cette immixtion étrangère dans les affaires de la République. Sa harangue percutante, publiée, suscite la colère de la Cour de Versailles, qui exige réparation. Les Conseils plient et Du Roveray est destitué. Mais les citoyens s'indignent, prennent les armes, assiègent l'hôtel de ville; les autorités capitulent et le Conseil général adopte, le 10 février 1781, l'"Edit bienfaisant", qui consacre l'égalité civile des Natifs.
Considérant que cet Edit lui avait été arraché par la violence et n'avait pas été adopté par tous les "ordres" de l'Etat (c'est-à-dire, outre le Conseil général, les Syndics, le Petit Conseil, le Conseil des Soixante et le Conseil des Deux Cents), le Petit Conseil renâcle et tergiverse. Le mécontentement gronde. En avril 1782, le Procureur général Butini demande audience aux syndics et les adjure de ne pas se cantonner dans une attitude négative, mais de se prêter à des négociations. Il est sèchement éconduit par le Premier Syndic qui clôt l'entretien par "C'est tout ce que vous avez à dire?" et le salue. Cette intransigeance déclenche les catastrophes que Butini prévoyait: Représentants et Natifs se mobilisent, [p. 176] s'emparent du pouvoir et doivent faire face à l'intervention de la France, de la Sardaigne et de Berne. Ils se bercent de l'espoir de résister à outrance, jusqu'à ce que les troupes des Puissances garantes se massent autour de Genève, canons pointés sur la ville. Il faut se soumettre; Genève est occupée; Butini démissionne; Du Roveray et ses amis sont exilés. Un Conseil général, dont sont exclus tous ceux qui s'étaient soulevés, vote, le 21 novembre 1782, l'"Edit de Pacification", aussitôt dénommé "Edit Noir" par les opposants. Il reste que le Procureur général continue d'être élu par le Conseil général et si les citoyens sont étroitement bridés dans l'expression de leurs représentations, son droit de "faire telles remontrances ou réquisitions qu'il estimera convenables" est formellement maintenu.
L'hiver 1788-1789 sera exceptionnellement rigoureux; le prix du pain est augmenté; une insurrection populaire éclate. Sous l'influence du Procureur général Jacob François Prévost, les rigueurs de l'Edit Noir sont atténuées par celui du 10 février 1789. Les exilés sont autorisés à revenir. Du Roveray, de retour dans sa patrie, prend une part prépondérante à la rédaction d'un nouvel Edit, du 22 mars 1791, et du Code genevois, du 14 novembre 1791, auquel son nom est attaché. Le Conseil général est maintenant le véritable souverain de la République. Quant à la charge de Procureur général, "première d'entre les magistratures qui ne sont pas exclusivement conférées à des membres du Petit Conseil", elle vaut à son titulaire "les mêmes titres, distinctions et honneurs militaires que les conseillers du Petit Conseil". Il doit veiller "à tout ce qui peut intéresser l'ordre public", intervenir en donnant ses conclusions "devant quelque Tribunal ou Conseil que ce soit", "être partie publique dans tous les procès criminels", et "rapporter au Petit Conseil toutes les représentations concernant le bien de l'Etat", la "voie des signatures" continuant d'être interdite.
De cette oeuvre des Représentants, les Natifs ne sont pas encore satisfaits. Ils en appellent de nouveau à la France. En septembre 1792, un corps d'armée, aux ordres du général de Montesquiou, paraît à proximité de la ville, qui alerte Berne et Zurich et délègue Jacob François Prévost, le procureur général d'alors, accompagné d'Ami Lullin et de François D'Ivernois auprès du général marquis, pour le persuader de s'éloigner de Genève si les troupes suisses se retiraient aussi, négociation délicate, dont ils s'acquittèrent avec un succès inespéré.
Le 12 décembre 1792, le Conseil général vote l'égalité entre les citoyens, les natifs et les habitants. Une assemblée nationale est chargée d'élaborer une nouvelle constitution, [p. 177] qui sera précédée d'une admirable "Déclaration des droits et des devoirs de l'homme social", du 5 juin 1793. L'Acte constitutif, suivi des Lois politiques, textes adoptés le 5 février 1794, consacrent une complète séparation des pouvoirs. Le Procureur général, qui a rang immédiatement après les syndics, est chargé de "la surveillance générale pour l'exécution des lois", avec faculté "de faire, à cet effet, aux autorités constituées, telles réquisitions qu'il estimera convenables". Il doit pourvoir à la défense des droits des absents, des interdits, des veuves et des mineurs; il lui incombe toujours "d'être instant pour la punition des coupables" des délits qui parviennent à sa connaissance.
Cette Constitution de 1794 si libérale, si démocratique et si détaillée (elle compte plus de mille articles), n'a pas préservé Genève des déchaînements de la Terreur: en été de la même année, un tribunal révolutionnaire qui ne s'embarrasse ni d'un accusateur public, ni de défenseurs, condamne à mort trente-sept citoyens, dont neuf seront exécutés, parmi lesquels, le 24 juillet 1794, l'ancien Procureur général Jacob François Prévost et, le 2 août, l'ancien Procureur général François Naville, qui avait lancé l'idée d'une Chambre des tutelles. La tradition rapporte, de manière significative, que pour sa défense, Naville s'est écrié: "Citoyens... Pendant six ans que j'ai exercé l'emploi de Procureur général, nuit et jour, ma porte a-t-elle été jamais fermée à aucun de vous?", propos qui n'émurent pas ses adversaires, qui le tenaient pour trop lié à l'Ancien Régime, tout comme l'ancien Syndic François Fatio, petit-fils de Pierre Fatio, qui tomba à ses côtés.
La Restauration et le XIXe siècle
La Restauration porte bien son nom. En vertu de la Constitution du 23 août 1814, le Petit Conseil ressuscite sous la forme d'un Conseil d'Etat de vingt-huit membres, qui "président" un Conseil représentatif de 250 membres. Les syndics, le Lieutenant, le Procureur général, le Trésorier, les conseillers d'Etat et les auditeurs ne sont plus élus par le Conseil général, mais par ce Conseil représentatif, avec le concours des membres de la Compagnie des pasteurs, du Consistoire, de l'Académie et d'autres notables.
Contrairement à ce qu'on pourrait croire, ce système sera maintenu par la Constitution du 7 juin 1842 et par celle du 24 mai 1847, en ce que l'élection des magistrats de l'ordre judiciaire est confiée à un Grand Conseil de cent membres. Il faudra attendre jusqu'au 29 octobre 1904 pour que leur élection revienne "à l'ensemble des électeurs réunis en Conseil général". [p. 178]
Quant à la séparation des pouvoirs, elle subit une éclipse. La Constitution de 1814 la pose en principe, mais attribue encore certaines fonctions judiciaires aux syndics et conseillers d'Etat. Celles de 1842 et de 1847 la proclament. Encore faut-il en faire l'apprentissage. Par exemple, le gouvernement de James Fazy voulait qu'on poursuivît, comme coupable de complot contre la sûreté de l'Etat, un aventurier déséquilibré du nom de Schnepp, dont les menées, si elles avaient été avérées, auraient compromis les conservateurs. Jugeant les preuves inexistantes, le Procureur général William Turrettini refusa d'exercer l'action pénale, rechercha en vain l'appui du Grand Conseil, entièrement dévoué à Fazy, et démissionna après deux ans de magistrature, en 1851.
Son successeur, le Procureur général Etienne Hervé, quoique plus proche du gouvernement, ne fut pas plus docile. A propos d'un texte légal sur les cercles, il sut rappeler au Conseil d'Etat et au Grand Conseil que la bonne foi des citoyens devait être protégée, quand bien même il plaisait au Législatif et à l'Exécutif de redonner vie à une norme sur le jeu, dont ils avaient l'un et l'autre, quelques années auparavant, proclamé et constaté la désuétude.
Après l'éviction de James Fazy, William Turrettini redevient Procureur général et assumera ces fonctions pendant onze ans. Lui succédera le Procureur général Benjamin Dufernex qui s'illustrera en défendant, en qualité de député (cumul qui sera possible jusqu'au 31 mars 1901), le projet de Code d'instruction pénale qui introduisait l'information contradictoire, c'est-à-dire l'enquête, par le juge d'instruction, en présence des parties assistées de leurs avocats.
[p. 179]
Les attributions actuelles du Procureur général
Les textes qui régissent aujourd'hui les attributions du Procureur général sont l'aboutissement fidèle de quatre siècles et demi de législation genevoise.
En particulier, les dispositions de la loi d'organisation judiciaire actuellement en vigueur reproduisent presque mot pour mot celles de la loi du 15 février 1816, elles-mêmes visiblement inspirées du code Du Roveray de 1791: exercer les poursuites pénales en cas d'infractions et déférer les manquements disciplinaires au Conseil d'Etat; veiller au maintien des lois et règlements, à la conservation des droits et propriétés publiques et, en général, à tout ce qui peut concerner l'ordre public; intervenir devant la Cour de justice et le Tribunal de première instance, dans les cas prévus par la loi et lorsqu'il l'estime nécessaire en raison de l'intérêt public; tenir la main à l'exécution des jugements.
La poursuite pénale
Depuis 1713, l'action publique — la poursuite pénale —est du ressort du Procureur général, assisté de ses substituts. Il dispose de la police judiciaire, met en oeuvre les juges d'instruction, participe aux débats devant la Chambre d'accusation, appelée à contrôler leurs décisions et, une fois l'information achevée, il décide soit de classer la cause, en prenant des mesures propres à éviter la récidive, soit de la poursuivre, en portant l'accusation devant le Tribunal de police, la Cour correctionnelle ou la Cour d'assises, suivant la gravité de l'infraction.
Ses pouvoirs ne sont pas absolus: il est lui aussi soumis au contrôle de la Chambre d'accusation, qui peut opposer à ses réquisitions une ordonnance de non-lieu, et par-devant laquelle le plaignant et même le dénonciateur peuvent attaquer une décision de classement.
Lorsqu'un jugement est contesté, il agit devant les juridictions de recours: Cour de justice, Cour de cassation, Tribunal fédéral. Il représente la Justice genevoise devant la Commission et la Cour européennes des droits de l'homme, concurremment avec les agents de la Confédération.
Si une affaire étend ses ramifications hors du Canton, le Procureur général détermine le for compétent, d'entente avec les autorités d'autres Etats, de la Confédération ou d'autres cantons, lesquels sont parfois représentés, non par [p. 180] leur Procureur général, mais par le Juge d'instruction cantonal, les juges instructeurs, la Chambre d'accusation, le Verhâramt ou le Statthalter. Depuis le 14 avril 1984, il a le droit, comme le juge d'instruction, lorsque des faits de gravité mineure sont établis, de prononcer condamnation jusqu'à trois mois d'emprisonnement et cinq mille francs d'amende, sous réserve de recours de l'intéressé auprès du Tribunal de police. Cette innovation renoue avec une compétence ancienne: dès 1570, le Procureur général a eu le pouvoir d'infliger seul une amende de vingt-cinq écus, ce qui était "une grosse somme en ce temps-là", écrira Le Fort en 1715.
Le maintien de l'ordre public
Les termes très généraux de la seconde mission ("veiller au maintien des lois et règlements... et en général à tout ce qui peut concerner l'ordre public") permettraient-ils à un Procureur général "turbulent et ambitieux" d'intervenir à tort et à travers et d'agiter l'Etat? Non, car en posant en principe la séparation des pouvoirs, la Constitution a voulu que "le pouvoir arrête le pouvoir", selon l'expression de Montesquieu et a circonscrit le champ d'activité de chacun d'eux.
La séparation des pouvoirs n'est pas l'hostilité ni le silence des pouvoirs: elle est dialogue, parfois critique, et collaboration dans l'indépendance. C'est ainsi que — les juges devant être préservés des remous de la vie publique, afin que leurs décisions soient exemptes d'influences étrangères à la cause, à la loi et à leur conscience — c'est le Procureur général qui répond, dans la mesure compatible avec le secret de fonction, aux questions du Grand Conseil et du Conseil d'Etat, ou qui se manifeste auprès d'eux pour faire connaître son avis ou celui de la magistrature. Comment la justice traite-t-elle ce scandale qui éclabousse des personnalités ou des institutions? Y a-t-il lieu de combler des lacunes, d'améliorer les mécanismes ou de remédier aux effets malencontreux d'un règlement ou d'une loi? Un juge d'instruction pouvait-il perquisitionner dans un hôpital cantonal? Telle administration avait-elle le droit de régler en son sein une affaire en réalité pénale? Ce fonctionnaire est-il obligé de répondre aux questions de la justice civile? Voilà des problèmes à propos desquels les pouvoirs de l'Etat entrent en contact, et parfois en discussion, car la séparation des pouvoirs n'est pas un acquis intangible, mais un équilibre précaire, qu'il faut sans cesse rajuster, voire reconquérir.
[p. 181]
Les interventions en justice
Comme la loi de 1816 et celles qui lui ont succédé, la loi d'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 disposait que par-devant la Cour de justice et le Tribunal de première instance, "le Procureur général ou ses substituts sont entendus toutes les fois qu'ils estiment leur ministère nécessaire ou l'ordre public intéressé". Il ne s'agit nullement d'apprendre le droit aux juges ou de leur dicter leurs décisions, mais seulement d'apporter aux débats des indications ou des raisons que les plaideurs n'ont pas pu ou pas voulu communiquer.
Une récente tentative de vider ce droit de sa substance a été rejetée le 28 mai 1984 par le Grand Conseil, qui a décidé de le maintenir et même de l'étendre en remplaçant la notion d'"ordre public" par celle d'"intérêt public", plus large. Le législateur a considéré que, plutôt que des interventions occultes, mieux valait que l'avis de la collectivité, du Conseil d'Etat, d'un département, d'une administration ou du Procureur général personnellement, fût exposé, ouvertement et loyalement, aux parties en procès, ainsi mises à même d'y répondre, de le nuancer, voire de le contester.
Son intervention est aussi prévue dans les causes concernant l'état des personnes, les mineurs et les interdits. C'est à l'Edit de 1568 que remonte ce souci de le charger de la défense des "personnes méritant une protection plus spéciale", selon les termes de son serment, inchangé depuis 1816.
C'est aussi en vue d'assurer une application correcte et harmonieuse de la loi à des procédures connexes et parallèles que le Procureur général fait partie des Commissions de surveillance des avocats, des notaires, des huissiers judiciaires, et du Conseil de surveillance psychiatrique, qui contrôle les mesures prises à l'égard des personnes atteintes de maladies mentales qui présentent un danger pour elles-mêmes ou pour autrui.
L'exécution des jugements
Depuis 1816, il est chargé de "tenir la main à l'exécution des jugements" au sens large et non pas seulement des condamnations pénales. Il est souvent nécessaire, en effet, de recourir à la force publique, après analyse de la situation de fait et de droit, pour lui donner des instructions appropriées.
La loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite a confié aux Offices des poursuites et des faillites [p. 182] le recouvrement des sommes d'argent, sous la surveillance des juridictions civiles. Reste à assurer le respect des ordonnances provisionnelles de saisie ou d'arrêt de travaux, à résoudre concrètement les douloureux conflits entre parents divorcés ou en instance de divorce au sujet des décisions fixant leurs rapports avec leurs enfants, à procéder à l'évacuation de locataires, pour la plupart désemparés, souvent misérables ou déséquilibrés, de sorte que leur relogement pose des problèmes lancinants, auxquels la population n'est pas indifférente.
Le droit de remontrance
Et le droit de remontrance? Il disparaît des textes constitutionnels dès 1842: l'avènement d'institutions démocratiques permet désormais aux citoyens, isolés ou en groupe, de s'exprimer publiquement, sans entraves, et de s'adresser à des Conseillers d'Etat et à des députés certainement plus accessibles que ne l'étaient les syndics et conseillers de l'Ancien Régime.
Cependant, en vue de s'acquitter efficacement de ses multiples missions, le Procureur général, à l'exemple constant de tous ses prédécesseurs, doit tenir sa porte largement ouverte, recevoir citoyens et citoyennes, Confédérés et étrangers, et écouter avec attention leurs informations et leurs doléances, qui appellent tantôt une instruction pénale, souvent une explication sur le fonctionnement de l'administration et de la justice — notamment sur le temps que prennent les enquêtes et le respect du droit d'être entendu, la pesée des arguments et la rédaction des décisions — et plus d'une fois une intervention pour débloquer une procédure, redresser une pratique erronée au vu d'une législation ou d'une jurisprudence nouvelles, prévenir ou réparer une injustice. L'expérience enseigne que, menées avec discernement, les démarches d'un magistrat "sage et bien intentionné" sont écoutées, tant par les serviteurs de l'Etat que par les particuliers.
C'est ainsi qu'héritiers des Pierre Lullin et des Louis Le Fort, les Procureurs généraux de la République et canton de Genève ont continué d'assumer à la fois les redoutables devoirs de l'accusateur public, les fonctions de porte-parole et de défenseur du Pouvoir judiciaire, la tâche épineuse de l'exécution des jugements et le rôle apaisant de l'"ombudsman".
R. F.
haut
[p. 183]
Les auxiliaires de la justice
Les avocats
"J'aurais voulu être avocat: c'est le plus bel état du monde" a écrit Voltaire.
Auxiliaires de la justice, les avocats l'escortent dans tous les pays libres. A Genève, devant les juridictions civiles, pénales et administratives, chaque justiciable peut, sauf certaines exceptions, se faire assister ou représenter par un avocat. Il lui est aussi loisible de comparaître en personne. Toutefois, la loi lui impose parfois l'assistance d'un avocat: ainsi, lorsqu'il se trouve déféré devant la Cour d'assises, vu la gravité de la cause.
Les avocats ne bénéficient pas d'un monopole absolu en matière d'assistance et de représentation devant les tribunaux: d'autres mandataires qualifiés sont admis selon la procédure régissant la juridiction administrative (par exemple les experts-comptables), celle des baux et loyers (secrétaires d'associations de bailleurs ou de locataires) et celle des prud'hommes (secrétaires syndicaux ou patronaux devant la chambre d'appel). Au surplus, l'activité judiciaire n'absorbe pas tout le temps des avocats, qui donnent également des conseils juridiques loin du prétoire, dans la sérénité de leur cabinet, et siègent même dans des conseils d'administration.
Le premier acte connu relatif aux avocats date du 5 octobre 1450. Supprimé par la constitution genevoise du 5 février 1794, le "corps des avocats", rétabli par la loi du 22 Ventôse an XII (13 mars 1804), disparut comme tel quelque temps encore lorsque James Fazy fit promulguer la loi du 4 juin 1851 "sur la profession libre d'homme de loi". Il fut rapidement rétabli, car on sait qu'il est "plus facile de critiquer les avocats que de s'en passer" et la loi du 10 juin 1863 introduisit la distinction entre "avocats" (genevois, docteurs ou licenciés en droit ayant accompli un stage de deux ans) et "agréés" (ceux qui avaient justifié de connaissances pratiques suffisantes démontrées par un examen spécial).
Au cours du temps, la formation des avocats à Genève a varié en étendue. Ainsi, par exemple, au XVe siècle déjà, les avocats devaient, pour être admis comme tels, avoir fréquenté la Cour de l'official pendant plusieurs années; ils subissaient un examen sur le droit de fond et la procédure. En revanche, sous le régime de la loi du 4 juin 1851, tout citoyen pouvait apparaître devant les tribunaux pour défendre la cause d'un tiers: les exigences de qualification avaient été abolies. Aujourd'hui, pour être autorisés à porter le titre d'avocat, les candidats, citoyens suisses, licenciés ou docteurs en droit (ou au bénéfice d'une équivalence) sont tenus, à l'issue d'un stage d'au moins deux ans, de passer une série [p. 184] d'examens spécialement destinés à contrôler leurs connaissances juridiques.
Sous la Restauration, les avocats constituaient un ordre officiel, auquel ils appartenaient obligatoirement. De nos jours, ils s'organisent librement. L'actuel Ordre des avocats, fondé en 1895, regroupe la plupart des praticiens du barreau. Quelques avocats, néamoins, s'en tiennent à l'écart (certains d'entre eux ont adhéré à l'Association des juristes progressistes). En 1943, le Grand Conseil avait adopté une loi instituant un ordre officiel, mais ce texte, soumis au référendum, a été rejeté par le peuple.
Les avocats sont liés par des règles de déontologie résumées dans leur serment (rédigé en 1816 par François Bellot, puis modifié) qu'ils prêtent au début du stage, et dans leurs us et coutumes. L'un des principes les plus importants (sanctionné par le code pénal) est celui du secret qu'ils doivent garder: les justiciables trouvent en eux un "confident nécessaire" (à l'instar de l'ecclésiastique ou du médecin). Les avocats répondent du respect des règles de la profession devant le conseil de l'Ordre (lorsqu'ils en sont membres) et, tous, devant la Commission de surveillance des avocats.
L'avocat fixe lui-même les honoraires qui lui sont dus. Sans être lié par un tarif, il décide en considération du travail effectué, de la complexité et de l'importance de l'affaire, de la responsabilité assumée, du résultat obtenu et de la situation du client. En cas de litige, une commission officielle de taxation tranche. Les justiciables démunis peuvent d'ailleurs obtenir une aide gratuite: l'assistance juridique prend alors en charge une rémunération partielle de l'avocat.
A Genève, le développement du secteur tertiaire a entraîné une forte croissance du nombre des avocats. En 1984, l'on comptait quelque 500 avocats, dont 440 membres de l'Ordre et 60 non membres (à quoi il faut ajouter 120 stagiaires). Le nombre des avocats porteurs d'un brevet est passé en quelques années de 235 (1977) à 790 (1990): l'augmentation est considérable!
La nouvelle "loi sur la profession d'avocat", remplaçant les dispositions de la loi sur l'organisation judiciaire complétée par le règlement sur la profession, comportant une soixantaine d'articles, aboutissement de travaux entrepris en 1979 déjà, est entrée en vigueur en 1985: ses dispositions n'ont pas modifié l'organisation que nous venons de décrire.
D. P.
haut
[p. 185]
Les notaires
Les notaires genevois ont un statut un peu particulier, à mi-chemin entre le secteur public et le secteur privé; c'est un des rares points qu'ils ont en commun avec leurs collègues vaudois, valaisans ou neuchâtelois: alors qu'ils travaillent à leur compte, dans leur propre étude et sans garantie de rétribution, c'est le Conseil d'Etat qui les nomme, leur confère le droit officiel de recevoir les actes, leur fait prêter serment et surveille leur activité. Les minutes des notaires, c'est-à-dire les originaux des actes qu'ils rédigent, avec la signature des comparants, sont en quelque sorte la propriété de l'Etat: en effet, après la cessation d'activité d'un notaire, les minutes restent à l'étude pendant cinquante ans au plus — période pendant laquelle les demandes d'expéditions sont assez fréquentes — après quoi elles sont versées aux Archives de l'Etat et font désormais partie du patrimoine de la République. Après les notaires, l'Etat de Genève devient ainsi dépositaire des droits des particuliers, car c'est bien de cela qu'il s'agit. Si l'on a depuis fort longtemps, pratiquement depuis l'apparition du notariat à Genève (deuxième quart du XIVe siècle), conservé avec beaucoup de soin ces actes et contrats rédigés par les notaires, c'est qu'ils témoignent de la volonté des particuliers, déterminent leurs droits dans leurs rapports avec d'autres particuliers, fixent les devoirs respectifs des parties dans un contrat.
C'est le plus souvent pour disposer de biens, mobiliers ou immobiliers, que l'on se rend chez le notaire: ventes, successions, etc. Chacun connaît l'importance de la propriété dans notre civilisation. Chacun connaît aussi l'importance de la preuve écrite, du papier authentifié qui permettra en cas de litige de prouver ses droits.
Davantage encore que l'avocat, le notaire est gardien des secrets des personnes qui s'adressent à lui; il est en contact avec elles aux moments les plus importants de leur vie. Habitué à la discrétion, strictement tenu au secret professionnel, le notaire est un personnage parfois effacé, caché dans son étude. On l'imagine la plume d'oie à la main, même si depuis longtemps déjà les actes sont tapés à la machine à écrire, voire à la machine de traitement de texte, par une secrétaire, secrétaire qui remplace peu à peu le clerc de notaire en voie de disparition. L'image du notaire genevois est assez différente de celle de ses voisins d'autres cantons: sa qualité d'officier public lui confère autorité et dignité; sa profession est incompatible avec celle d'avocat depuis 1834. Alors que certains cantons fixent un nombre maximum de notaires, la loi genevoise en prévoit un nombre minimum: quinze. [p. 186]
Le notaire n'a pas toujours été aussi discret. Jusqu'au début du XVIIIe siècle, il avait la plupart du temps une petite échoppe dans la rue; d'autre part, il intervenait plus fréquemment dans la vie des Genevois, par une gamme plus vaste d'actes. A une époque où il n'existait pas encore de banque de crédit, il jouait un rôle économique non négligeable en mettant en rapport détenteurs de capitaux et artisans ou commerçants en quête de liquidités.
Les principaux outils de travail du notaire sont le Code civil et le Code des obligations. Mais à côté de ces deux grands textes, une loi et deux règlements cantonaux organisent la profession: la loi sur le notariat du 25 novembre 1988, son règlement d'exécution de 1989 et le règlement fixant le tarif des émoluments des notaires de 1985. Ces textes énoncent les devoirs des notaires dans l'exercice de leur métier, les conditions et la procédure de nomination, la composition de la commission de surveillance et les sanctions disciplinaires dont ils sont passibles. [p. 187]
Tout comme l'huissier judiciaire et l'agent d'affaires, le notaire genevois n'est pas obligatoirement porteur d'un diplôme universitaire. Les examens d'admission sont simplement plus nombreux pour qui n'est pas docteur ou licencié en droit. La durée du stage, quatre ans, est particulièrement longue. Une fois nommé, le notaire peut se mettre à son compte, mais la plupart du temps il préfère entrer dans une étude existante et bénéficier du fonds de commerce que représentent les minutes accumulées pendant des générations, qui lui assurent une clientèle fidèle. Les règles auxquelles il doit se tenir dans l'exercice de sa profession, actes lus à haute voix ou donnés à lire aux comparants, présence de témoins, confèrent à la visite chez le notaire un aspect solennel qui peut paraître anachronique. En réalité, elles ont leur raison d'être.
Notaires et fiscalité
Le notaire genevois — il n'est pas seul dans son cas — a depuis fort longtemps une autre fonction, indirecte, celle de "collecteur d'impôts", ou du moins celle d'intermédiaire entre les particuliers et l'Etat. Il prélève d'abord le droit de timbre: la plupart de ses actes sont établis sur papier timbré, introduit pour la première fois à Genève en 1716. Un certain nombre d'actes sont soumis à l'enregistrement et c'est le notaire qui les présente au receveur. C'est sur la base des inventaires après décès dressés par ses soins que l'Etat prélève des droits de succession. Les transactions immobilières enfin, qui doivent être conclues par acte authentique, devant notaire, donnent lieu au paiement de droits de mutation, autrefois appelés lods.
B. R.-L.
haut
[p. 188: image / p. 189]
Ecrivains politiques
Genève a compté dans le passé quelques hommes de génie ou de talent qui ont influé sur les institutions de leur patrie ou même dont la renommée a retenti au loin. Certains, tels Calvin et Rousseau, sont des novateurs, mondialement célèbres. D'autres sont de brillants jurisconsultes, économistes, financiers, qui ont révélé, parfois en les perfectionnant, les théories de grands inventeurs — Grotius, Adam Smith, Bentham... Ce sont des gloires locales, qui ont bénéficié du rayonnement religieux et culturel de Genève, favorisé par le développement de l'imprimerie. D'autres enfin, tels Pierre Fatio, Jean-Robert Chouet, James Fazy, sont des politiciens qui ont exercé une influence par leur action, parfois par leur martyre.
La Réforme
La Réforme est dominée à Genève par la personnalité de Jean Calvin (1509-1564). Il n'est ni dictateur ni empereur, s'intitule lui-même professeur des saintes Ecritures, dirige l'Académie qu'il a fondée et domine la Compagnie des pasteurs comme primus inter pares. Son oeuvre institutionnelle est décrite plus haut, pages 138 à 140.
Calvin a été aidé avant tout par deux jurisconsultes de grande valeur: Germain Colladon et Théodore de Bèze, tous deux originaires de France et réfugiés à Genève pour motifs religieux.
Germain Colladon (1508-1594) est arrivé à Genève en 1550, abandonnant une carrière brillante de juriste et professeur de droit à Bourges. Il a très tôt gagné l'amitié de Calvin qui l'a chargé d'achever son oeuvre législative. Il l'a fait au sein d'une commission nommée par le Petit Conseil, dans laquelle il a joué un rôle de premier plan. C'est à elle que l'on doit les Edits politiques et les Edits civils, dont la version définitive sera promulguée quatre ans après la mort de Calvin.
Théodore de Bèze (1519-1605) fait lui aussi partie de cette commission législative, mais surtout il succède à Calvin comme le maître spirituel de la cité, pendant les quarante ans qui suivent la mort du grand réformateur. C'est durant cette période que s'est instauré l'Etat chrétien de la Réforme, fondé sur les Edits de 1568.
"Il n'y a autre volonté que celle d'un seul Dieu qui soit perpétuelle et immuable, règle de toute justice". Ainsi commence l'ouvrage capital de Bèze, Du droit des magistrats sur leurs sujets, publié en 1574, qui se fonde sur le "droit divin et naturel" ou "droit de Dieu et de nature": la nature étant l'oeuvre de Dieu, ces expressions ne font que souligner que l'origine de tout pouvoir et de toute justice est divine.
Mais l'ouvrage est écrit deux ans après la Saint-Barthélemy et vise à justifier la résistance armée des huguenots contre les persécutions du pouvoir royal: "Les peuples ne sont pas créés pour les magistrats, mais, au contraire, les magistrats pour les peuples... Les Etats sont par-dessus les rois". Cette position est nouvelle et s'oppose à celle de l'obéissance absolue prêchée par l'Eglise au Moyen Age. Elle explique la réputation souvent faite au protestantisme d'avoir fait oeuvre révolutionnaire.
[p. 190]
Les adeptes du droit naturel
Le passage du droit divin du Moyen Age et de la Réforme au droit naturel fondé sur l'instinct et la raison est un phénomène limité aux pays protestants: c'est avant tout l'oeuvre du Hollandais Hugo Grotius (1582-1645) et de l'Allemand Samuel de Pufendorf (1632-1694). Les pays catholiques, eux, s'en tiennent à l'enseignement du droit canon et du droit romain.
A Genève, au début du XVIIIe siècle, le droit naturel est introduit comme discipline nouvelle à l'Académie; la chaire en est confiée à Jean-Jaques Burlamaqui (1694-1748) dont l'oeuvre consiste essentiellement en deux ouvrages: Les principes du droit naturel (1747) et Les principes du droit politique, ce dernier ayant été publié en 1751, après la mort de son auteur, par les soins de Jacob Vernet.
Burlamaqui définit le droit naturel comme "les règles que la raison prescrit aux hommes pour les conduire... à un véritable et solide bonheur." C'est ainsi qu'on a pu rattacher sa philosophie à celle d'Epicure. En matière de droit politique, Burlamaqui reste avant tout philosophe. S'interrogeant sur les fondements de la souveraineté, il s'oppose à l'idée de "puissance irrésistible" de Hobbes et d'"excellence de nature" de Pufendorf et déclare: "Le droit de souveraineté dérive d'une puissance supérieure, accompagnée de sagesse et de bonté". » Mais lorsqu'il se demande à qui appartient ce droit de souveraineté, il prend une position plus tranchée qui n'a pas manqué d'exercer une influence, surtout aux Etats-Unis où ses livres ont été largement diffusés. Il écrit en effet: «Il n'y a jamais... qu'un seul souverain qui ait en lui-même la plénitude de la souveraineté; il n'y a qu'une volonté suprême. Ce souverain, c'est le corps même de tous les citoyens... »
Cette formule définit en termes clairs la conception républicaine de la souveraineté, telle qu'elle est professée par l'école du droit naturel, par opposition à la doctrine théocratique de la Réforme.
Un autre Genevois mérite d'être cité: Jaques-Barthélemy Micheli du Crest (1690-1766), pour ses Maximes d'un Républicain. Ce n'est pas un jurisconsulte comme Burlamaqui; sa vie est plutôt celle d'un contestataire, d'un dissident, dirait-on aujourd'hui. Capitaine au service de France de 1713 à 1738, il s'est opposé au plan des fortifications adopté par le Conseil des Deux Cents. Ses maximes ont été écrites en exil, alors qu'il était poursuivi par la justice genevoise pour crime de haute trahison. Il sera bientôt arrêté et mourra vingt ans plus tard, quelques jours après avoir été libéré des prisons bernoises. Toute la vie de Micheli du Crest et ses nombreux écrits portent témoignage pour la liberté et les droits du peuple contre la tyrannie. Ses maximes sont d'une netteté remarquable:
"Tout le pouvoir procède du peuple, donc il a dû conserver tout celui qu'il n'a pas remis à perpétuité par aucune loi."
"La principale passion qu'aient ceux qui occupent les principales dignités dans la République n'est pas le désir du gain... mais une impatience de s'agrandir et de se fonder s'il se peut une Souveraine Puissance sur celle du peuple..."
[p. 191]
Les magistrats, qui tendent à devenir des tyrans, doivent donc être soumis au contrôle des citoyens, lesquels doivent être "éclairés et instruits autant qu'il se peut de tout ce qui concerne leurs lois, leurs libertés, et les qualités personnelles de leurs magistrats". Quelle a été l'influence de Micheli du Crest sur la pensée politique de l'époque et sur les événements? Minime sans doute, malgré l'enthousiasme qu'il a soulevé dans le peuple genevois. Rousseau le cite parmi les auteurs qu'il a consultés, mais sans lui attribuer, semble-t-il, une réelle importance. Comme Pierre Fatio, il a payé chèrement son idéal d'indépendance et de liberté, et c'est son long martyre qui lui vaut de figurer parmi les autres gloires citées dans ce chapitre.
Jean-Jacques Rousseau
Il en va tout autrement de Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) qui, par ses écrits, a exercé dès la fin du XVIIIe siècle et jusqu'à nos jours une influence considérable en Europe sur les esprits et sur les événements. Tout comme Calvin, Rousseau est un génie qui a marqué son temps d'une empreinte décisive, mais pas plus que Calvin, il ne peut être considéré, sur le plan politique, en faisant abstraction des auteurs qui l'ont précédé, qui ont nourri son "magasin d'idées" et qui ont suscité ses réflexions, souvent ses réfutations.
On sait qu'il a étudié les oeuvres de l'Ecole du droit de la nature et des gens, Grotius, Pufendorf, Hobbes, Locke, Burlamaqui, auxquels il reconnaît la qualité de maîtres; mais il n'a suivi servilement les opinions d'aucun d'entre eux, les a souvent soumis à une sévère critique et doit être considéré dès lors comme un écrivain original.
Rousseau s'est intéressé relativement tard à la politique. C'est seulement à 42 ans qu'il s'y lance avec son Discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité et l'article Economie politique publié dans le tome V de l'Encyclopédie de Diderot et d'Alembert. A 50 ans, il publie Du Contrat social ou Principes du droit politique, suivi deux ans plus tard des Lettres écrites de la montagne. Enfin, il rédige un Projet de constitution pour la Corse et, à 60 ans, des Considérations sur le gouvernement de la Pologne.
De tous ces ouvrages à caractère politique, c'est incontestablement le Contrat social et son complément, les Lettres écrites de la montagne, qui ont fait la célébrité de leur auteur et qui ont exercé une influence sur ses contemporains et sur les penseurs politiques du XIXe siècle. Le gouvernement genevois ne s'y est pas trompé: le 19 juin 1762, il a fait lacérer et brûler le Contrat social, en même temps que l'Emile, déclarés "téméraires , scandaleux, impies, tendans à détruire la Religion chrétienne et tous les Gouvememens".
Rousseau définit lui-même le Contrat social en ces termes: "Trouver une forme d'association qui défende et protège de toute la force commune la personne et les biens de chaque associé, et par laquelle chacun, s'unissant à tous, n'obéisse pourtant qu'à lui-même, et reste aussi libre qu'auparavant. Tel est le problème fondamental dont le Contrat social donne la solution." [p. 192]
Cette solution, on la trouve résumée en quelques paragraphes dans la sixième des Lettres écrites de la montagne. L'Etat est un par l'union de ses membres. Ceux-ci se constituent en Souverain par le Contrat social et exercent le pouvoir législatif par l'expression de la volonté générale. Le gouvernement exécute les lois et assure le maintien de la liberté tant civile que politique. Rousseau distingue trois formes de gouvernement: la démocratie, ou exercice direct de tous les pouvoirs par le peuple ("un gouvernement si parfait ne convient pas à des hommes"); l'aristocratie qui, à condition d'être élective, constitue la meilleure forme de gouvernement; et la monarchie, dont le républicain Rousseau dépeint tous les inconvénients. La souveraineté est inaliénable et indivisible. Rousseau conteste formellement aux députés la qualité de représentants car "la Souveraineté ne peut être représentée, par la même raison qu'elle ne peut être aliénée... Toute loi que le peuple en personne n'a pas ratifiée est nulle". En revanche, le gouvernement est élu par le Souverain pour exécuter les lois édictées par lui.
L'influence de Rousseau fut considérable. On sait que Mirabeau, grâce à ses conseillers genevois — Dumont, Reybaz, Du Roveray, Clavière — puisa dans le Contrat social le thème de ses discours et même la Déclaration des droits de l'homme; que Robespierre et Saint-Just s'inspirèrent de Rousseau dans "leur revendication fanatique d'un règne de justice, d'égalité et de fraternité" (H. Lüthy).
A côté de ce géant de la pensée qu'est Rousseau, les autres publicistes genevois du XVIIIe siècle font pâle figure. Il faut faire toutefois une exception pour Jean-Louis de Lolme (1741-1806) qui a inauguré sa carrière par des pamphlets à la gloire du Contrat social et l'a terminée à Londres par un commentaire de la Constitution britannique (Constitution de l'Angleterre ou Etat du Gouvernement anglais comparé avec la forme républicaine et avec les autres monarchies d'Europe, 1771) qui a exercé une influence certaine en France et en Allemagne, et a contribué à répandre en Europe, et singulièrement à Genève, une certaine "anglomanie" politique.
L'avènement de la démocratie au XIXe siècle
Genève a vécu, au début du XIXe siècle, une période brillante sur le plan scientifique. Elle s'est illustrée de bien des manières, en particulier dans le domaine de la pensée économique et politique, grâce aux travaux de Sismondi, Etienne Dumont, Pellegrino Rossi, Pierre-François Bellot et de quelques autres gloires locales ou nationales.
Jean-Charles-Léonard Simonde de Sismondi (1773-1842) est un produit typique de cette intelligentsia genevoise, ouverte à tous les courants de pensée et à toutes les sciences, cosmopolite et patriote. Après un exil forcé à Londres et en Italie, Sismondi revient à 28 ans dans sa ville natale, devenue entre-temps chef-lieu du Département du Léman. Il est impressionné par la misère de l'économie genevoise, entravée par les règlements et les taxes de l'administration française, et en déduit que seule la liberté peut redonner au [p. 193] commerce et à l'industrie la vigueur et la prospérité qui leur font défaut. Le livre d'Adam Smith, Recherches sur la nature et les causes de la richesse des nations, paru en 1776, est à la mode. Sismondi, voulant "approprier à la France et à sa législation les conseils qu'Adam Smith destinait surtout à l'Angleterre", publie en 1803 De la richesse commerciale ou Principes d'économie politique appliqués à la législation du commerce, où il prône la liberté économique la plus totale. Mais il n'en reste pas là. Il observe, il s'informe, il voyage et voit la misère du peuple, le destin tragique des ouvriers dans les usines, les ravages d'un libéralisme économique incontrôlé. En 1818, il rédige pour l'Edinburgh Encyclopedia l'article Political Economy, dans lequel il revient déjà sur les thèses qu'il a défendues quinze ans auparavant. Et l'année suivante, il publie l'ouvrage qui assurera sa célébrité: Nouveaux principes d'économie politique ou De la richesse dans ses rapports avec la population.
Pour William Rappard, "la conversion de Sismondi, du libéralisme le plus intransigeant à l'interventionnisme le moins respectueux des lois du marché, est sans doute l'événement le plus frappant... dont l'histoire des doctrines économiques ait conservé le souvenir". En fait Sismondi, historien et politologue, reste un libéral convaincu et ses principes économiques sont davantage ceux d'un philanthrope et d'un observateur sensible que d'un théoricien de l'économie. Pour lui, le but de l'économie est d'assurer le bonheur des hommes et non pas de produire un maximum de richesses, ce qui le conduit à préconiser, d'une part une politique démographique malthusienne, d'autre part une législation sociale qui protège l'ouvrier (durée du travail, repos dominical, âge d'entrée dans les fabriques, organisation de la profession, etc.).
Son mérite a été, dans une époque entièrement dominée par les théories libérales d'Adam Smith, de Jean-Baptiste Say, de Ricardo, de placer l'homme au centre de l'économie et de proclamer la primauté du social sur l'économique (A. Babel).
Les Nouveaux principes n'ont guère exercé d'influence sur les théories et les hommes de son temps. Les raisons en sont multiples. D'une part, Sismondi a été un précurseur, la société de l'époque n'était pas mûre pour recevoir son message. D'autre part, il a décrit avec force les maux dont souffrait l'économie occidentale au début du XIXe siècle, et en particulier la misère de la masse agricole et ouvrière, mais il n'a pas élaboré une théorie économique cohérente susceptible de mettre fin aux scandales qu'il dénonçait. Enfin, sa modération, ses tendances réformistes n'eurent pas le même impact que les théories révolutionnaires de Karl Marx et de Frédéric Engels, quelque vingt-cinq ans plus tard. Aujourd'hui, cependant, on reconnaît que Sismondi fut le premier à formuler les principes de l'économie sociale (Ch. Rist).
Pellegrino Rossi (1787-1848) fait partie du même groupe de juristes-économistes qui ont lutté pour donner à Genève, après la Restauration, une constitution libérale. Destinée unique que celle de cet Italien de naissance, réfugié à Genève à l'âge de vingt-huit ans, devenu Genevois et même député de Genève à la Diète [p. 194] fédérale, puis professeur au Collège de France, ambassadeur de France auprès du Saint-Siège, ministre de Pie IX, enfin assassiné à Rome à l'instigation du Parti populaire.
Rossi a laissé en Suisse le souvenir d'un législateur de grande valeur: son projet de constitution, le Pacte Rossi, soumis à la Diète fédérale en 1832, prévoyait l'égalité du droit de vote des cantons, le libre établissement et le libre exercice des professions sur tout le territoire de la Confédération, l'abolition des douanes et péages cantonaux, la centralisation des postes, l'introduction d'une unité monétaire, l'unification des poids et mesures par l'adoption du système métrique...
Ce projet, sans doute trop ambitieux pour l'époque, fut d'abord défiguré par une série d'amendements qui limitaient gravement sa portée, puis rejeté en 1833 par une majorité de cantons, en tête desquels figurait Lucerne. Le passage d'une fédération d'Etats à un Etat fédératif est une opération délicate qui nécessite une longue maturation. Il a fallu attendre les constitutions de 1848 et de 1874 pour que les principes de Rossi trouvent leur consécration. Là ne s'est pas bornée l'activité scientifique de Rossi. Il est l'auteur d'un Traité de droit pénal (1829) et de plusieurs autres publications à caractère philosophique, politique, juridique ou économique.
Ces deux personnalités, auxquelles il convient d'associer celles d'Etienne Dumont (1759-1829), de Pierre-François Bellot (1776-1836), de Jean-Jacques Rigaud (1785-1854) et de Jean-Marc-Jules Pictet-Diodati (1768-1828) sont des esprits éclairés qui se sont efforcés, par leurs écrits et par leur activité politique, d'infléchir dans un sens libéral les institutions réactionnaires que Genève s'était données en 1814. Grâce à leur action persévérante, Genève a pu éviter les troubles qui ont soulevé presque tous les cantons romands après les journées de juillet 1830 à Paris (Rappard). Leurs efforts n'ont toutefois pas permis d'éviter les émeutes de 1841 et de 1846 et c'est le chef du Parti radical, James Fazy (1794-1878), qui fournira le dernier volet de cette évocation de quelques grands juristes, économistes et politiciens genevois du XIXe siècle.
James Fazy
Les vues politiques de Fazy ne diffèrent pas essentiellement de celles des publicistes libéraux dont il est question plus haut; ce sont toujours la souveraineté populaire et les droits individuels que tous les bons esprits cherchent à consolider, mais les ambitions de Fazy sont d'une autre nature. Il s'appuie sur le peuple pour établir une démocratie moderne, mais aussi pour asseoir son pouvoir personnel. Agitateur jusqu'en 1846, homme d'Etat ensuite, Fazy est une personnalité hors du commun. Il a milité près de vingt ans à Paris, au début de sa carrière, dans les milieux libéraux, fondant coup sur coup trois journaux d'opposition. A Genève, il crée le Journal de Genève en 1826, puis l'Europe centrale en 1833, le Représentant en 1841, la Revue de Genève en 1842. En tant que [p. 195] fondateur et chef du Parti radical, après le soulèvement de 1841 et la révolution de 1846 qu'il a lui-même fomentés, il parvient à imposer ses vues. Chef du gouvernement de 1846 à 1853 et de 1855 à 1861, Fazy est l'un des hommes qui a le plus contribué à donner à Genève sa physionomie actuelle: la Constitution du 21 avril 1847 est son oeuvre; malgré un certain nombre de modifications, elle est toujours en vigueur. En 1841, il fait adopter par le Grand Conseil une loi qui garantit la liberté individuelle et l'inviolabilité du domicile. En 1849, il obtient du même Conseil la démolition des fortifications, opération qui eut des répercussions considérables sur le développement de la ville et sur son ouverture au monde extérieur. Sur le plan social, Fazy crée l'Hôpital cantonal et l'Asile des vieillards. En matière économique, il réalise la liaison ferroviaire de Genève avec Lyon et suscite la création de plusieurs établissements de crédit (voir le volume III de cette Encyclopédie, pages 88-89). Partisan de la neutralité confessionnelle, il concède un terrain pour la construction de l'église Notre-Dame à Cornavin. Pour créer une alternative aux vieilles sociétés savantes qu'il juge trop conservatrices, il fonde l'Institut national genevois.
L'oeuvre de James Fazy fut considérable. Elle fut celle d'une grande intelligence et d'un patriote. Elle fut aussi celle d'un révolutionnaire à l'esprit dictatorial qui mena une lutte acharnée, aussi bien dans les milieux scientifiques, religieux que politiques, contre tout ce qu'il abhorrait, le patriciat genevois et ses oeuvres. Les électeurs le suivirent car, d'une part sa politique était conforme aux aspirations de la classe ouvrière, d'autre part il avait su, par un habile découpage des collèges électoraux, s'assurer une confortable majorité.
Le rayonnement de Genève au XXe siècle
Le XXe siècle n'est pas aussi riche à Genève en jurisconsultes et économistes de premier plan que le XIXe. On se bornera à évoquer ici la figure de William Rappard (1883-1958), dont la notoriété a franchi les limites du canton et qui s'est distingué à la fois comme historien, économiste, publiciste et diplomate.
Fondateur, en 1927, avec Paul Mantoux, de l'Institut universitaire de hautes études internationales, il a su attirer à Genève une brochette impressionnante de professeurs de réputation mondiale qui ont assuré le renom de l'Institut et formé des générations d'élèves de valeur. Rappard avait coutume de dire plaisamment que l'Institut devait son existence et sa qualité à Rockefeller, Hitler et Mussolini. L'un a fourni l'essentiel des fonds nécessaires au lancement de l'entreprise, les deux autres ont chassé de leur pays des savants de réputation mondiale qui ont fait la gloire de l'Institut (Wilhelm Rôpke, Hans Kelsen, Hans Wehberg, Paul Guggenheim, Guglielmo Ferrero et tant d'autres).
Rappard s'est fait aussi connaître par un nombre important de livres et d'articles d'histoire et de science économique qui se distinguent par leur concision et leur style élégant et limpide. Enfin, Rappard a joué un rôle diplomatique remarquable: membre de la [p. 196] délégation suisse auprès des Alliés pendant et après la Première Guerre mondiale, il a pu, grâce à sa parfaite connaissance des Etats-Unis d'Amérique et aux liens qu'il a pu nouer avec le président Wilson, assurer le ravitaillement de la Suisse et défendre son statut international. C'est en grande partie grâce à lui que Genève a été choisie comme siège de la Société des Nations et c'est lui qui a négocié, avec Gustave Ador et Max Huber, l'entrée de la Suisse dans cette institution; il avait d'ailleurs participé à la rédaction même du Pacte. Il a joué un rôle important à la Commission permanente des mandats de la Société des Nations et à l'Organisation internationale du Travail. Après la Deuxième Guerre mondiale, il a dirigé la mission suisse qui a négocié avec les Alliés en 1945, à Londres et à Washington, pour obtenir le désencerclement de la Suisse et la reconnaissance de sa neutralité.
Genève a donné naissance ou asile, au cours des siècles, à des personnalités dont l'importance et l'influence sur les institutions fut sans proportion avec la petitesse de la cité. Cela explique en partie le rôle que joue la ville aujourd'hui sur le plan international.
J. de S.
haut
[p. 197]