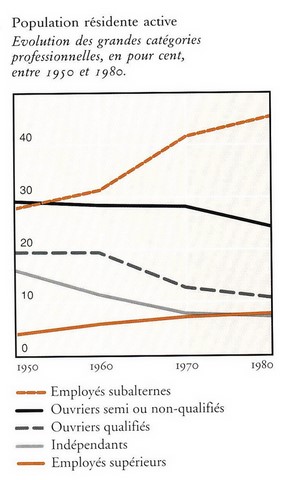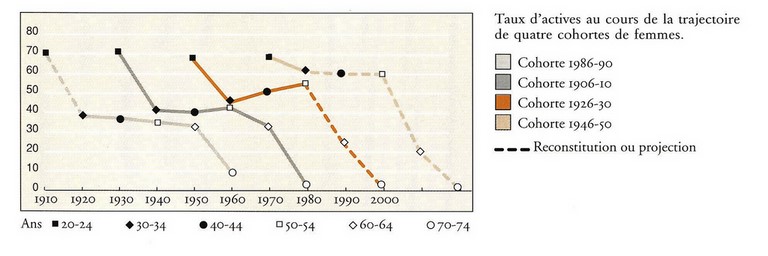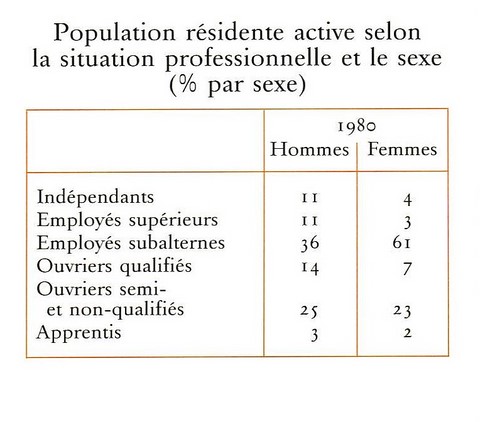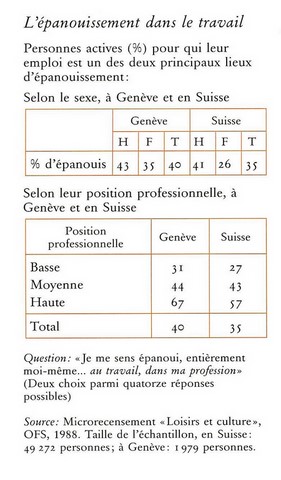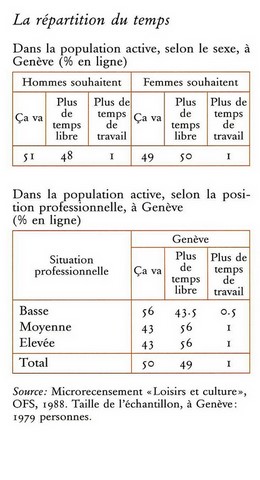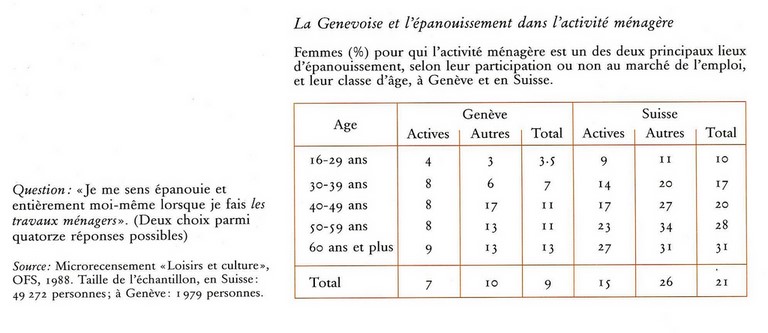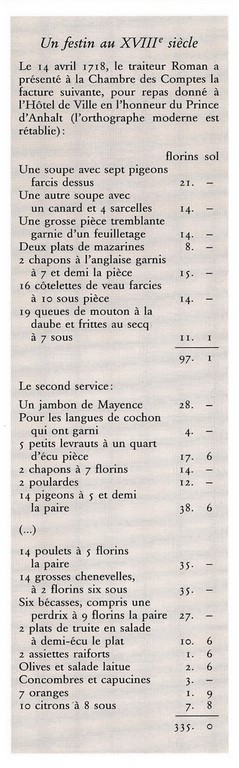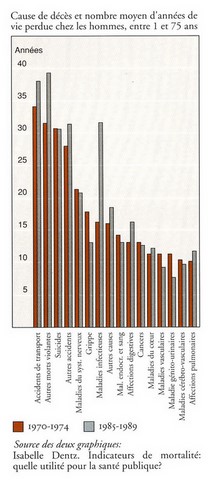La vie quotidienne
Jean-Pierre Arn / Françoise Blaser / Christian Lalive d'Epinay
Maryvonne Maitre / Anne-Marie Piuz
Catherine Santschi / Jean de Senarclens
Avec la collaboration, pour le chapitre sur le sport, de Gérald Piaget et Jean Brechbuhl, de même que des associations sportives qui ont bien voulu remplir notre questionnaire et nous adresser de nombreuses et fort utiles informations.
Comment vit-on dans les différents quartiers de Genève?
[p. 137]
Que faut-il entendre par "quartier"?
Un quartier c'est, dans la topographie genevoise, une portion de territoire délimité par le lac, le Rhône, l'Arve, les voies de chemin de fer, les routes principales.
C'est ensuite une entité qui plonge ses racines dans l'histoire: bien que postérieure au peuplement du littoral, la Ville Haute remonte aux origines de la cité; elle s'est étendue peu à peu, descendant la colline, et constitue aujourd'hui une unité avec les quartiers qui bordent le Rhône sur la rive gauche. Sur l'autre rive du fleuve, le quartier Saint-Gervais s'est développé dès le IVe siècle, pour absorber un surplus de population et pour abriter un artisanat tirant son énergie du courant du fleuve, centre de l'industrie horlogère jusqu'à la Première Guerre mondiale. Celui des Eaux-Vives, extension du faubourg du Temple, rasé comme tous les faubourgs dans les années 1530-1540, a été urbanisé après la démolition des fortifications, à partir de 1850; jusqu'au XIXe siècle, il alimentait les fontaines de la ville en eau de source. De même, les Pâquis sont de développement récent: couverts de marécages et partiellement immergés à l'époque romaine, ils servirent ensuite de pâturages et se construisirent à partir de 1850. Plainpalais faisait partie, au Moyen Age, des Franchises de Genève; les Dominicains y avaient installé un couvent et endigué l'Arve, dégageant des terrains alluvionnaires où les "plantaporrêts" cultivaient des légumes sous l'Ancien Régime; l'urbanisation commença à la fin du XVIIIe siècle. Ces trois derniers quartiers — les Eaux-Vives, les Pâquis et Plainpalais — ont une histoire bien à eux puisque, dès 1798 et jusqu'en 1930, ils formaient des communes autonomes (Les Pâquis faisaient partie de la commune du Petit-Saconnex), administrées par un maire, un conseil municipal et des bureaux indépendants, d'où le caractère bien marqué de leurs habitants. Quant aux quartiers plus éloignés du centre, ils ont souvent pour origine des villae romaines.
Mais un quartier, c'est surtout une communauté dont les membres se rencontrent, créent des liens entre eux, d'abord à l'école et dans les sociétés de jeunesse, les éclaireurs et éclaireuses, les paroisses; ensuite, ce sont les commerces, les maisons de quartier, les cafés qui créent l'atmosphère propre au quartier. Et puis certains des habitants se retrouvent dans les sociétés sportives, les chorales, les sociétés de musique locales. Tous ces contacts créent un esprit de communauté, une atmosphère particulière à chaque quartier, qui trouvent souvent leur expression dans des feuilles locales, des journaux de quartiers ou des publications ponctuelles.
J. de S.
haut
[p. 138]
Y a-t-il encore des quartiers?
Il fut un temps où chaque quartier avait sa physionomie propre, son style, son odeur caractéristique. Aujourd'hui, le monde est devenu standard, les immeubles se ressemblent tous, on ne trouve plus de ces maisons hétéroclites, aux escaliers extérieurs en bois qui faisaient le charme de certains quartiers. Les petits commerces disparaissent les uns après les autres, les modestes bistrots ont été transformés en restaurants destinés à la classe moyenne "bon chic, bon genre": les secrétaires, les instituteurs, les programmeurs, les grands directeurs...
Les Genevois fréquentent de plus en plus assidûment les restaurants des grands magasins et des centres commerciaux. A Saint-Gervais, il y a la Placette. Aux Pâquis, la Migros de la Navigation. A Plainpalais, la Coopérative des Augustins et surtout l'Uniprix. Aux Eaux-Vives, la Migros, dans la rue du même nom, et Coop 2000. A Thônex, on a toujours la Migros, et à Chêne-Bourg, toujours la Coopérative. Enfin, les nouvelles surfaces commerciales bâties à la périphérie, à Meyrin, Balexert, et même jusque dans le canton de Vaud, à Chavannes-de-Bogis, sont également équipés de divers snacks qui connaissent le plus grand succès. A Plainpalais, l'Uniprix de la rue de Carouge (devenu EPA) est un point de rencontre pour les gens peu fortunés, notamment les personnes du troisième âge, qui papotent parfois par groupes importants, où dominent les femmes, des après-midis entiers. On y entend toujours des rires joyeux fuser et la meringue à la crème y est très prisée. L'Uniprix est un lieu des plus conviviaux, où le personnel est toujours serviable et sympathique. D'après mon expérience, c'est le seul grand magasin où le personnel entretient des rapports autres que conventionnels avec la clientèle. Peut-être parce que c'est un grand magasin de quartier (voyez plus loin, page 157).
L'adresse du vitrier
Une majorité de la population active ne vit pas dans le quartier où elle travaille. Nous sommes presque tous devenus des pendulaires. Telle employée qui habite Lausanne travaille dans le quartier de Saint-Gervais où elle a son dentiste, son boulanger, son pharmacien. Elle fait ses courses à la Placette. Elle reproduit, à Saint-Gervais, une sorte de microcosme, qu'on pourrait assimiler à une vie de quartier, avec ses collègues qui habitent Douvaine, Meyrin, Lancy. [p. 139]
A l'inverse, dans le quartier de Plainpalais, je demande à dix Plainpalaisiens s'ils connaissent l'adresse d'un vitrier. Aucun ne peut répondre. Tous travaillent à l'extérieur de Plainpalais. Or, il y a bel et bien un vitrier à l'avenue Henry-Dunant.
Etre d'un quartier, c'est connaître ce quartier, c'est savoir où se trouve le vitrier, même si l'on n'y a jamais eu recours... Les limites extérieures de la ville s'éloignent, la ville s'étend, ce qui a pour conséquences que les notions de quartier s'estompent, que les limites intérieures se restreignent. Les limites du quartier deviennent floues. Le plus souvent, on ne perçoit d'un quartier qu'une rue, trois immeubles, voire trois foyers d'un seul immeuble. Ce qui donne le sentiment d'appartenir à un quartier, ce sont les rapports qu'on entretient avec les habitants, les commerçants, le fait d'être connu, reconnu.
[p. 140]
L'automobile efface le quartier
Mars 1992, cinq heures de l'après-midi, route de Malagnou. Je roule en auto à la hauteur du chemin Krieg, devenu "avenue" après que se furent érigés, à l'aube des années cinquante, sur le territoire de la vaste campagne De Geer, qui s'étendait presque jusqu'à Florissant, les "barres" d'habitations qui constituèrent le premier quartier des "Internationaux", au lendemain de la guerre de 1939-1945.
Je navigue dans le flot ininterrompu d'autos qui s'écoule lentement. Mais voici que la longue chaîne s'immobilise. Temps d'arrêt propice à l'évasion de la pensée jusqu'à l'absurde...
Devant moi, une multitude de "tas de tôle", dénués pour un temps de toute utilité, dans leur immobilité forcée, chacun de ces tas n'en continuant pas moins de cracher son gaz nocif et de produire un bruit sourd qu'on entendra dans tout le voisinage.
Le prix de la liberté? Quelle liberté? Les parents s'obligent à accompagner les enfants, parfois jusqu'à l'âge de huit ou neuf ans, à l'école de quartier, de peur qu'ils ne se fassent renverser par une auto, malgré les "patrouilleuses scolaires" (mères d'écoliers), qu'on ne voit d'ailleurs qu'aux abords immédiats des écoles. On ne peut plus envoyer des enfants en bas âge acheter les croissants du matin à la boulangerie du coin. Toujours la peur des autos...
Flash back, autour des années 1947-1948, à la route de Malagnou. A l'endroit même où, tout à l'heure, j'étais bloqué dans ma voiture. Des gamins de sept à dix ans, en culottes courtes (nous n'avions pas encore découvert le blue [p. 141] jean) ont posé leur pull over en plein milieu de la route de Malagnou pour marquer l'emplacement des buts, et jouent au football...
Soudain, l'un d'eux crie: "Y a une bagnole qui arrive". La partie s'interrompt mollement (la voiture est encore loin) pendant quelques minutes. Pour reprendre jusqu'au passage de la voiture suivante. Dix, douze minutes plus tard... c'était la route de Malagnou en 1947.
Après la partie de foot, les gamins partent au pas de course "faire une expédition" au bord du ruisseau qui coule le long du chemin Krieg, tout en bas de la campagne De Geer, au milieu d'une forêt dense où s'épanouissent des lianes, pour jouer à Tarzan. On fume du bois fumant. On décide d'aller, en bande, "casser la figure aux voyous des Pâquis", nous les gamins des Eaux-Vives (un rêve que nous n'avons jamais concrétisé; nous avions bien trop la "trouille" de ces Pâquisards qui avaient la réputation d'être "drôlement" costauds). Ou bien on court faire une nouvelle "expédition" sur les falaises de l'Arve ou au Musée d'art et d'histoire "regarder la momie" (égyptienne). Ou encore à l'Uniprix pour faire vingt remontées d'escalier roulant, avant de nous voir barrer le passage par des employés... Les maîtres-mots sont alors "expédition" ou "exploration".
Démolitions, transformations, reconstructions...
Toujours vers les années 1947-1948... Nous avons un copain dont la grand-mère habite le quartier de Saint-Gervais. C'est sombre, c'est vieux, il y a même des poules dans une cour. Mais chez la grand-mère, c'est impeccable, et elle nous prépare des "greubons" sur le potager de la cuisine... On explore les immeubles, on rencontre d'autres gamins qui chahutent dans les montées, les logis sont ouverts, on s'amuse bien. Et on va voir travailler les artisans du coin.
Mais le quartier est déclaré "insalubre, pas hygiénique, mauvais pour la santé". On rase beaucoup. Et c'est ainsi que naissent l'immeuble du Plaza, à la rue du Cendrier, et le grand magasin "La Placette". Les habitants sont déplacés dans les cités satellites. Nombre de vieux bistrots disparaissent, où il y avait de la vie, de l'accordéon. Ils sont peu à peu remplacés par des "snacks" où l'on confectionne des "plats du jour" pour une clientèle d'employés de bureau. C'est la fin de Saint-Gervais comme quartier bien typé, bien délimité, "autonome".
J.-P. A.
haut
[p. 142]
D'un quartier à l'autre
La Vieille Ville, matrice de Genève
L'enceinte dite "réduite" — mais y eut-il auparavant l'enceinte d'une grande Genève? — enferme, dès le début du IVe siècle, la plus grande partie de ce que l'on appelle aujourd'hui la Vieille Ville. Encore visible dans les cours et les fondations de quelques maisons, elle enserrait les édifices de la ville haute, de l'extrémité occidentale de la rue actuelle de l'Hôtel-de-Ville et du chevet de la cathédrale à la rue de la Tour-de-Boêl et au bout de la Grand'Rue, longeant le rebord de la colline. Les enceintes successives ont progressivement englobé le Bourg-de-Four, le flanc de la colline jusqu'à Rive, à l'église de la Madeleine et à la rue du Rhône, gagnée sur le Léman entre le XVe et le XIXe siècle.
Mais la Haute Ville, avec la cathédrale, les édifices gouvernementaux, les résidences des chanoines et des officiers de l'évêque, laissant à l'extérieur le château du comte de Genève au Bourg-de-Four (détruit au XIVe siècle), restait le lieu du pouvoir politique et de l'autorité religieuse. C'est sans doute le quartier de la ville qui a la plus forte identité, à cause de son épaisseur historique.
La trace des siècles dans l'architecture
Certes, à part les églises, la Tour Baudet, la fameuse Maison Tavel et quelques corps de bâtiments gothiques à la rue des Granges, à la place de la Taconnerie et à la Grand'Rue, il ne subsiste presque rien des maisons résidentielles des chanoines et du palais épiscopal occupant la Cour Saint-Pierre, qu'on appelait, au Moyen Age, le Grand Cloître, et les rues adjacentes.
Au XVIIe et surtout au XVIIIe siècle, le gouvernement de la République et de riches familles ont marqué la Haute Ville de leur empreinte. A la rue de l'Hôtel-de-Ville, les extensions successives de la Maison de Ville, l'Ancien Arsenal, construit comme grenier à blé de 1628 à 1634, annoncent le renforcement des institutions politiques, tandis que plusieurs riches marchands édifient des hôtels particuliers, notamment Francesco Turrettini, banquier de Lucques, dont la maison, aux numéros 8-1o, construite entre 1617 et 1621, est un modèle.
Mais c'est surtout la rue des Granges (autrefois les Crêts de la Chauvinière) qui est devenue le lieu symbolique de l'aristocratie genevoise. A partir d'un plan d'ensemble qui date de 1719, les numéros 2, 4 et 6 forment une longue façade magnifiquement exposée au sud, dominant la Place Neuve. A ces bâtiments se sont ajoutés tout au long du siècle [p. 143] une série d'hôtels particuliers ou d'ensembles locatifs de luxe, à la rue de la Cité, à la rue Calvin, à la promenade Saint-Antoine, à la rue Beauregard, qui forment une couronne de belles demeures manifestant la prospérité de la banque protestante genevoise. Pour "nos familles", comme disait majestueusement l'illustre Mme Cavillier, qui tenait la confiserie de la rue des Chaudronniers, une partie de l'existence se passait et se passe encore dans de somptueuses résidences secondaires à la campagne, où l'on s'installe dès les beaux jours venus. [p. 144: image / p. 145]
Quant aux maisons situées à l'intérieur de cette couronne et dans les rues qui descendent vers le lac, elles sont plutôt peuplées par des gens plus modestes, artisans et commerçants, retraités, intellectuels privilégiés, locataires de la "Gérance immobilière municipale" ou de l'Hospice général, peu à peu remplacés par des bureaux et des commerces de luxe.
La Vieille Ville, un pôle de vie politique
Dans la Vieille Ville, la vie s'organise autour de plusieurs pôles, dont les principaux sont les administrations cantonale et municipale et la paroisse de Saint-Pierre - Fusterie.
Certes, l'activité qui se déploie autour de l'administration et par elle a beaucoup diminué depuis les années soixante. Depuis 1933, l'état civil de la Ville de Genève est à l'ancienne mairie des Eaux-Vives. En janvier 1985, la mairie proprement dite a quitté l'Hôtel municipal du 4, rue de l'Hôtel-de-Ville, pour s'installer au Palais Eynard, rénové à grands frais. Quant à l'administration cantonale, elle se développe le long d'un axe qui conduit du Palais de Justice à la rue Henri-Fazy, mais l'augmentation phénoménale du nombre des fonctionnaires a obligé des bureaux importants à s'exiler aux Eaux-Vives et à la Jonction. Il en résulte que, privée du Contrôle de l'Habitant, de l'administration fiscale, du département militaire, des travaux publics, de la police, la Vieille Ville n'est plus le point de ralliement unique des citoyens. De plus en plus souvent, les personnes qui cherchent un des services rescapés (passeports, office des poursuites et faillites par exemple) ne connaissent plus les lieux, n'y sont jamais venues, ignorent jusqu'au repère historique et touristique des canons sous l'Ancien Arsenal. Que personne ou presque ne sache où sont les Archives est en revanche un phénomène commun à toutes les villes.
De la splendeur gouvernementale d'antan, il ne reste donc, à la Vieille Ville, que les séances du Conseil d'Etat, celles du Grand Conseil, toujours appelé, comme sous l'Ancien Régime, par le son d'une cloche, l'"Appel" (un coup toutes les minutes pendant une heure), les séances des commissions, celles enfin du Conseil municipal de la Ville de Genève. Tout cela s'accompagne de moult intrigues et conciliabules dans les nombreux estaminets des alentours. Estaminets pas assez nombreux aux yeux de certains, semble-t-il, puisqu'en 1980, le Conseil d'Etat a imaginé de rétablir le "café Papon" au rez-de-chaussée de l'Hôtel-de-Ville et même de transformer en "carnotzet" la Grande Grotte, qui avait abrité les archives foncières de Genève de 1450 à 1972. Il n'y a pas assez de [p. 146] bistrots, dit-on, mais le nouveau café Papon n'a obtenu sa (demi-)patente d'alcool qu'à la faveur de la nouvelle loi, du 17 décembre 1987, sur la restauration, le débit de boissons et l'hébergement. Ce n'est d'ailleurs pas chez Papon que tenait salon le conseiller d'Etat André Chavanne, grand animateur du quartier entre 1961 et 1985, mais à celui de l'Hôtel de Ville et plus tard à celui du Bourg-de-Four.
A cette extrémité de la Haute Ville, les tenants de l'administration et de la politique rencontrent le personnel de la justice, juges, greffiers, innombrables avocats, parties et plaignants, qui prolongent l'effervescence régnant au Palais dans les cafés qui, remontant la rue de la Fontaine, longent la face nord du Bourg-de-Four jusqu'à la célèbre Clémence, café autrefois minuscule, qui déborde aujourd'hui sur toute la place, à la faveur des mesures prises pour diminuer et canaliser la circulation dans ce secteur.
[p. 147]
Les guerres de religion dans la Vieille Ville
La Vieille Ville est aussi centre religieux, ô combien! Laissons ici de côté l'église Saint-Germain, paroisse principale des catholiques chrétiens, l'ancien vicariat général, à la rue des Granges, où depuis 1987 l'évêque auxiliaire du diocèse de Lausanne, Genève et Fribourg nargue désormais les vieux protestants — du moins ceux qui veulent bien se sentir nargués — les églises libres de l'Oratoire et de la Pélisserie, l'église luthérienne, le temple de la Madeleine, l'Auditoire de Calvin, pour parler de la cathédrale Saint-Pierre. Bien que réduite à un petit nombre, la communauté de la paroisse protestante de Saint-Pierre-Fusterie est chargée d'un rôle hautement symbolique pour l'ensemble de l'Eglise nationale protestante, voire, aux yeux de certains, pour les Eglises réformées dans le monde entier.
Cette petite paroisse a été guidée jusqu'au début des années cinquante par cinq pasteurs assistés de deux diaconesses. Ce taux d'encadrement élevé, que les finances amenuisées de l'Eglise nationale protestante ont obligé à réduire progressivement jusqu'à deux pasteurs, est justifié par la valeur de pôle religieux, oecuménique et politique de la cathédrale Saint-Pierre, qui attire des ouailles bien au-delà des limites paroissiales. Pour la même raison, on admettait tacitement que les principales tendances théologiques devaient être représentées dans le corps pastoral de Saint-Pierre - Fusterie: une tendance que l'on pourrait qualifier d'orthodoxe stricte, et le protestantisme libéral. Ce dernier fut incarné, de 1925 à 1955, par le pasteur Jean Schorer: avec un accent suisse alémanique prononcé, il fustigeait les défauts des bien-pensants et prenait avec l'histoire de la Réforme et l'héritage spirituel de la vieille Genève des libertés jugées excessives par les milieux académiques — sans parler de la théologie! Mais il prêchait inlassablement la charité et la générosité, ce qui lui valait une grande popularité.
La retraite de ce pasteur, en 1955, donna le coup d'envoi à une lutte terrible pour sa succession. Les pasteurs, les professeurs de la Faculté de théologie prirent plus ou moins ouvertement position. Une Association pour une Eglise nationale protestante ouverte, émanant de l'Union protestante libérale, se forma. La guerre se termina en 1961, au moins provisoirement, par l'élection très disputée du pasteur Henry Babel. Dans cette affaire, les paroissiens de ce quartier, en votant pour un pasteur ou l'autre, choisissaient moins une personnalité donnée qu'une certaine idée du pluralisme théologique ou de l'ouverture de l'Eglise.
[p. 148]
Le poids de l'héritage
Tels sont les enjeux de cette Vieille Ville, qui aujourd'hui vit fort repliée sur elle-même, mais porte le poids de l'héritage historique et symbolique genevois.
Si les habitants du Canton ne viennent plus dans la Vieille Ville pour leurs démarches administratives, ils y affluent en revanche lors des grandes occasions festives: chaque année, dès le mois de novembre, des coureurs en survêtement s'entraînent sur le parcours de la course de l'Escalade, qui attire plus de dix mille participants, auxquels s'ajoutent les familles et les autres supporters. La commémoration annuelle de l'Escalade, dont la base est le cortège de plus de cinq cents personnes à pied et à cheval, attire également beaucoup de [p. 149] monde, y compris les Savoyards. Surtout, en 1976, en 1982, en 1986, en 1989, la Vieille Ville a été complètement investie par quatre kermesses monstres, où toutes les paroisses du Canton et de nombreuses associations ont monté des stands pour accueillir et restaurer le public, et pour vendre divers produits à tous ceux qui étaient disposés à "dépenser de l'argent", soit pour récolter des fonds destinés à la restauration de la cathédrale Saint-Pierre, soit pour commémorer la Réforme et, à cette occasion, donner un coup de pouce à "ATD Quart-Monde".
D'autres solennités voient défiler à la cathédrale tout ce que Genève compte de notables: les funérailles des magistrats et des grandes personnalités qui ont illustré Genève, des cultes solennels pour les commémorations, des célébrations oecuméniques en relation avec la vie de la Genève internationale, et tous les quatre ans, l'assermentation du Conseil d'Etat, à laquelle le Parti du travail s'abstient régulièrement de participer, pour rappeler que l'Eglise est séparée de l'Etat. Ce qui montre bien la force symbolique de la cathédrale, puisque les cadavres de Calvin et des anciens évêques, dès longtemps refroidis, continuent de faire peur à ceux qui interprètent différemment l'héritage historique.
La lutte des habitants pour la qualité de la vie
Il ne s'agit là que d'occasions exceptionnelles, qui rappellent l'antique importance de la Vieille Ville à Genève. La réalité quotidienne est tout autre. La Vieille Ville se dépeuple. En 1960, indique l'Annuaire cantonal de statistique, le secteur centre-ville comptait 12.859 habitants. En 1990, il ne compte plus que 6.473 habitants, soit la moitié de la population perdue en trente ans.
Que s'est-il passé? On a vu, dans le chapitre de ce volume consacré à l'urbanisme, les lois économiques qui président au dépeuplement des centre-villes. Les appartements rénovés sont si chers qu'ils ne peuvent plus accueillir que des bureaux, cabinets d'avocats, de notaires, de médecins, de conseillers en communication. Les petits commerçants, épiciers, bouchers, boulangers, confiseurs, dont les bénéfices sont minimes, disparaissent et sont remplacés par des galeries d'art, des antiquaires, des marchands de meubles de luxe ou d'ordinateurs.
A la fin des années cinquante, la Vieille Ville était encore un village confortable, où les habitants trouvaient sans peine tout ce dont ils avaient besoin. On ne descendait guère dans les Rues Basses que pour s'acheter des habits. En 1960, par [p. 150] exemple, l'annuaire du commerce Chapalay & Mottier recensait dans ce quartier 5 boucheries, auxquelles s'ajoutaient une douzaine de bancs aux Halles de Rive, 19 épiceries, dont 3 succursales de la Coop, 17 boulangeries, pâtisseries et confiseries. En 1992, les épiceries n'existent plus: on compte 3 magasins d'"alimentation générale" (dont un vient d'être définitivement fermé) et la dernière succursale de la Coop, celle de la rue Etienne-Dumont, a fermé en juin 1991 malgré une lutte épique des habitants du quartier; il n'y a plus que deux boucheries et 7 boulangeries-pâtisseries, dont deux succursales de la maison Pouly. La pâtisserie Hautle a été sauvée in extremis par l'Association de la Vieille-Ville.
Les habitants ont changé: les gens vont faire des achats en masse, pour toute la semaine, aux supermarchés du Grand-Passage, de l'Uniprix, de la Coop ou de la Migros, ou encore en voiture à la périphérie et même en France. Les petits commerces, qui n'ont plus pour clientèle que quelques personnes âgées et non motorisées, périclitent. Plus de droguerie, de cordonnier, de vitrier, de plombier. Le dépôt de la teinturerie-blanchisserie de la rue Etienne-Dumont est fermé depuis janvier 1991.
Les associations d'habitants se sont battues, généralement en vain, pour garder ces petits commerces dans le quartier. C'est que le dépeuplement de la Vieille-Ville et, à l'autre extrémité, la politique de concentration pratiquée par les grandes entreprises de distribution conduisent inéluctablement à la suppression de ces petites boutiques et petites succursales de quartier, qui ne sont plus rentables.
C'est ainsi que disparaît la convivialité de ce quartier. A défaut de papoter devant la caisse de la Coop ou au dépôt de la teinturerie Baechler, où va-t-on se retrouver? A la porte de l'ascenseur? Aux terrasses des bistrots, qui subsistent encore par la grâce des touristes mêlés aux habitants et aux fonctionnaires en pause-café? Chez le coiffeur, dans le ronronnement sourd des séchoirs électriques? Aux vernissages organisés dans les galeries d'art ou au Musée Barbier-Mueller, qui débordent sur la rue par beau temps et où les messieurs de la bonne société peuvent s'offrir une coupe de champagne gratuite, voire deux? Ailleurs encore...
Le rôle des associations
Mais ce sont les associations d'habitants qui structurent ces réunions. L'Association de la Vieille-Ville, la plus ancienne, héritière, en 1941, d'un groupement de défense de la Vieille-Ville constitué en 1937, s'est efforcée de sauver certains commerces [p. 151] et la qualité de l'habitat. En particulier, elle a voulu supprimer ou diminuer le tapage nocturne provoqué par les fêtards sortant des boîtes de nuit, à peu de distance du poste de police du Bourg-de-Four! Ses efforts ont été réduits à néant lorsque les patrons des boîtes de nuit et des restaurants sont entrés en masse dans ladite association. Deux discours se heurtaient relativement à la qualité de vie: les uns se plaignaient du peu d'animation nocturne en ville de Genève et, pour des raisons économiques et touristiques, s'efforçaient de développer l'attractivité de la Vieille Ville; les autres, soucieux de leur sommeil et de leur tranquillité, auraient voulu interdire le quartier à tous les trublions extérieurs.
C'est évidemment la prédominance des usagers extérieurs et des milieux économiques et touristiques dans l'Association de la Vieille-Ville, qui a incité, en 1980, un groupe d'habitants à constituer une nouvelle association, celle des habitants du Centre et de la Vieille Ville, d'orientation politique différente, qui lutte avec énergie pour les intérêts des habitants proprement dits. Elle dénonce toutes les transformations d'appartements en bureaux, a "pris la température" de ses membres pour fixer son attitude face au projet de parking de Saint-Antoine: voyant que plusieurs dizaines d'habitants souhaitaient louer une place dans ce parking, elle a renoncé à faire opposition. Son action est relativement efficace: elle a obtenu des locaux pour une maison de quartier, organise des fêtes dans la Vieille Ville, des concerts sur la Treille, un bal de l'Escalade sous l'Ancien Arsenal, à côté des canons. Les deux associations se sont mobilisées pour sauver la dernière succursale de la Coop à la rue Etienne-Dumont, mais en vain.
D'autres groupes animent la vie quotidienne de la Vieille Ville. La petite école de Saint-Antoine rassemble parents et enfants une ou deux fois par jour. Tous les jeudis (bientôt tous les mercredis), il y a foule autour du carrousel de la place de la Madeleine et sur la promenade de la Treille. La principale révolution vécue par ce quartier est peut-être la création d'une ligne de minibus, le 1er septembre 1982, ligne très utile aux personnes âgées ou handicapées qui ne peuvent plus faire leurs courses à vingt mètres de leur domicile. Ce petit bus est aussi, grâce à des chauffeurs cordiaux, un lieu de réunion et de papotage. Deux de ces chauffeurs, d'origine africaine, étaient même si populaires, qu'une pétition des usagers a été lancée pour les garder, lorsque, pour des raisons pas encore éclaircies, l'entreprise de transports qui les employait les a licenciés. La pétition n'a pas eu de succès, mais a montré que la Vieille Ville n'était pas encore tout à fait morte.
C.S.
haut
[p. 152: image / p. 153]
Le seul quartier où il y a de la vie
Pendant la journée, il y a des flots de voitures dans toutes les rues où elles n'ont pas été interdites. Et il y a du monde partout où il y a des magasins. Mais dès la fermeture des magasins, c'est le désert. Les quartiers dortoirs de la rive droite, la Servette, la rue de Lyon, Vermont, le Grand Pré, dorment. Aux Grottes, il ne subsiste que de rares bistrots un peu bohème, dont la Cordelière, où l'on peut parfois rencontrer des musiciens et entendre de la musique qui jaillit spontanément. A Saint-Gervais, il y a la rue des Etuves, courte voie où deux ou trois bistrots et accordéonistes attirent quelques habitués. Saint-Jean est dans les bras de Morphée. Sur la rive gauche, Plainpalais et les Eaux-Vives ne sont pas beaucoup mieux lotis. A Plainpalais, seuls des Africains, qui résident dans des centres de réfugiés du quartier, déambulent par deux ou trois, sur les trottoirs de la rue de Carouge... Le seul quartier où il y a de la vie et de la lumière, le soir et la nuit dans les rues, c'est encore et toujours le quartier des Pâquis.
Les Pâquis la nuit...
Les Pâquis, quartier à vocation touristique, situé entre la gare et les hôtels du quai Wilson, a toujours été le lieu de plaisir et d'amusement. Certes, ils semblent loin maintenant les Pâquis-Pigalle "quelque peu folkloriques" des années 1930-1950 évoqués par le peintre Aimé Grandjean. Les "Pâquis des assommoirs", des "vieilles putes bien de chez nous", des personnages d'artistes, monstres sacrés de la bohème. Disparus, le fameux hôtel de passe "Le Verlaine", le cabaret "Chez Bersin", le peintre Ducommun et sa palette libertine, le "Caf'conç Barcelone", où se produisait le fantaisiste Dragnum qui chantait le "paradis de la Côte d'Azur", le bal-musette "Gambrinus", le café du "Désarmement" dont le store fut baissé définitivement pour cause de mobilisation du patron lors de la Déclaration de guerre, "La Grotte aux fées" avec son énorme ours empaillé et ses petits boxes sombres où se bécotaient les amoureux! Seul témoin encore debout de cette époque, le bal à papa rétro du "Palais Mascotte"...
Aujourd'hui les dames peu vertueuses de la rue de Berne n'arborent plus des mines aussi triomphales qu'avant l'arrivée du Sida. Et d'autres vieux bistrots populaires ont été démolis ou tristement tansformés, comme le café des «Trois Rois» où se réunissaient les artisans du quartier... Restent le café de la [p. 154] Navigation, sur la place du même nom, qui a été agrandi mais garde tout son cachet, probablement l'un des derniers vrais "bistrots", et le plus beau de la rue des Pâquis. Ainsi qu'une foule d'établissements plus ou moins hybrides, chers ou pas chers, luxueux ou non, des restaurants exotiques, dont les derniers arrivés, les bars à sandwiches turcs où l'on peut se dépayser en écoutant de la musique orientale. Et naturellement, les établissements espagnols de la rue de Fribourg et environs, fiefs des Ibériques installés à Genève.
Bref, il y a de la vie, nous l'avons dit, des vitrines violemment éclairées, du mouvement, des badauds de toutes races, des magasins ouverts tard le soir, dont le bureau de tabac-journaux de la rue des Alpes, une sorte de nonchalance, de laisser aller, expressions d'un certain art de vivre, même s'il est anticonventionnel...
... et le jour
Mais les Pâquis, ce n'est pas seulement "la nuit". Il y a aussi les Pâquis "de jour", les Pâquis d'une certaine tradition bourgeoise, personnifiée par la boulangerie-tea-room Charrière, à l'angle des rues de Zurich et des Pâquis, lieu de rencontre fort apprécié, garant de bonne marchandise. [p. 155]
Il y a les Pâquis des familles, avec notamment une belle école, construite autour des années quatre-vingt, couronnée par un prix d'architecture, et qui héberge quelque 600 élèves, dont 70% sont des étrangers de 45 nationalités. Il y a les Pâquis du tourisme, 5.000 lits d'hôtels qui drainent une population étrangère de 2.000 personnes. Il y a les Pâquis cosmopolites: sur 8.000 résidents, presque la moitié sont des étrangers... bel exemple de coexistence (presque toujours) pacifique!
Cependant, les Pâquisards se plaignent depuis des années que leur quartier soit devenu le lieu de passage (non obligé) de milliers de véhicules quotidiennement. Aussi, au nom de la "qualité de la vie", certaines associations d'habitants ont demandé que la vitesse soit réduite à 30 km/h et que le quartier soit interdit au trafic de transit. Ce qui suscite l'ire des commerçants.
Les bains des Pâquis
Les bains des Pâquis sont, dès le printemps et par beau temps, l'un des endroits les plus vivants, les plus "in" de la Ville. Autrefois, ils n'étaient fréquentés que par les Pâquisards. Nous, les enfants des Eaux-Vives, nous nous rendions exclusivement à Genève-Plage, même si c'était un peu plus cher, mais l'eau y était moins froide. Lorsque j'ai eu dix ans, mes parents m'ont obligé à aller aux bains des Pâquis, car ils avaient lu dans le journal que la Ville y donnait un cours de natation... Aujourd'hui on apprend obligatoirement à nager dès les premières années primaires dans les nombreuses pisci-nes urbaines et suburbaines.
Les bains des Pâquis sont un cas d'espèce. Dans la Genève aseptisée, lisse, qui a connu, jusqu'en 1990, une extraordinaire prospérité, une Genève ivre "d'améliorations" et "d'aménagements" (dont le plus extravagant est le revêtement des rues Basses, avec ses poubelles esthético-design, assorties aux pavés de couleurs différenciées supposées "marquer les traces de l'ancienne cité", selon le discours ethno-socio-technologique à la mode, et que la propagande officielle définissait comme un "nouvel art de vivre"), dans cette Genève ivre de prétention à se hisser au niveau des grandes villes, les bains des Pâquis ont bien failli connaître un sort funeste.
L'argent coulant à pleins ruisseaux, on s'était donc mis en tête qu'il fallait démolir les bains des Pâquis (vieux bains "rétro" d'un charme inouï) pour en reconstruire de nouveaux, plus beaux qu'avant. L'argument avancé était que les [p. 156] bains étaient devenus "vétustes", donc "dangereux", qu'on n'y avait plus la "sécurité". Ils étaient, paraît-il, en si mauvais état qu'une réfection aurait coûté davantage qu'une démolition-reconstruction, avaient assuré des "experts".
Il y eut donc référendum, lancé par des associations écolo-gauchistes du quartier des Pâquis qui remportèrent la victoire. Les bains ne furent donc pas démolis, on s'est contenté de procéder à quelques rafistolages, car entre-temps les caisses de la Ville s'étaient vidées. Et les bains des Pâquis ne s'étant toujours pas enfoncés dans le lac, ils sont devenus lieu de rencontre "branché" où se côtoient vieux habitués Pâquisards, familles venues de partout, intellectuels, touristes, internationaux travaillant dans le quartier, et toute la cohorte des suiveurs de modes. Le soir, il est de bon ton de venir prendre l'apéritif à la buvette "self service", dans un cadre qui est l'un des plus beaux de Genève, au milieu de la rade, avec vue sur la ville, le jet d'eau, le Mont-Blanc, un endroit de rêve entièrement préservé du bruit des véhicules qui passent en files serrées sur le quai Wilson. On y organise concerts et spectacles qui connaissent un très grand succès.
Plainpalais, un pays dans la Ville
Lorsqu'on habite à proximité du Rond-Point de Plainpalais, on trouve de tout. A l'ouest de la plaine, entre Mail et Jonction, il y a encore des classes relativement modestes, des jeunes et beaucoup de personnes âgées. A l'est de la plaine, côté avenue Henry-Dunant et rue de Carouge, un subtil mélange de population, dû à la proximité de quartiers plus "distingués": Les Tranchées, Champel, la Roseraie. Qui d'ailleurs font tous trois partie de la commune historique de Plainpalais... Et depuis que le bus 15, en provenance de Meyrin, a maintenant son terminus au Rond-Point, le brassage est encore plus important.
A la rue de Carouge, on a tous les commerces. Pas moins de trois grandes surfaces, 25 magasins de vêtements, 10 de chaussures, 5 pharmacies, 15 boucheries, boulangeries, épiceries, 10 coiffeurs, une banque et 21 cafés-restaurants... et bien sûr l'Uniprix, dont il a été question plus haut.
A proximité immédiate, les principaux lieux culturels, université, salles de concerts, et de spectacles, Musée d'ethnographie, d'art moderne, et les derniers nés: le "Grütli", maison de la culture traditionnelle. Et "l'Usine" temple de la culture "alternative".
Les lieux de détente ne manquent pas non plus: les Bastions, la Treille merveilleuse, où l'on assiste aux plus beaux [p. 157] couchers de soleil "in town", le petit parc Gourgas, le marchand de glaces de la place des Augustins, les "bords sauvages" de l'Arve jusqu'au Bout-du-Monde et, last but not least, la fameuse Plaine de Plainpalais... Un vieux monsieur à qui j'ai demandé un jour quel était son quartier préféré, m'a répondu: "Plainpalais... c'est le plus beau pays de Genève".
Plainpalais, quelques traits d'histoire
Plainpalais, territoire longtemps incertain, du fait des méandres du delta de l'Arve et de ses crues, ne prend son essor qu'à partir du XVIIe siècle, époque où, grâce à des endiguements, le cours d'eau occupe enfin son lit actuel. Centre de cultures maraîchères importantes, puis d'industrie, dès la moitié du XIXe siècle jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, Plainpalais fut longtemps inhabité. Excepté le long de l'axe rue Saint-Léger — rue Prévost-Martin, l'ancienne voie romaine qui passait à la hauteur de l'actuel pont des Acacias. Et en haut de la Corraterie, où les Dominicains avaient leur couvent (détruit à la Réforme). [p. 158]
L'Arve endiguée, la rue de Carouge est tracée et urbanisée dès le XVIIIe siècle. Elle remplace la rue Prévost-Martin comme axe principal vers le sud. Au début du XIXe siècle, Napoléon construit le pont de Carouge qui prolonge la rue du même nom. Plainpalais devient commune genevoise, puis commune suisse à la Restauration. En 1930, Plainpalais est rattachée à la Ville de Genève et perd son autonomie. 1842 est une année à marquer d'une pierre blanche dans l'histoire de Plainpalais: c'est la date de la construction de l'usine à gaz, considérée comme symbolique de l'industrie naissante. Dès 1850, après la révolution fazyste, les remparts de Genève sont démolis, la ville s'ouvre, de nouvelles voies sont tracées à Plainpalais, l'industrie se développe, le commerce prospère à la rue de Carouge.
L'impulsion décisive pour le développement du quartier est donné sous le règne du maire Charles Page, à la fin du XIXe et au début du XXe siècle. On construit la mairie, la Maison communale, des écoles, les quais de l'Arve. Lors de l'Exposition nationale de 1896, entre l'Arve et la Plaine, on ouvre les boulevards Carl-Vogt et Saint-Georges. Des industries de pointe s'installent à Plainpalais: la Société genevoise d'instruments de physique (SIP), Kugler, Gardy, Motosacoche, Tarex, Usine de dégrossissage d'or... Ainsi que des services d'intérêt public: les abattoirs, les Ecoles de chimie et de médecine, l'Institut d'Hygiène, la Compagnie genevoise des tramways électriques (CGTE), le Palais des expositions (1928). On construit des coopératives d'habitations ouvrières. Ainsi que des lieux de plaisir: cirque Rancy (place du Cirque), Casino de l'Espérance (rue de Carouge), Palais d'hiver (rue du Stand).
Dès 1960, les fleurons de l'industrie quittent Plainpalais, le quartier se modernise, et l'on assiste à l'implantation de bâtiments administratifs toujours plus nombreux (Travaux publics, Police, Finances, Université), ainsi que d'ensembles résidentiels. Le quartier de Plainpalais perd peu à peu son particularisme ouvrier pour devenir un quartier comme les autres.
La Plaine
La plaine de Plainpalais, avec l'ambiance qui y règne, les activités qui s'y déroulent, mérite un chapitre à elle seule. Ce vaste losange plat, bordé d'artères à grande circulation, d'immeubles disparates, (l'élégance du style fazyste faisant contraste avec la médiocrité des constructions "années 1960-1970"), est peut-être le seul lieu à Genève qui donne l'impression d'une grande ville. [p. 159]
La Plaine reste l'un des rares espaces "libres", sans chichis décoratifs, sans bacs à fleurs, sans gadgets petit-bourgeois. Les surfaces vertes, à l'opposé des gazons anglais, semblent avoir été foulés par les hordes d'Attila. La raison en est que lors de la construction du parking souterrain, on n'a recouvert le béton que d'une couche de terre insuffisante. Lorsque le temps est sec, en été, pendant plusieurs semaines, l'herbe n'est plus que touffes brûlées. Et lorsqu'il pleut plusieurs jours de suite, des lacs se forment et les mouettes, par centaines, viennent pêcher des vers.
Mais n'en déplaise aux fanatiques d'aménagements "bien cousus, solides", la Plaine n'a nullement besoin de faire "joli". Elle est le cadre de manifestations d'envergure qui ne demandent qu'un chose: de l'espace. Et il faut avoir vu le cirque Knie coincé sur la place Bellevue à Zurich, après l'avoir vu s'étaler harmonieusement sur la Plaine, pour s'en convaincre.
Il se passe toujours quelque chose sur la Plaine et même le dimanche, quand partout ailleurs la ville est morte, et que les habitants sont allés reconstituer des bouchons sur les routes [p. 160] du week-end. Il y a les importants marchés de fruits et légumes. Et le marché aux puces qui est non seulement le rendez-vous de personnes de condition modeste, en quête d'un frigo pas cher ou d'un manteau d'occasion, mais aussi le lieu de promenade "obligé", surtout les samedis matin, de tout un milieu "branché" qui vient moins au marché aux puces pour découvrir l'objet de valeur (de plus en plus rare), que pour se rencontrer, se voir et se faire voir. Le "paraître" y tient bien souvent lieu d'art de vivre, plus que "l'être"...
On voit de plus en plus de tentes, petites et grandes, depuis la fermeture du Palais des expositions qui a élu domicile au Grand-Saconnex. Outre les cirques, traditionnels ou d'avant-garde, elles abritent des salons d'antiquaires ou des marchands de santé par les médecines douces, des fêtes de partis politiques, des réunions à caractère religieux, des montreurs de reptiles, des manifestations de bienfaisance.
En plein air, il y a les fêtes foraines hautes en couleurs, les meetings politiques, les courses de stock cars, les séances de cinéma Drive in. On y a même fait pousser du blé symbolique, lors du 700e anniversaire de la Confédération. En été, il y a les marchands de glace.
Outre les manifestations plus ou moins éphémères, il y a le permanent. Une vaste aire de jeu réservée aux enfants, où l'on peut voir, notamment les jours fériés, une foule d'enfants accompagnés de leurs parents, de toutes couleurs de peau et s'exprimant dans toutes les langues, qui viennent parfois de bien au-delà des frontières de Plainpalais, et même en voiture.
L'aire de jeu, équipée de tables, est aussi le théâtre de parties de cartes disputées par les Italiens de la "première génération". Il y a aussi des travailleurs yougoslaves qui jouent au ping-pong. Et des adolescents portugais de la seconde génération qui jouent au football avec des pulls en guise de buts, comme les gamins suisses moins gâtés de l'immédiat après-guerre. L'histoire est un éternel recommencement...
Enfin, la Plaine est le rendez-vous préféré, le plus vaste en ville, des propriétaires de chiens, qui dissertent sur les mérites respectifs de leurs toutous pendant que ceux-ci s'ébrouent. En cette fin de siècle qui se veut de communication, et où il semble que rarement les gens ont été plus crispés et renfermés, le chien est, comme l'enfant en bas âge, un des rares prétextes à engager spontanément la conversation avec des inconnus dans la ville.
La plaine de Plainpalais est le coeur vivant du quartier, mais aussi le point de ralliement le plus important de toute la ville. On y côtoie toutes les classes sociales, tous les âges, et chacun est sûr d'y touver un jour ou l'autre son content.
[p. 161: image / p. 162]
De Plainpalais aux Eaux-Vives
Quand on habite Plainpalais, on n'a pas besoin d'auto. On se trouve à 15-20 minutes à pied de presque tout. De la gare Cornavin, des hauts de la rue de Lyon, par le chemin Galiffe, des Eaux-Vives par le Bourg-de-Four, des Pâquis, par le pont des Bergues (en été, en Mouette, depuis le Molard). On est près de tout, et qui plus est, Genève est ainsi faite, qu'on peut presque toujours joindre un point à un autre, par des itinéraires charmants, en évitant les artères à grande circulation... Artères qu'il faut bien traverser quelquefois. Mais ce ne sont jamais que de mauvais moments à passer!
Aujourd'hui, je file me dépayser dans le quartier des Eaux-Vives. "Exotique" et excentré par rapport au reste de la ville, ce quartier, bien que populeux, respire un certain calme bourgeois. Pas canaille comme les Pâquis, rien de prolétarien comme Plainpalais...
Depuis la rue Leschot, je grimpe Saint-Léger, le long des Bastions, où l'ail sauvage est déjà haut, derrière les grilles. Au Bourg-de-Four, la terrasse, qui a pris de l'ampleur depuis que la place a été fermée en partie au trafic, est noire de monde, Genevois et touristes. Il ne reste qu'à descendre vers les rues Basses par la tranquille rue Verdaine, à dépasser Rive. Et après la traversée de l'axe à grand trafic Versonnex — Pictet-de-Rochemont, j'entre de plain-pied [p. 163] dans le quartier par la rue des Eaux-Vives, cossue, bordée de solides immeubles fazystes et de style "Suisse 1900".
Je projette d'aller boire un café chez "Mauricette", vieux bistrot à l'angle des rues Montchoisy et du XXXI Décembre. L'établissement s'appelle maintenant "Cinecitta", et a été complètement transformé. On s'assied sur des sièges de toile, derrière lesquels les noms de grandes vedettes italiennes ont été brodés: Sophia Loren, Lollobrigida. Il y a une grande fresque sur une paroi qui représente une salle de cinéma avec des spectateurs dont les têtes, entourées d'un halo blanc, sont tendues vers l'écran, laissant supposer que le film va bientôt commencer. C'est froid et hyperréaliste... De plus en plus de bistrots font ainsi des frais de décoration picturale, pour créer du nouveau.
Un quartier attachant
En sortant de Cinecitta, je vois un type qui me fait des grands gestes sur le trottoir d'en face. C'est l'ami Maurice, l'architecte, que je n'avais plus vu depuis des lustres: je ne pouvais espérer trouver meilleur guide dans ce quartier où il est né.
Maurice m'affirme qu'il ne sort plus guère des Eaux-Vives. A la limite, affirme-t-il, on pourrait y vivre de façon autonome. On a tout ce qu'il faut à portée de la main. Autant de boucheries, boulangeries et même d'épiceries que l'on veut. Sans compter un cinéma intéressant, une bonne librairie, des magasins de photos, et de plus en plus de galeries d'art. "Bientôt, un nouveau Carouge", prophétise-t-il.
Maurice m'entraîne boire un verre au café de l'Ecole, qui avec le "Jura" est parmi les derniers vrais bistrots du quartier, sans prétention, où l'on peut encore rencontrer des personnages. Il me parle du passé. De la rue de l'Avenir où l'on trouve l'ultime bâtiment avec escalier en bois menant à l'étage, sorte de grange campagnarde comme il y en avait de multiples, jusque vers 1960, quand le quartier a subi un nombre élevé de démolitions-reconstructions. De la rue de Montchoisy qu'on avait surnommée, à l'époque "rue des Cervelas", car il s'y établissait une population qui mangeait des cervelas toute la semaine pour pouvoir aller "faire un tour en bagnole le dimanche". Des champs de blé qu'on moissonnait encore, en haut du quartier, entre la rue de Montchoisy et l'avenue de Frontenex. Du quai investi par d'énormes tas de gravier, aujourd'hui parking à l'usage d'innombrables bateaux de plaisance, des chantiers navals... Ces temps sont révolus, mais la vie continue...
[p. 164]
Un quartier où il ne se passe rien
Je m'attable dans un de ces tea-rooms chics, comme il y en a à Champel, où papotent des dames désoeuvrées, vêtues avec un goût exquis et accompagnées de petits caniches blancs... Champel est vraiment le quartier apparemment le plus morne, le moins vivant de la ville, avec Saint-Jean. Peu de cafés dignes de ce nom, aucune vie, si ce n'est au parc Bertrand, pendant la journée, où l'on peut voir les enfants jouer, et au Centre médical universitaire (CMU) où les étudiants en médecine apportent quelque animation. Mais le soir venu, le désert sombre, au point que selon la police, il est plus dangereux de s'y promener en solitaire qu'aux Pâquis, mal famés, mais où il y a toujours du monde et de la lumière.
A une table voisine de la mienne, une vive conversation s'engage. Une dame d'un certain âge, guère remarquable au premier abord, raconte à une autre dame les péripéties de sa vie passée et présente. Il s'avère que c'est un véritable roman, passionnant, impliquant de nombreux personnages, se déroulant entre Champel, New-York, Saïgon, Londres, Hong-Kong et Vancouver, avec des rebondissements extraordinaires et des perspectives inouïes... Qu'est-ce qui m'autorise à raconter que Champel est un quartier ennuyeux? Alors que je viens de passer un moment exceptionnel à l'écoute (indiscrète) de cette vieille dame...
J.-P A.
haut
[p. 165]
Les Grottes
De tous les quartiers, c'est celui des Grottes qui a le plus souvent défrayé la chronique depuis les années soixante-dix. Il s'agit d'une parcelle de 108.000 m2, située à l'ouest de la gare de Cornavin, entre la Servette et les Cropettes, traversée dans sa longueur par le nant des Grottes, actuellement enterré.
Jusqu'au milieu du XIXe siècle, le domaine des Grottes, situé en dehors des fortifications, apparaît sur les gravures de l'époque comme une agréable campagne plantée de vignes par endroits et entrecoupée de bosquets d'arbres.
La démolition des fortifications et la construction de la gare Cornavin entraînent un profond bouleversement. Le domaine se morcèle en lots minuscules et il se crée un enchevêtrement invraisemblable de chemins privés, de ruelles et de constructions disparates où s'installent, entre les immeubles d'habitation, de petites entreprises artisanales ou commerciales.
Déjà en 1856, l'architecte Frédéric-Christian Fendt, élève du Général Dufour, tente de remédier à ce désordre. On lui doit quelques immeubles, notamment celui qui fait l'angle de la place Montbrillant et de la rue qui porte son nom, mais le coeur du quartier résiste à ses efforts.
L'installation de la Société des Nations dans le parc de l'Ariana et le concours d'architecture qui l'a précédée suscitent plusieurs projets d'aménagment des routes d'accès (voyez le tome VIII de cette Encyclopédie, pages 219-223) et le 3 mars 1929, le Conseil administratif de la Ville, s'adressant au Conseil municipal, déclare: "Il importe actuellement d'adapter sans retard la plan d'aménagement des quartiers situés derrière le barrage des voies de chemin de fer." Cette déclaration coïncide avec l'adoption, le 9 mars 1929, des deux lois cantonales qui règlent dorénavant l'utilisation du sol: la loi sur les constructions et les installations diverses et la loi sur l'extension des voies de communication et l'aménagement des quartiers et localités.
La crise des années trente, puis la Deuxième Guerre mondiale relèguent ce plan aux oubliettes.
Mais avec le temps, la décrépitude des bâtiments s'accroît et le quartier prend l'allure d'un bidonville, si bien que le 21 décembre 1968 se crée une fondation de droit public cantonal, la Fondation pour l'aménagement du quartier des Grottes (FAG), avec pour mandat de procéder à une étude complète des conditions économiques et sociales de la région et pour objectif de rénover de fond en comble un quartier considéré comme bon pour la démolition.
Un premier projet est présenté en 1971, inspiré du mythe de la Genève de 800.000 habitants. Il prévoit de raser le quartier [p. 166] et de construire une série d'immeubles perpendiculaires à la Servette pour y loger entre 6.000 et 10.000 habitants. Ce projet est exposé à la Maison du Faubourg et soulève de vives critiques. Qualifié de petit Manhattan, il est abandonné.
Il faut relever toutefois qu'à l'époque, la démolition du quartier était généralement admise comme une nécessité. Dans le livre qu'il a publié en 1971, accompagné de photographies de Roger d'Ivernois, sous le titre La Genève des Grottes, l'historien Eugène-Louis Dumont écrit à propos du "Vieux quartier sordide des Grottes": "... rien à redouter, il ne sera fait nul référendum, ni levée de boucliers pour protéger cet ensemble lépreux et misérable. Tout crie l'extrême vétusté, la décrépitude...".
Un deuxième projet est présenté en 1975, de densité inférieure, qui ne trouve pas non plus l'agrément des habitants du quartier et d'une foule d'opposants venus de l'extérieur. Luc Weibel écrit dans le Journal de Genève du 11 novembre 1975: "Raser les Grottes, un massacre". Un débat public dégénère et l'opposition s'organise dans une association: l'Action populaire aux Grottes (APAG) qui procède, à partir de 1977, à des "relocations forcées", autrement dit à l'occupation, par des squatters, d'immeubles destinés à la démolition. La lutte est violente, elle se termine parfois au tribunal, parfois à l'hôpital.
De leur côté, le Conseil d'Etat et le Conseil administratif abandonnent l'idée d'une rénovation profonde et définissent, en juillet 1978, une nouvelle orientation des études visant à la réhabilitation du quartier. C'est ce qu'on nomme la "nouvelle image directrice" qui donne naissance à un troisième projet, celui-là définitif, exposé en mars-avril 1981 dans les halles de l'Ile sous le titre "Demain les Grottes". Il s'agit d'un projet de rénovation douce, les immeubles sains devant être conservés et restaurés, tandis que les maisons insalubres seront remplacées par des immeubles neufs. La première de ces constructions, l'immeuble des "Schtroumpfs", dû aux architectes Robert Frei, Christian Hunziker et Georges Berthoud, est mis en chantier en 1981.
Devant l'insuccès de ses efforts, l'APAG lance une initiative populaire "pour la réhabilitation/remise en état du quartier des Grottes", qui est rejetée le 14 novembre 1982 par 9.643 voix contre 7.086. Dès lors, la nouvelle image directrice a l'aval de la population, l'APAG se dissout et les travaux sont conduits avec célérité.
Ce long épisode (La Tribune de Genève titre, le 25 avril 1972, "Enfin un projet acceptable après 43 ans de pourparlers") montre combien, malgré l'uniformisation des constructions et des mentalités, un quartier peut se mobiliser et mobiliser [p. 167] une partie de l'opinion, lorsque ses habitants se sentent menacés par un projet d'urbanisme niveleur. Laurent Rebeaud écrivait, dans L'Année économique et sociale de 1983: "Les Grottes, condamnées à la démolition voici moins de 6 ans, auront été sauvées par les squatters".
Saint-Gervais
Situé sur la rive droite du Rhône, à la hauteur de l'Ile, le quartier de Saint-Gervais s'est toujours distingué, au cours des siècles, de son opulente voisine. Un peu comme le Petit-Bâle face à la ville aristocratique et commerçante. N'a-t-on pas longtemps appelé le bourg de Saint-Gervais, "Genève la petite" (Geneva minor)?
Au moment où Jules César détruit le pont sur le Rhône pour empêcher les Helvètes de pénétrer dans les territoires contrôlés par Rome, la rive gauche est occupée par les Allobroges, soumis à Rome quelque soixante ans plus tôt, tandis que la rive droite, dominée par les Helvètes, fait encore partie de la Barbaria. Après la bataille de Bibracte et la conquête de la Gaule, les Helvètes sont renvoyés d'où ils viennent, c'est-à-dire le Plateau suisse actuel, entre le Léman et le Bodan. La rive droite du Rhône fait donc partie de leur territoire, ou province de Germanie, tandis que Genève, sur l'autre rive du fleuve, dépend de la colonie de Vienne, en Narbonnaise. Cette distinction se prolonge au Moyen Age. [p. 168: image / p. 169] D'après un document du 18 janvier 926, Saint-Gervais faisait partie du comté équestre (du nom de la Colonia Zulia Equestris centrée à Nyon) qui avait pour limites, en face de Genève, le cours du Rhône. Certains documents font supposer qu'après la fin du Deuxième Royaume de Bourgogne (1032), les droits sur le comté équestre sont passés aux comtes de Genève et à leurs vassaux les sires de Gex, et qu'à partir du XIlle siècle, l'évêque de Genève a peu à peu étendu sa juridiction temporelle sur la rive droite du Rhône, jusqu'à éliminer complètement les seigneurs de Gex au XIVe siècle. L'incendie du quartier de 1345, dû au sire de Gex, apparaît dès lors comme la vengeance d'un prétendant éconduit. Ainsi, pendant près d'un millénaire et demi, les deux rives du Rhône ont été soumises à des souverains différents.
Par la suite, la vocation particulière de Saint-Gervais s'affirme sur le plan économique, en tant que centre de la "Fabrique", c'est-à-dire des fabricants de montres, de bijoux, de pièces d'orfèvrerie, d'émaux, et sur le plan politique en tant que faubourg attaché à la défense des droits du peuple genevois.
Dès le XVIle siècle, le caractère industriel du quartier se traduit dans l'architecture: les immeubles comportent presque tous, sous le toit, une rangée de fenêtres correspondant aux "cabinets", autrement dit aux ateliers d'horlogerie, dont les artisans se nomment "cabinotiers". Les témoignages sont unanimes: il s'agit là d'une aristocratie ouvrière, fière et indépendante. N'est pas maître-horloger qui veut: il faut être citoyen ou bourgeois de Genève, ne pas faire travailler dans son atelier plus de deux compagnons et un apprenti, résider à Genève et se soumettre aux prescriptions minutieuses des ordonnances qui réglementent l'exercice de la profession.
Chacun connaît ce texte de Jean-Jacques Rousseau parlant de son père, lui-même fils et petit-fils d'horloger: "Je le vois encore, vivant du travail de ses mains et nourrissant son âme des vérités les plus sublimes; je vois Tacite et Plutarque mêlés, devant lui, avec les instruments de son métier".
Mais ces cabinotiers qui, d'après un mémoire adressé le 7 juillet 1798 au commissaire Desportes, "font vivre un tiers, au moins, des habitants de Genève", sont aussi des caractères.
Cité par Emile Doumergue, le directeur de l'Ecole d'horlogerie écrivait au début du siècle: "Très indépendant, et usant dans ses expressions d'une suprême désinvolture et d'un pittoresque achevé, ayant la riposte alerte et la comparaison mordante, le cabinotier défendait ses idées, toujours très personnelles, avec une remarquable ténacité". Et le Saxon Christian-Auguste Fischer écrivait, en 1793: "Les [p. 170] habitants du faubourg de Saint-Gervais se distinguent du reste des Genevois par la langue, l'accent et les moeurs autant que les Saxons des Francfortois. Leur parler est affreux. Ils disent: «Vayoons var. Voyeis ovrer la porte. J'envayerai. Je vodrois qu'il fisse, etc.» Ils ont aussi des termes à eux: ils se nomment volontiers «péclotiers», se rencontrent au «vendange» (cabaret) où ils avalent un «change-banal» (souper léger), puis assistent à une pièce de théâtre au «poulailler». Leur mot de passe est «Dieumedamne»."
En politique, les cabinotiers de Saint-Gervais suivent, au XVIIIe siècle, les thèses des Représentants, le parti qui défend les droits du peuple en présentant au Conseil des "représentations". En 1734, un conflit éclate au sujet de la perception de nouveaux impôts destinés à couvrir les frais des fortifications. Le Conseil ayant, par crainte d'un soulèvement, fait "tamponner" les canons de Saint-Gervais pour les rendre inutilisables, il provoque la révolte et doit faire appel à la médiation des cantons de Berne et de Zurich. Trente ans plus tard, après la condamnation du Contrat social et de l'Emile, et surtout après la publication des Lettres écrites de la montagne (1764), les habitants de Saint-Gervais prennent fait et cause pour l'auteur, leur idole, et font obstruction au gouvernement, acculé à faire de nouveau appel à la médiation des puissances protectrices. En 1770, les cabinotiers prennent la défense des "natifs", c'est-à-dire des fils d'habitants sans droits politiques et presque sans droits civils. Ils s'adressent à Voltaire qui en recueille une cinquantaine à Ferney et à Versoix où il crée une industrie horlogère concurrente de la Fabrique. Mais c'est au XIXe siècle que le rôle politique du Faubourg s'affirme avec le plus de violence et d'efficacité. Conduits par James Fazy, les habitants de Saint-Gervais font les révolutions de 1841 et de 1846 et les émeutes de 1864, ce qui fait dire à Théophile Gautier que Saint-Gervais est le quartier de la "démocratie orageuse" et à Jeremias Gotthelf que c'est la "chaudière du diable".
Quant à Philippe Monnier, dans La Genève de Töpffer, il donne cette description du faubourg Saint-Gervais: "Le verbe est plus haut, le rire plus sonore, l'accent plus marqué. Les gestes sont plus rapides et les têtes sont plus chaudes. Cela grouille de mouvement, d'allégresse et de vie. On sent un peuple plus près de la nature et plus près des origines, un peuple instable, mobile, spontané, inquiet, tumultueux, turbulent; un peuple ayant la tête près du bonnet, l'enthousiasme, l'indignation, la colère spontanée; un peuple qui s'en va à la statue de Jean-Jacques comme à un lieu de pélerinage et qui, comme les Allobroges d'autrefois, semper nova petentes, demande toujours des choses nouvelles, qu'aucune [p. 171] discipline ne morigène et qu'aucune victoire ne satisfait; qui se cabre, puis qui s'abandonne; qui se révolte, puis qui s'oublie".
Les choses ont bien changé, surtout depuis la Deuxième Guerre mondiale. L'Hôtel du Rhône, la Placette, les immeubles modernes de la place Saint-Gervais ont transformé la physionomie du quartier, mais il reste quelques maisons intéressantes, en particulier à la rue de Coutance, à la rue des Etuves et à la rue Rousseau, et surtout le temple de Saint-Gervais, qui date du XVe siècle et contient des oeuvres de valeur, et où les récentes fouilles ont révélé des origines très anciennes et très importantes. Après l'Escalade de 1602, les dix-sept morts genevois, faute de place dans un cimetière de la Ville, ont été enterrés au cimetière de Saint-Gervais; la dalle funéraire est encastrée dans le mur du chevet. Il reste aussi, chez ses vieux habitants, un certain esprit frondeur, rouspéteur et grincheux caractéristique du faubourg.
J. de S.
haut
Les parcs, lieux de rencontres
Aujourd'hui les quartiers urbains ont perdu de leur attrait, la rue n'appartient plus aux enfants et les adultes ne s'y promènent plus guère, sinon pour aller faire des achats dans les magasins. Mais il y a de beaux restes: les parcs de la Grange et des Eaux-Vives, dans le quartier du même nom, le parc Mon Repos aux Pâquis, les Bastions à Plainpalais. Ainsi qu'un multitude de squares, petits parcs, places de jeux, préaux aménagés où fourmillent enfants et parents. Dont la moitié sont des étrangers. Ce sont des lieux de "papotage" où les gens font connaissance et communiquent. Timidement. Par enfants interposés. Et où se lient parfois des amitiés... Enfin, sur la rive droite, dans les quartiers du Grand-Pré et de Vermont, les architectes ont conçu de vastes zones de verdure (nature résiduelle) entre les immeubles bâtis, à partir des années 1955.
Et les cités satellites
Mais c'est finalement dans le voisinage des cités satellites tant décriées (des villes construites à la campagne), qu'on est le plus "proche de la nature".
Au Lignon, il suffit de passer la passerelle sur le Rhône, on se trouve dans les champs de blés, de belles forêts sauvages, et [p. 172] l'on a la ferme de Loëx avec ses animaux, dans une région où l'on peut presque parvenir à se perdre. Et autour de la cité satellite de Meyrin, on peut se promener à l'infini par champs et bois, et voir des vaches paître dans les prés. On peut traverser la frontière française sans même s'en apercevoir et pousser, pourquoi pas, jusque sur la crête du Jura. Bien sûr, il y a parfois des routes à traverser. Mais pas encore d'autoroutes.
Dans les cités satellites qui ont vingt ans d'âge, les municipalités se préoccupent de construire de nouveaux immeubles pour les jeunes de la seconde génération d'habitants. Ce qui est parfois difficile, vu la rareté du terrain. Ce type de [p. 173] difficulté se retrouve même à la "Cité nouvelle" d'Onex, le plus critiqué des grands ensembles du Canton. Outre son architecture banale, on lui a reproché d'être un vaste ghetto sans âme et sans racines. Cependant, si l'on est né à la Cité nouvelle et qu'on y a grandi, il semble que "pour rien au monde on ne voudra s'établir, fonder un foyer ailleurs". Preuve encore une fois faite qu'on sait aussi y pratiquer un certain art de vivre. Et que cette notion "d'art de vivre" est, en définitive, toute relative et personnelle.
Ceci explique-t-il cela? Il s'est développé une importante vie associative dans les communes suburbaines, où l'on compte de très nombreuses sociétés sportives, culturelles, d'intérêt public, fort actives et bien subventionnées. A Meyrin, commune opulente de 22.000 habitants, 43 sociétés faisant partie du cartel des sociétés meyrinoises totalisent 8.000 membres, y compris les enfants. Ce chiffre impressionnant est toutefois relativisé par le fait que nombre de personnes sont inscrites dans plusieurs sociétés. Bref, ici comme ailleurs, ce sont toujours les mêmes qui font les choses, qui participent...
L'auberge espagnole
Il y a évidemment autant de conceptions de l'art de vivre qu'il y a d'individus. Pour certains, cet art implique, en premier lieu, le temps. Du temps en suffisance, non comptabilisé. A l'opposé de ce que nous en avons fait... De l'argent. Un temps budgétisé réparti entre des tas "d'activités".
Une femme peintre à qui je demandais récemment si elle ne souffrait pas de vivre dans telle petite ville réputée par trop provinciale, me répondit: "Mais vous n'êtes nulle part obligé de vivre comme un provincial. Ce que vous faites ne dépend finalement que de votre univers mental. Certains restent toute leur vie des provinciaux à Paris. D'autres font venir le monde entier dans leur bicoque à la campagne"...
De même, la réponse à la question: "Comment vit-on dans tel quartier?" peut être: "Pas différemment que dans tel autre quartier. Comme dans l'auberge espagnole, on y trouve ce qu'on y apporte. Chacun prend possession, selon ses moyens, d'une ville, d'un quartier. Il n'est pas d'art de vivre sans possession, de possession sans connaissance, de connaissance sans vagabondage, de vagabondage sans abondance de temps. Cependant l'art de vivre dans une ville, un quartier, n'est pas forcément lié aux activités, reconnues comme telles, qui s'y déroulent ou qu'on y exerce. Cet art peut consister en un simple regard porté sur la ville, le quartier...
[p. 174]
Les squatters, un nouvel art de vivre
Du fait de la spéculation immobilière effrenée qui a caractérisé ces dix dernières années — une des causes de la cherté des loyers —, la vie économique genevoise a été considérablement faussée et la "qualité de la vie" s'est dégradée pour une frange non négligeable de la population. Une partie de la jeunesse, la plus turbulente, mais aussi la plus imaginative, désireuse de rompre les liens familiaux et ne trouvant pas de logis à la mesure de ses moyens, se mit à "squatter" des immeubles, dont certains étaient vides depuis des années, ceci avec l'accord tacite des autorités. Ces squats sont répartis dans la plupart des quartiers de la ville.
Cependant, ces jeunes ne se contentent pas d'occuper les immeubles. Ils tentent d'y créer un nouvel "art de vivre". Face à la débauche de gaspillage qui caractérise notre société consumériste, réalisons les choses avec un minimum de moyens, telle semble être leur philosophie. Pourquoi, par exemple, peindre un volet en entier, alors qu'il suffit d'en barbouiller un angle, comme sur la façade du squat de la rue Rousseau, dans le quartier de Saint-Gervais? Il n'y a que l'intention qui compte...
Cependant la créativité de ces jeunes occupants ne se résume pas à cette provocation. A l'intérieur des squats, toute une vie culturelle s'organise, des caves aux greniers. D'abord il a fallu parfois réparer les dommages que certains propriétaires, eux-mêmes, avaient commis afin de décourager les gens d'occuper leurs immeubles. Souvent, les sanitaires avaient été détruits à la masse, comme au 2, de la rue de Carouge. D'étudiant, on s'est donc improvisé plombier et maçon.
Par la suite, on organise des expositions de peinture, des concerts rock dans les caves des immeubles, avec entrée payante modeste, histoire de faire la nique aux "requins du show biz". On donne des représentations théâtrales au "Garage", dans le triangle de Villereuse. On ouvre des restaurants de squat où l'on peut manger une excellente cuisine pour moitié moins cher qu'ailleurs ... Ainsi s'initie-t-on à la gestion! Bref, on est loin de la poterie et autres occupations innocentes prônées dans certains centres de loisirs ...
J.-P. A.
haut
[p. 175]
Travail et vie quotidienne
La population genevoise et l'emploi
Genève, ville des services. Voilà qui n'est pas nouveau dans ce Canton. En 1900 déjà, près de la moitié de la population résidente active dans l'économie travaillait dans le secteur tertiaire. En 1985, trois personnes sur quatre y trouvent leur salaire, alors que l'agriculture n'en occupe même pas deux pour cent. Canton du tertiaire par excellence, Genève est suivi, mais d'assez loin, par Zurich et Bâle-Ville.
Genève, ville de fonctionnaires? On le laisse volontiers entendre. En réalité, 77 pour cent des actifs travaillent dans le secteur privé et 18 pour cent dans le secteur public suisse (Canton, communes et Confédération réunis), auxquels s'ajoutent 5 pour cent de fonctionnaires internationaux et de membres de missions diplomatiques. Cela dit, il est vrai que le nombre d'employés dans le secteur public suisse a plus que triplé entre 1950 et 1980, ce qui reflète l'élargissement des tâches de l'Etat et aussi l'euphorie des années d'abondance.
Ce n'est pourtant pas le secteur public qui détient la palme en matière de croissance du personnel. Dans la période citée, banques et assurances multiplient leur effectif par 3,5, taux sans doute encore dépassé dans le cadre des agences immobilières et du conseil juridique. Cette croissance a été brutalement stoppée au cours de ces dernières années.
Le Genevois est, sauf exception, un salarié. Comme dans l'ensemble de la Suisse, l'exercice libre d'un métier se perd: les indépendants formaient le quart des personnes actives au début du siècle, ils ne sont que huit pour cent aujourd'hui (la moitié d'entre eux exerçant seuls). Dès l'approche des années soixante-dix, les "cols blancs" l'emportent sur les "cols bleus" et composent, en 1980, 54 pour cent de l'emploi. Mais le travail ouvrier garde de l'importance, puisqu'il est exercé par une personne sur trois (1980: 35%). Mais, depuis 1960, il se déqualifie: à cette date, 48% des ouvriers étaient qualifiés; ils ne sont que 31% en 1980. Plus de la moitié des ouvriers (57%) sont étrangers.
L'âge du travail
D'après les statistiques tout au moins, le travail de l'enfant avait disparu de Genève en ce début de siècle. Celui de la personne âgée, en revanche, se prolonge jusqu'à ces toutes dernières décennies. L'AVS, introduite en 1947, crée la possibilité, mais non l'obligation, de l'arrêt du travail. En 1960, dans le canton de Genève, 56% des hommes âgés de 65 à 69 ans exerçaient un emploi (Suisse: 61%) et encore 29% [p. 176] (sic!) de ceux de 70 ans et plus (Suisse: 33 %). Vingt ans plus tard, ces actifs âgés ne sont plus que, respectivement, 25 et 8% (Suisse: 26 et 9%). Il a fallu pour cela que la pension de retraite vienne compléter l'AVS, mais aussi que la pression d'un marché de l'emploi en voie de contraction se fasse sentir. Cela dit, ces taux d'activité n'en continuent pas moins d'étonner nos voisins français ou allemands, chez qui plus de la moitié des jeunes sexagénaires sont déjà retraités.
La révolution des femmes
Nous sommes les héritiers d'une civilisation qui procla-mait envoyer l'homme au travail et confier le foyer à la femme. En fait, était-ce vraiment le cas hier? Et ne l'est-ce plus aujourd'hui?
Une première approche globale semble nier tout change-ment: parmi les femmes âgées de 15 ans et plus, en 1910 à Genève, 38% assumaient un emploi; en 1980, elles sont un pour cent de plus (39%), selon un décompte qui inclut main-tenant les emplois à temps partiel (en Suisse: 36 puis 37,5%).
Mais cette apparente stabilité s'explique par deux grands mouvements qui s'annulent entre eux. D'un côté, l'encou-ragement aux études et l'institutionnalisation de la retraite provoquent une nette baisse du taux d'actives avant vingt [p. 177: image / p. 178] ans et après soixante ans; de l'autre, surtout depuis 1960, se manifeste la volonté très nette d'exercer une profession de la part d'une majorité de femmes âgées de vingt à soixante ans, comme l'indique le graphique ci-dessous.
C'est en considérant le taux d'activité parmi les femmes de 25 à 60 ans que l'on mesure le changement des usages féminins: en 1920, 37% d'entre elles sont actives, en 1960, 46%; 10 ans plus tard, 60%, pourcentage qu'on retrouve en 1980.
Efforçons-nous de reconstituer la trajectoire de quatre générations de femmes, la plus ancienne étant composée de personnes nées entre 1886 et 1890, la plus récente de femmes nées entre 1946 et 1950 (graphique ci-dessous).
Le comportement de la première cohorte (née avant ce siècle) suit un modèle traditionnel. A vingt ans environ, vers 1910, sept femmes sur dix ont une activité; dix ans plus tard, mariées et mères de familles, trois d'entre elles se retirent au foyer, et moins de quatre continuent à travailler au bureau ou à l'usine. Qui sont ces dernières? Dans leur très grande majorité, des femmes qui n'ont d'autre choix que de travailler pour survivre: célibataires, séparées, mais aussi beaucoup de femmes mariées des milieux prolétaires, dont le salaire va permettre au ménage de "nouer les deux bouts". Celles-ci ne quitteront guère leur emploi avant soixante-cinq ans sonnés; elles furent parmi les premières à bénéficier de l'AVS.
La seconde cohorte présente un profil évolutif semblable à la précédente. L'augmentation légère du taux de l'emploi à la cinquantaine est causée par le fait que, depuis 1960, la statistique comptabilise tous les emplois à temps partiel, donc ajoute environ 4 à 6 pour cent.
Ainsi, jusqu'à cette génération née au début du siècle, le tableau général est le suivant: de dix femmes, trois n'exercent jamais d'activité professionnelle; pour trois autres, l'emploi représente un rite de passage qui n'est pas sans rappeler le [p. 179] service militaire pour les hommes. Pour les quatre dernières, à l'exception d'une minorité avant-gardiste et privilégiée, travailler est la condition de la survie.
La troisième cohorte (1926-30) marque la transition: l'arrêt de l'emploi, après le mariage et l'enfant, continue d'être la règle pour le quart des femmes actives à vingt ans. Mais voici que, parmi ces dernières, une sur deux reprend un emploi entre quarante et soixante ans. C'est entre 1960 et 1980 que ce comportement nouveau s'affirme, qui trouve son aboutissement avec les générations suivantes.
Dans la dernière cohorte, née après la guerre, seule une femme sur sept se retire du marché de l'emploi entre vingt et trente ans. Et, si la situation économique le permet, le taux d'activité de cette cohorte restera constant au cours de son vieillissement, jusqu'au moment de la retraite.
Ainsi, l'idéal de la femme au foyer a largement dominé parmi les générations d'avant-guerre, mais cet idéal n'était pas accessible à plus du tiers des femmes. Aujourd'hui, un nouveau modèle s'impose, qui revendique l'égalité d'accès au marché de l'emploi et le droit de la femme mariée à la carrière professionnelle: parmi les femmes mariées âgées de 25 à 50 ans, plus d'une sur deux a une activité professionnelle en 1980; ce n'était le cas que d'une sur quatre en 1960. Ces femmes-là tiennent à continuer à travailler contre vents et marées, malgré les difficultés à concilier famille et carrière professionnelle (la solution étant pour près de la moitié l'emploi à temps partiel), malgré la moindre qualification (voir tableau ci-dessous) et l'inégale rétribution de l'emploi féminin, malgré aussi la contraction du marché de l'emploi depuis le milieu des années soixante-dix.
Les étrangers et les voisins
La part des étrangers dans la population résidente active est importante; elle était de 18% en 1950, elle a doublé pendant les trente ans suivants. Si l'on compte les non-résidents, elle est au total de plus de 40%. Sept saisonniers et quatre frontaliers sur dix occupent un emploi dans l'agriculture ou dans l'industrie.
Genève présente ainsi cette particularité d'avoir une population résidente insuffisante à satisfaire les besoins du marché du travail; aussi offre-t-elle des emplois à environ 26-29.000 frontaliers (le chiffre diffère selon que la source est suisse ou française). En outre, 8.000 résidents du Canton de Vaud prennent quotidiennement le chemin de Genève.
[p. 180]
Le retour du chômage
Un spectre plane à nouveau sur la cité: celui du chômage. On l'avait oublié pendant les années dorées. Voici deux décennies, on crut l'avoir tenu à distance en sacrifiant quelque 18.500 travailleurs étrangers dont, entre 1974 et 1977, on ne renouvela pas les contrats; on prétendit aussi l'exorciser par un mode de calcul qui sous-estimait le mal; en creusant encore l'écart — pourtant bien réel — entre notre pays et nos voisins, on flatta indûment la vanité suisse de se sentir un Sonderfall. Mais voici qu'aujourd'hui, dans le pays, le seuil des 80.000 demandeurs d'emplois est franchi (2,5%: avril 1992). Le record suisse absolu pendant la Grande Crise (125.000 chômeurs dans l'automne 1935) ne semble plus imbattable. Genève fait partie, avec les autres cantons romands, de la région la plus touchée avec 4,8% de chômeurs, soit plus de 8.000 personnes (avril 1992). Le budget de l'Etat est déficitaire, le canton s'interroge. Que l'idée d'une Genève de 800.000 habitants en l'an 2000 paraît aujourd'hui lointaine et absurde!
Le travail, signification et valeur
Le travail, religion profane de l'avant-guerre
Genève la calviniste avait investi le travail d'une dimension religieuse; elle persécuta pendant longtemps le divertissement; ses démêlés avec les hommes du théâtre, cafetiers et autres cabaretiers sont historiques.
Genève, la ville d'industrie et des affaires, fit du travail une véritable religion laïque, à l'instar des sociétés industrielles. En trouvant sa juste place dans le marché de l'emploi, [p. 181] l'homme accomplissait sa destinée en contribuant à la grande oeuvre collective. Avec la séparation de l'habitat et du lieu de travail, il fallait que quelqu'un s'occupât du foyer et assurât l'intendance: telle était la mission de la femme.
Le respect sacré du travail, la satisfaction intime puisée dans le travail bien fait, voilà qui ressort à satiété aujourd'hui encore des propos d'anciens ouvriers qui préservent la mémoire de l'avant-guerre. "J'étais peintre en bâtiment. Je faisais les devis et tout. Mon patron disait: «Je vais vous envoyer un ouvrier qui travaille pour deux.» J'aimais mon travail." Un mécanicien: "Même malade, il fallait qu'on soit bien, bien malade pour ne pas aller au travail. On y allait, parce que le travail, il fallait le faire, moi je voulais finir ma pièce."
L'entre-deux guerres est une période turbulente et rude; si Genève n'est pas parmi les principaux centres de la grève nationale de 1918, les années trente y sont marquées d'émeutes et voient, lors de cette sinistre journée du 9 novembre 1932, la troupe tirer sur les manifestants.
Les revendications ouvrières, quelles que soient leur forme et leur vigueur, ne mettent pas en cause la valeur fondamentale du travail, "fonction la plus noble dans les sociétés modernes", mais s'en prennent à "l'exploitation de l'homme par l'homme" (Revue syndicale suisse, mars 1919). A la veille de la grande grève nationale, la plateforme syndicale affirme d'abord "le devoir de travailler pour tous", avant de revendiquer "la semaine de 48 heures" (Plateforme d'Olten, octobre 1917). Quelques années plus tard, la défense de cette dernière (conquise en 1919, puis menacée par un projet de loi proposant d'en revenir à la semaine de 54 heures), ne se fait pas en invoquant quelque droit au loisir, mais au nom du bon accomplissement des autres devoirs fondamentaux, familiaux et civiques, devoir aussi de s'efforcer d'améliorer sa condition. Il importe alors de réfuter l'accusation ignominieuse d'oisiveté (mère de tous les vices, comme chacun sait); l'enjeu est de savoir qui incarne le vertueux travailleur et qui, le vil paresseux?
Enfin l'abondance !
Dès les années cinquante, comme la plus grande partie de l'Europe occidentale, Genève est frappée par le maelstrom de la croissance économique. La société industrielle produit enfin les lendemains qui chantent qu'elle promettait depuis plus d'un siècle, mais que personne n'attendait plus vraiment et surtout, pas si vite au sortir de la guerre. Ce sont les Années dorées: enfin l'abondance, le bien-être...
De 1950 à 1975, les salaires et le pouvoir d'achat des ménages doublent pour le moins. Mais l'environnement quotidien se métamorphose; il se meuble chaque jour de nouveaux produits et l'appel à la consommation devient lancinant. Le plastique, l'électroménager, puis le fast food transforment les usages domestiques, téléviseurs et automobiles restructurent habitudes et rythmes quotidiens, les moyens anticonceptionnels autorisent une révolution de la sexualité et font du couple le Pygmalion de la famille. Les vacances, inconnues jusque-là sauf des privilégiés, scandent l'année et deviennent vite un besoin physiologique: qui n'est aujourd'hui épuisé et au bord de la dépression dès le début de juin? Mais qui se souvient que les premières "vacances" populaires furent, dans les années 30, le week-end de Pâques prolongé jusqu'au lundi soir? Que la première loi sur les vacances — deux semaines pour tous les salariés — fut votée à Genève en 1947, à Berne sur le plan fédéral dix-sept ans plus tard?
Mythe de l'épanouissement et droit au loisir
Au cours de ces années émerge une nouvelle vision de la vie et du monde, centrée sur l'individu, son droit à l'épanouissement et au bonheur. L'individu n'est plus au service de la société, mais la société est à son service, une société mise en demeure, au travers de l'Etat, de tout faire pour favoriser l'épanouissement individuel de chacun. Cette révolution copernicienne des moeurs s'inscrit jusque dans des textes de lois. Jusqu'en 1977, la loi de la République et Canton de Genève donnait à l'instruction les buts suivants:
a) De préparer la jeunesse à exercer une activité utile et à servir le pays
b) De développer chez elle l'amour de la patrie et le respect de ses institutions
Cet article, qui date de 1941, a été révisé de fond en comble et voici un extrait du texte adopté par le Grand Conseil en 1977:
"L'enseignement public a pour but, dans le respect de la personnalité de chacun:
a) De donner à chaque élève ...
b) D'aider chaque élève à développer de manière équilibrée sa personnalité, sa créativité ainsi que ses aptitudes intellectuelles, physiques et artistiques. (...)»
(On trouvera le texte complet de ces deux articles dans le tome VI de cette Encyclopédie, p. 37).
L'ancienne loi s'inscrit dans un contexte de guerre, mais son esprit reste fidèle à celui des grandes chartes de l'instruction publique de la première moitié du XXe siècle. [p. 183]
L'ancienne loi considère "la jeunesse"; la nouvelle différencie "chaque élève". La première donne comme objectif à l'instruction, le service de la patrie et de ses institutions; le nouveau texte, qui contient deux fois et demi plus de mots, ne parle ni de l'une, ni des autres; l'élève individuel est érigé en fin ultime, avec l'épanouissement de sa personnalité.
Dans le contexte des années soixante, on brûle ce qu'on adorait hier; le travail, jeté au bas de son piédestal, est dénoncé comme le lieu de l'aliénation; le temps libre et le loisir sont proclamés être les sources privilégiées du bonheur.
"Moins de temps de travail, c'est s'approprier un peu mieux sa vie quotidienne, réfléchir au sens du travail et de la vie, c'est prendre plus de temps pour vivre réellement. (...) [C'est] pour les travailleuses (...) pour leur loisir et leur bon vouloir, sans que ce temps libre soit dépensé aux tâches du ménages."
(Extrait de: Comité pour la réduction du temps de travail, brochure n° 3, Genève, 1976).
Le patronat s'inquiète et dénonce le déploiement d'une "éthique anti-travail" (Journal des Associations patronales, mars 1973); douze ans plus tard, un éditorialiste du même journal évoque, avec une grande émotion, un souvenir d'enfance: "Je lus sur sa tombe une inscription que je n'ai jamais oubliée: «le travail fut sa vie!»" et conclut en appelant à réagir contre la décadence du temps présent (même journal, décembre 1985).
Travail et projet de vie
Il est certain que le loisir, conçu comme du temps à discrétion, que chacun meuble selon son bon vouloir, est maintenant considéré comme un droit. Est-ce à dire que le travail, lieu de l'accomplissement de la vocation humaine hier, serait celui de l'aliénation de soi aujourd'hui? Ne serait-il qu'une fatalité nécessaire, l'incontournable moyen de s'assurer un revenu? Cette conception (version sécularisée de la malédiction du travail qui s'exprime dans le livre de la Genèse, chap. 3) s'est manifestée dans la mouvance idéologique des années soixante-huit; mais exprimait-elle alors, exprime-t-elle aujourd'hui une opinion majoritaire? Peut-on penser, au contraire, que la transformation du paysage économique depuis les chocs pétroliers, avec la contraction du marché de l'emploi et la recrudescence du chômage, conduit à ressusciter l'ancienne et héroïque morale du travail?
A la lumière des travaux et données disponibles, ces deux explications sont à écarter. Les tenants de l'ethos du travail constituent une minorité de survivants; ceux qui au contraire [p. 184] vivent leur emploi comme source permanente d'aliénation expriment un sentiment bien réel, mais également minoritaire.
Une enquête récente sur le thème de la culture et des loisirs, réalisée sous la direction de l'Office fédéral de statistique, apporte d'intéressantes informations à ce sujet.
La personne interrogée doit choisir, parmi quatorze possibilités, les deux situations dans lesquelles elle se sent le plus "épanouie, elle-même". Quelle est la réponse de la population genevoise active? Quatre hommes sur dix retiennent l'emploi comme un de leurs deux choix. Pas loin de la moitié: c'est un véritable plébiscite qui fait de l'emploi le principal support de l'épanouissement! Puis un Genevois sur trois choisit les activités familiales d'un côté, les sports et la nature de l'autre; un sur quatre les voyages, les amis, les hobbys et... le repos.
Parmi les Genevoises, quatre situations viennent en tête et recueillent un fort tiers des suffrages; ici encore figure l'emploi! A ses côtés, la famille, les amis, les sports et la nature. Les voyages et... le repos sont prisés par un bon quart des femmes. Chose curieuse, alors que le travail est plus souvent cité à Genève (et en Suisse romande) qu'en Suisse alémanique, le repos est mentionné par 24 pour cent des actifs à Genève, mais par 38 pour cent d'entre eux en Suisse alémanique. Que valent donc nos stéréotypes helvétiques!
Le travail est donc investi d'un très fort pouvoir d'épanouissement. Cependant, ce pouvoir n'est pas également réparti dans tous les postes de travail: dans les emplois subalternes, trois personnes sur dix citent leur travail comme source d'épanouissement (proportion qui, malgré tout, reste très forte); parmi ceux qui occupent les positions supérieures, ils sont sept hommes et six femmes sur dix à le faire. Cette inégale répartition des vertus de l'emploi met en lumière la différence entre l'ancienne valeur du travail et l'actuelle. Le sentiment de réalisation de soi découlait du seul fait de bien accomplir son travail, cela quelle que fût la nature de la tâche. Le sentiment d'épanouissement dépend aujourd'hui de ce que l'emploi apporte à celui qui l'exerce.
Par ailleurs, la valeur dont se trouve investi le travail ne met pas en cause l'importance du temps libre. Le tableau ci-dessus montre que la moitié des personnes estiment bénéficier d'une distribution du temps satisfaisante entre le travail et les autres activités de la vie; personne en revanche (pardon: 1%) ne demande à travailler plus! L'autre moitié aspire à plus de temps libre, un peu plus même quand on monte dans la hiérarchie professionnelle. Parmi eux, se trouvent [p. 184] ceux qui exercent un métier qui les passionne, mais envahit leur vie privée. Ceux-là expriment sans doute plus un voeu pieux ou un regret qu'une revendication: ils souhaitent avoir plus de temps libre, mais pas travailler moins!
Qu'en est-il aujourd'hui des vertus du ménage? Un large consensus se manifeste parmi les femmes de Genève, âgées ou jeunes, qu'elles exercent un emploi ou non: le ménage, c'est clair, n'est pas une occasion d'épanouissement.
Ainsi, pour la Genevoise, la volonté de s'insérer dans l'activité économique et d'assumer une carrière professionnelle est associée au rejet radical de l'image traditionnelle qui parque la femme au foyer et qui lui offre le ménage pour vocation. L'emploi symbolise son émancipation; en la dotant d'un revenu propre, il garantit son autonomie au sein du couple et lui apporte une assurance devant les aléas d'un itinéraire conjugal bien incertain par les temps qui courent. Puisque l'emploi reste, quoi qu'on en dise, le premier donneur d'identité sociale, il dote la femme d'un statut propre. Enfin, de nos jours, l'homme a bien du mal à assurer seul, à sa famille, un revenu qui satisfasse aux exigences du style de vie contemporain, avec sa boulimie de consommation; dans bien des cas, le salaire de l'épouse n'est pas un appoint, mais la contribution nécessaire au train de vie familial.
Une chose paraît certaine: tant s'en faut pour que le travail retrouve un jour sa place au coeur de la morale sociale! Les Années dorées ont provoqué une révolution des mentalités telle qu'il faudrait un véritable cataclysme pour l'ébranler. La croissance économique est devenue incertaine, le pouvoir [p. 186] d'achat stagne, il n'est pas impossible qu'il s'affaiblisse quelque peu dans les années à venir. Mais les protestations publiques des fonctionnaires genevois, pendant l'hiver 1991-92, ne doivent pas cacher que l'abondance demeure, et que l'essentiel des acquis des quatre dernières décennies est préservé. Ce qui paraît irréversible aujourd'hui, c'est la perception de l'individu et de son épanouissement comme aune et fin de toute chose, c'est la volonté de bonheur! C'est aussi le refus de toute morale du sacrifice et du devoir au profit de quelque abstraction idéalisée: la patrie, le salut, les lendemains qui chantent. Dans le projet de vie moderne, le travail peut avoir une place centrale mais, pour la grande majorité, il ne saurait être toute la vie. La sphère privée — la famille, les amis, les loisirs — a gagné en importance jusqu'à devenir, pour beaucoup, les vrais lieux de la quête d'épanouissement. L'emploi peut "faire sens", comme on dit aujourd'hui, mais la signification qui lui sera associée ne découle plus aujourd'hui de quelque mission sociale, comme on le proclamait avant guerre. Sa signification est aujourd'hui associée au mythe moderne de l'épanouissement personnel; la valeur utilitaire de l'emploi consiste à assurer un revenu; sa valeur profonde, existentielle, se mesure au potentiel de réalisation personnelle qu'il offre à celui qui l'exerce.
Comme le dogme de la femme au foyer, l'ancienne morale du travail a vécu. Elle procurait un sentiment profond du devoir accompli à quiconque exécutait avec conviction le geste professionnel, qu'il fût au charbon ou au poste de commandement. Elle avait cette grandeur de donner sens et noblesse aux tâches les plus ingrates et les plus pénibles en les déclarant socialement utiles. La religion du travail a été sapée par la révolution culturelle en cours. Mais cette dernière n'a pas conduit au bradage symbolique du travail; elle a certes détruit un mythe, celui de l'homme qui s'accomplit dans son travail en assumant son destin social; dans le même mouvement, elle en a produit un autre: celui de l'homme destiné au bonheur, s'il parvient à trouver le chemin du nouveau paradis. Pour certains, qui sont majoritaires parmi les catégories professionnelles supérieures, mais qui restent nombreux dans tous les milieux, cette voie initiatique s'appelle le travail. A lui seul cependant, ce dernier ne suffit pas à la quête de l'Eden des temps actuels; d'autres chemins, qui parcourent les territoires de la vie privée et des loisirs, s'offrent également pour chercher à y pénétrer.
C. L. E. et J.-Ch. R.
haut
[p. 187]
Le manger et le boire
Manger pour vivre ou vivre pour manger?
Dès le moment où des sources écrites ou figurées explicites nous font connaître les tenants et les aboutissants de la nourriture, on voit se dégager deux aspects du manger et du boire. D'une part, on mange pour se nourrir, on boit pour étancher sa soif, c'est-à-dire on absorbe une certaine quantité de substances essentielles: eau, lipides, glucides, protéines, oligo-éléments, "ballast", indispensables à l'existence; d'autre part, on entoure cet acte d'un certain nombre de pratiques, voire de cérémonies, qui l'agrémentent et lui donnent une portée sociale.
Ainsi, de la simple subsistance, on passe à l'art, à la gastronomie, qui stimule le plaisir des sens: non seulement le goût et l'odorat, mais la vue — vaisselle, cristaux, arrangements floraux, couleur et présentation des mets — le toucher et l'ouïe — puisque le contenu et la forme de la conversation, la musique pour les soupers du Roy font partie des plaisirs qui accompagnent le repas. Enfin, un repas réussi doit aussi satisfaire l'âme: on doit sentir l'amour dans la qualité de la préparation comme du service, où la politesse des gestes doit refléter la politesse du coeur. Au reste, la gastronomie, ce n'est pas seulement l'art de préparer et de présenter les aliments — en fait, c'est plutôt la cuisine —, mais plutôt l'art d'en bien parler.
Les encyclopédistes du XVIIIe siècle ont déjà bien vu ce double problème, avant même la floraison de la gastronomie française à l'époque de l'Empire, puisqu'ils ont associé, dans leurs intérêts, l'art culinaire, ses gestes, son travail technique, au souci philanthropique de régler le problème de la faim. Ainsi, dans un volume sur l'art de vivre, on doit s'attacher plutôt à l'art culinaire, mais la pensée historique doit aussi se préoccuper des moyens de réaliser l'art, c'est-à-dire, en l'occurrence, des accès à la nourriture, aux denrées alimentaires et à leur assaisonnement. Et admettre que pour ceux qui ont faim, la subsistance passe avant la jouissance.
La question de la subsistance touche de près aux moeurs: qu'en est-il du gaspillage de nourriture, au restaurant dans le service sur assiette, dans les supermarchés où les produits qui ont dépassé, même de peu, la date-limite de vente, sont impitoyablement éliminés sans profit pour personne, en société avec le tabou qui interdit de "saucer" les restes au fond de l'assiette? Affaire de niveau économique et social: au début de notre siècle, la crèche de Plainpalais était célèbre pour inviter les enfants à lécher le fond de leur assiette... On devrait encore parler du rôle central des femmes dans l'alimentation: si les hommes brillent dans le rôle de maître-queux [p. 188: image / p. 189] dans les hôtels prestigieux, les femmes, traditionnellement, règnent sur la cuisine et la table familiales et, jour après jour, assurent la subsistance du ménage et la transmission du savoir culinaire.
On laissera, ici, de côté la question du ravitaillement de la ville, problème essentiellement démographique, économique et politique qui a été abondamment traité par les historiens tels qu'Antony Babel et Anne-Marie Piuz, pour s'attacher à la nourriture comme art, jouissance, fait social.
Les sources
Avant d'évoquer les sources d'eau vive où l'on s'abreuve et la provenance des victuailles, il convient d'énumérer les moyens d'information et les sources de nos connaissances.
Depuis que l'archéologie étudie les pollens fossiles, on peut connaître non seulement la nourriture carnée des hommes de la préhistoire, qui laisse des traces sous forme d'ossements, mais encore les céréales et les autres végétaux qu'ils consommaient. Des époques celtique et romaine, les vases, amphores et leurs peintures, les quelques rares livres de cuisine connus (Apicius notamment) nous livrent des renseigne-ments plus abondants, mais pas forcément plus précis. Le Moyen Age genevois est relativement bien connu par les documents écrits dès le XIIIe siècle: la composition des redevances en nature, les règlements sur la pêche, la vente des poissons, des viandes et des autres denrées alimentaires, les arrêts fixant le prix du vin, du blé, de la viande, les tarifs des halles pour les produits d'importation, les actes notariés de grangeage et de vignolage avec les énumérations de cultures, de bêtes d'élevage et de redevances en nature, fournissent un tableau complet. Il existe même un livre de recettes de Maître Chiquart, qui fut chef de cuisine du duc de Savoie Amédée VIII, pape sous le nom de Félix V, puis évêque de Genève.
A l'inverse, les prescriptions de l'Eglise sur le jeûne, le carême informent sur ce qui est considéré comme "gras", donc interdit à certaines époques de l'année, mais aussi sur ce qui est convoité. Quant aux textes des règles monastiques, à leurs interprétations et aux discussions parfois vives auxquelles leur application donne lieu, ils sont riches d'enseignements sur les rations et les possibilités de s'alimenter au "désert" ou dans la ville.
A partir de la Réforme, les sources, surtout celles d'archives, coulent en abondance. Aux documents déjà mentionnés s'ajoutent les comptes de l'Hôpital général, qui nous informent sur les rations accordées aux pauvres, leur composition, [p. 190] leurs quantités et leurs coûts, les pièces comptables de la République, avec leurs factures de traiteurs pour les banquets offerts par le gouvernement, et d'innombrables inventaires après décès qui décrivent vaisselle, batterie de cuisine, provisions de ménage et contenu des caves. Nous sommes aussi remarquablement renseignés sur les famines, les périodes d'abondance, les fluctuations de l'approvisionnement, par les archives de la Chambre des Blés, une des commissions permanentes des Conseils gouvernant la République, chargée de veiller précisément à la régularité de l'approvisionnement de base des Genevois. Les livres de cuisine imprimés ne commencent guère à Genève qu'au XIXe siècle, mais on utilise ceux de France et on collectionne les recettes manuscrites.
Pour les périodes récentes, la bibliographie gigantesque des livres de cuisine et de gastronomie, décorés de photographies alléchantes, les mercuriales, les statistiques de la consommation en Suisse, les analyses du "panier de la ménagère", les guides touristiques et gastronomiques, les chroniques culinaires dans les quotidiens et les pages de recettes dans les journaux féminins, la publicité des restaurants enfin, noient le curieux dans une masse d'informations difficile à maîtriser.
[p. 191]
Evolution de la problématique
A partir du XIXe siècle, l'abondance et la variété des sources comme des denrées alimentaires elles-mêmes posent le problème dans des termes différents, beaucoup plus complexes: du moment qu'on a le choix, à cause de la facilité des transports des primeurs et des produits exotiques, que le développement de la conserverie met à disposition des produits divers en toutes saisons, on ne peut plus composer un tableau uniforme et cohérent de l'alimentation des Genevois. Les possibilités sont si nombreuses, que les modes alimentaires en deviennent très diffuses. Les disettes disparaissent progressivement: dès lors, on ne mange plus pour vivre, mais on vit pour manger. Les repas ne sont plus seulement lieu d'alimentation, mais aussi de gourmandise et de sociabilité.
L'uniformisation des genres de vie a aussi sévi sur la table: les multinationales de l'agro-alimentaire, les producteurs de fast-food, ont concouru à niveler les particularités de la "cuisine genevoise". La présence à Genève d'une importante communauté internationale a multiplié les restaurants exotiques; les magasins à grande surface se sont remplis de produits étrangers. Ainsi, le répertoire des cuisinières est renouvelé et enrichi, mais ne se distingue plus guère de la cuisine internationale la plus classique — ou la plus banale.
Avec l'avènement de la diététique et la médicalisation de la société, l'homme apprend à se regarder le nombril. Il analyse son comportement et l'acte de manger. Psychologues "comportementalistes" et médecins se penchent sur les boulimiques et les anorexiques, diététiciens et chimistes calculent les nombres de calories, les quantités de glucides, de protides, de lipides et d'oligo-éléments contenues dans les diverses substances, sous l'oeil sourcilleux de l'Office fédéral du contrôle des denrées et de l'industrie agro-alimentaire qui fera "passer la pilule" grâce à une publicité habile et en retirera les bénéfices. Et finalement le consommateur croit faire son choix, alors qu'il est manipulé par le terrorisme médical.
Que mangeaient nos pères?
On sait depuis longtemps que le blé et les céréales parentes, telles que seigle et épeautre, constituent la base de l'alimentation en Europe occidentale. Genève ne fait pas exception. On y était amateur de pain blanc, même à la campagne au Moyen Age. En effet, en 1343, lorsque les paysans de Troinex reconnaissent devoir certains travaux ou "corvées" annuelles à leur seigneur, le prieur et les moines de Saint-Victor, [p. 192] ils prétendent avoir le droit d'être nourris durant ces jours, et bien nourris: de "bon pain blanc et de vin clair". Si les "vilains" de la campagne étaient si bien lotis, on peut se douter que les gens de la ville, bénéficiant des possibilités diverses offertes par les foires, pouvaient formuler des exigences bien supérieures de variété et de qualité.
En 1375, l'évêque Guillaume de Marcossey établit un impôt sur les denrées et marchandises vendues dans Genève et ses faubourgs, pour subvenir aux frais des fortifications. Ce règlement énumère les légumineuses (fèves, pois, lentilles), les céréales (froment, avoine, seigle, orge, millet, panic), les épices et autres assaisonnements (sel, poivre, gingembre, "grains de paradis", soit une sorte de poivre, girofle, safran, cannelle, cumin), les fruits (amandes, figues, raisins), les animaux de boucherie (boeuf, vache, veau, poulet, porc, porcelet, mouton, agneau), le poisson salé (anguilles). Un tarif des péages de 1515 mentionne de l'huile, de l'huile d'olive, de la moutarde, du suif, du miel, du safran.
Au marché aux poissons frais, on vend le poisson du lac, perches, truites, etc., et le milcanton, c'est-à-dire les tout petits poissons, dont les Genevois sont friands et dont il faudra plus tard interdire la pêche qui dépeuple le lac. Un ou deux siècles plus tard, en 1581, le syndic Jean Du Villard dessine une carte du Léman, en marge de laquelle il reproduit les principales espèces de poissons du Léman, les coquillages et les crustacés, avec des indications sur leur goût, leur délicatesse, la meilleure saison pour les pêcher et les consommer (voir le tome I de cette Encyclopédie, page 142).
Un autre règlement, créant l'office de cribleur en 1441, mentionne des denrées telles que le sucre candi, le gingembre, les noix de muscade, la cannelle, etc. Sans doute, ces produits exotiques, vendus aux foires, n'étaient-ils que de passage, mais il en restait certainement pour assaisonner la table des Genevois les plus riches.
Dès l'apparition des documents médiévaux, donc, on voit que Genève a dépassé le stade de la simple subsistance. On fait de la cuisine, on assaisonne les plats, c'est de l'"art de vivre".
Les lois somptuaires
Cet art de vivre est même si raffiné que les lois somptuaires de Calvin interviennent pour lui imposer des limites. Un des premiers textes connus, datant de 1558, interdit de faire plus de trois "venues", soit services, dans les banquets et chaque service ne peut comporter plus de quatre plats. [p. 193] Mieux encore, une "crie", soit une proclamation, datant du 28 juillet 1564, réintroduit une sorte de jeûne, en interdisant de banqueter le mercredi, jour consacré à la prière.
En 1581, les dispositions concernant les banquets sont développées et précisées: il est interdit de faire plus d'une "venue" de viande ou de poisson, comportant plus de cinq plats; à quoi s'ajoutent les "menues entrées" et huit plats au maximum pour les desserts; les desserts ne peuvent comporter qu'une pâtisserie ou "pièce de four". Les "confitures sèches", soit les pâtes de fruits et autres articles de confiserie, sont interdites, à l'exception des dragées. Les banquets pour les fiançailles ou les baptêmes sont interdits. Le nombre de convives varie selon la condition sociale de l'invitant. Les petites gens ne peuvent avoir plus d'une tablée de dix personnes, les plus riches plus de trois tablées, et il est interdit de banqueter plusieurs jours consécutifs. Ces limitations visent manifestement à empêcher les pauvres de gaspiller leur argent et de ruiner leur famille en superfluités, puisque l'article suivant interdit aux petites gens et aux artisans de servir aux banquets des "dindes, perdrix, venaison, gibier et patisserie". Enfin, pour éviter que l'on tourne ces interdictions, le Conseil interdit aux taverniers et cabaretiers de donner à manger et à boire aux citoyens, bourgeois et habitants demeurant dans la ville.
Plus tard, au XVIIe siècle, ce sont les festins officiels, organisés pour les élections de Messieurs de la Justice et pour les élections des syndics, qui seront réglementés, les dépenses réparties entre l'Etat et les élus, et strictement limitées. Cela, évidemment, pour des raisons économiques et budgétaires autant que de décence.
Mais entretemps, le développement du commerce au loin, avec l'Amérique ou avec l'Asie, a fait apparaître des produits nouveaux. Un tarif des halles de 1604 énumère, outre les produits déjà cités dans les textes du Moyen Age, des dattes, amandes, figues, raisins de Damas, "ajubis", pruneaux, riz et oranges, le girofle, la cassonade, les olives, câpres et anchois. En 1621, apparaissent encore les "passules" (raisins de Corinthe), les pignons, les brignoles, les citrons, le "fust" (pistaches).
Boulangerie, pâtisserie, confiserie
Avec toute cette variété de mets, la nourriture de base reste le pain. Aussi les règlements sur le prix et la qualité du pain et des farines ne manquent-ils pas; ils s'ajoutent à tous les documents administratifs émanant de la Chambre des Blés, [p. 194] commission permanente des Conseils chargée d'approvisionner la ville de cette denrée essentielle. Son activité est si importante qu'elle se transforme peu à peu en une sorte de banque, une véritable puissance financière et politique à l'intérieur de la République.
Jusqu'au XVIlle siècle, les trois quarts du pain consommé à Genève sont fabriqués à la maison et cuits chez le fournier. Seuls un quart des consommateurs achètent leur pain chez les boulangers. C'est seulement au XIXe siècle que les gens cessent peu à peu de pétrir eux-mêmes. C'est un pain de pur froment — auquel on assimile l'épeautre. En cas de disette, on recourt au méteil, mélange de froment et de seigle. Il existe plusieurs variétés, du blanc plus ou moins blanc au bis.
Les boulangers font du pain, tandis que les pâtissiers fabriquent, étymologiquement, des pâtés. On connaît aussi diverses sortes de gâteaux, surtout lorsqu'on interdit leur confection dans les périodes de disette: craquelins, "chaudelets", feuilletés, biscuits, torches, "cassemuseaux" (cuits au four), beignets frits à l'huile, gaufres, brioches. D'autres "douceurs" sont plutôt le fait des confiseurs, qui fournissent dragées, "confitures sèches", cotignac, selon des normes fixées, dès le XVIIe siècle, dans des règlements sur le contrôle des denrées.
Viande, bétail, laitages
Les premiers règlements sur la boucherie, qui remontent à 1403 et 1406, manifestent déjà un souci d'hygiène, puisqu'ils interdisent de mettre sur le marché, sur les bancs des bouchers, les viandes de mouton, de chèvre ou de porc "infectes". Les bouchers doivent dire clairement et sincèrement aux acheteurs quelles sortes de viandes ils vendent. Ils n'ont pas le droit d'imposer aux acheteurs de gros quartiers de viandes — qui ne se garderaient pas longtemps —, mais doivent découper des pièces aux dimensions et au poids qui leur sont demandés.
La commission de la boucherie établit périodiquement la liste des prix de la viande selon la qualité: boeuf — ou vache — bien gras, boeuf moins gras mais bon, boeuf maigre, mais recevable; veau ou mouton de deux qualités, le meilleur et le moins bon. Les viandes sont bouillies ou rôties, apprêtées en daubes, à l'étuvée ou en ragoût. Le porc est mangé sous forme de jambon ou de saucisses. On conserve la viande salée ou séchée, surtout à la campagne.
Le gibier et la volaille figurent aussi sur la table des riches. Ainsi les factures des traiteurs qui fournissent des banquets pour les réceptions du gouvernement mentionnent canards, [p. 195] sarcelles, bécasses, perdrix, levrauts, chapons, poulardes, pigeons, etc. La dinde est moins fréquente. Aujourd'hui, elle est à la base du menu traditionnel d'Escalade, mais c'est depuis une époque récente.
Les produits laitiers font partie de l'alimentation quotidienne des petites gens: en 1607, l'Hôpital général possède douze vaches pour entretenir les pauvres. Mais le lait, de conservation et de transport difficiles, est sans doute consommé en plus grande abondance à la campagne qu'en ville.
Le beurre, conservé fondu, plus rarement salé, dans des toupines, figure dans les inventaires après décès, au chapitre des provisions. Très peu utilisé au Moyen Age, où l'on emploie plutôt le lard et le saindoux, il sert sous l'Ancien Régime à la cuisson de la viande et des légumes, dès le XVIIe siècle à la préparation de la majorité des sauces, et aussi, avec les oeufs, à la confection des pâtisseries et gâteaux. Le séré et la tomme accompagnent presque à coup sûr la soupe et le pain des repas populaires, et apportent des protéines qui complètent les légumineuses telles que fèves, pois et gesses, dont la consommation est attestée depuis le Moyen Age. A l'Hôpital, observe Anne-Marie Piuz, le fromage constitue la base de l'alimentation du vendredi, lointain souvenir du jeûne d'avant la Réforme. Mais les fromages à pâte dure, du type gruyère, sont importés et appartiennent plutôt à la table des personnes aisées ... jusqu'à ce que l'immigration des bergers fribourgeois et alémaniques au XIXe siècle introduise la fabrication de ces fromages dans les fruitières du canton, puis aux Laiteries réunies qui en sont les héritières.
Les légumes et les fruits
Le terme de "viande", autrefois, ne désignait pas uniquement les matières carnées, mais tous les aliments, en particulier les légumes. Avant que le canton de Genève ne devienne un dangereux concurrent du Plateau suisse pour certaines cultures telles que la tomate, le concombre, l'endive, l'accent était mis dans les jardins sur les pois, les lentilles, les fèves, les haricots, les choux et les raves, les poireaux et les épinards, base de la soupe quotidienne. D'autres légumes que la tradition attribue à l'apport des réfugiés français pour cause de religion, variaient le menu, tels que cardons et artichauts, les salades, les endives et les asperges (voir aussi le tome II de cette Encyclopédie, p. 131-134).
Les fruits du pays agrémentent le menu, même pour les pauvres de l'Hôpital, quand ils sont à bon marché, donc en saison: pommes et poires, fraîches, séchées ou cuites, en [p. 196] confiture ou en compote, cerises, griottes, pêches et prunes, fraises et framboises sont attestées par les documents de l'Ancien Régime, de même que le raisin de table. Les oranges, venues d'Espagne, sont évidemment, jusqu'au XVIIIe siècle, un fruit réservé aux grandes occasions, festins exceptionnels ou étrennes de Nouvel An, dans la mesure où les lois somptuaires le permettent.
L'alimentation aujourd'hui
En Suisse, comme dans toute l'Europe occidentale, l'analyse du panier de la ménagère effectuée par les services de statistique fait apparaître les effets de l'élévation constante du niveau de vie. Tandis que la part de l'alimentation dans le budget diminue au profit des loisirs et des assurances, la qualité des mets achetés et consommés s'améliore, notamment au point de vue des protéines et des vitamines. La consommation du lait, du café, de la crème, du yogourt et autres produits laitiers, de la viande, des huiles, graisses et margarine, des fruits, du sucre, du miel, de la confiture et même du chocolat tend à diminuer, ce qui, au moins pour les graisses et le sucre, laisse supposer un accroissement des connaissances et une mise en pratique des théories diététiques.
Dans le "budget temps" aussi, la préparation et la consommation de la nourriture occupent une place moins importante qu'il y a cinquante ans. L'analyse du panier de la ménagère fait apparaître une nette croissance des dépenses pour les aliments précuisinés et pour les repas et boissons pris hors du domicile.
Dans les années 1930, un menu de réveillon proposé par le professeur de cuisine genevois Albert Foucon demandait près de dix heures de travail. Aujourd'hui, pour le même menu, une ménagère bien organisée se tire d'affaire en deux ou trois heures. On mesure donc le chemin parcouru. Certes, les grands cuisiniers proposent toujours dans les journaux féminins des recettes compliquées qui nécessitent beaucoup de temps et d'amour ou de nombreux marmitons. Mais leur réalisation exigerait encore plus de temps sans les appareils électroménagers, fouets, mixers, râpes électriques, etc., qui se sont multipliés. Une possibilité supplémentaire est offerte par les repas tout préparés, présentés dans des barquettes d'aluminium, emballés sous vide ou congelés, qu'il suffit de réchauffer au bain-marie ou au four à micro-onde. Même les restaurants de la ville recourent désormais systématiquement à cette manière commode de varier leurs menus sans engager du personnel bien formé, donc coûteux. [p. 197]
Le rythme de la vie a quelque peu bouleversé l'ordonnance et la composition des repas. Le déjeuner de soupe, de pain et de fromage, qui tient au ventre pour une partie de la journée occupée par de durs travaux agricoles, a fait place à une collation rapidement avalée, au mieux une tartine et une tasse de café, relayée vers neuf heures et demie par un café et un croissant. Un mouvement, inspiré par la diététique et peut-être influencé par la mode anglo-saxonne, tente de restituer à ce premier repas une place plus importante, en promouvant les céréales sous diverses formes, les œufs, la viande, le fromage, les fruits, le "birchermuesli" et d'autres produits. Mais la hâte du matin, la nécessité de se rendre à l'école ou au travail à une certaine distance, rendent ces efforts vains.
Le repas de midi souffre également de cette accélération du rythme de vie. La distance entre le lieu de travail et le domicile incite une population toujours plus nombreuse à prendre le premier repas sérieux de la journée, appelé désormais le déjeuner, sur le pouce en continuant son travail, au restaurant, à la cantine d'école ou d'entreprise ou sur un banc au jardin public. C'est la période glorieuse du fast food, la nourriture rapide faite de hamburgers, de frites, de "ketchup", vite avalés, réputés lourds et malsains. Là aussi, parents et diététiciens se désolent du succès irrésistible de ce type de nourriture auprès des adolescents en pleine croissance.
Il résulte de cette évolution que le repas du soir, autrefois appelé "souper" parce qu'il était constitué d'un simple bol de soupe, est devenu le "dîner" et représente le repas le [p. 198] plus important, le plus élaboré de la journée. Tandis que les "déjeuners d'affaires", même consommés dans des restaurants à cinq étoiles, ne comportent généralement que trois plats en comptant le dessert et ne sauraient durer plus d'une heure et demie à deux heures, le dîner est l'occasion de menus gastronomiques coûteux, qui occupent la soirée jusqu'à vingt-deux ou vingt-trois heures... et procurent des nuits difficiles et peuplées de cauchemars aux gourmets dotés d'un estomac délicat.
Genève, sur ce point, ne diffère pas des autres villes d'Europe occidentale. Son alimentation quotidienne est totalement uniformisée avec celle du continent. S'il existe encore des menus "genevois", c'est à titre de curiosité folklorique, semblable à la cuisine chinoise, japonaise ou grecque que l'on peut trouver dans les Rues Basses. Une bonne campagne publicitaire permettrait même de diffuser, à l'instar d'autres spécialités telles que le coq au vin de Bourgogne ou le riz exotique, la truite en sauce genevoise ou la longeole dans des barquettes toutes préparées, à réchauffer chez soi.
Toutefois, cette uniformisation ne va pas jusqu'à généraliser les produits de synthèse, tels que les fameux aliments de survie, imaginés et produits entre 1981 et 1984, après quinze ans d'études et de recherches, par un important groupe de l'agro-alimentaire helvétique à la demande de la Protection civile. Les gourmands frémissaient d'avance à l'idée d'ingérer ces poudres, l'une salée, l'autre sucrée et vaguement chocolatée pour le petit déjeuner, contenant certes tous les éléments nécessaires à la survie, mais peu propres à mettre en appétit les assiégés potentiels. Pourtant l'Office fédéral de la protection civile avait édité une brochure contenant diverses recettes destinées à varier les menus prenant ce produit pour base: goulache ou rôti hâché pour la préparation salée, cake au chocolat ou aux noisettes pour l'aliment sucré.
Dix ans plus tard, de nouvelles directives fédérales dispensent la Protection civile de préparer des rations pour l'ensemble de la population, et les stocks encore propres à la consommation sont transformés en nourriture pour boeufs et porcs.
Hygiène, diététique et régimes, ou la nourriture médicalisée
Le régime malsain de toute une génération contraste avec l'accroissement des connaissances diététiques et médicales sur la composition des aliments, les nécessités et les faiblesses [p. 199] de l'organisme. L'abondance et la variété des mets, leur accès facile leurrent les consommateurs et obligent les spécialistes à jeter des cris d'alarme, à organiser des symposiums et à publier des manuels sur l'alimentation des nourrissons, des jeunes, des personnes âgées. Est-ce la promotion de la femme ou le mépris des tâches du foyer? On trouve même dans les journaux des conseils d'hygiène culinaire qui figureraient normalement dans le programme élémentaire d'une école ménagère ou que les mères enseignaient autrefois à leurs filles dès le plus jeune âge.
La diététique et la médecine doivent s'adapter à des impératifs qu'elles semblent avoir dictés et qui pourtant les débordent: la terreur des maladies cardio-vasculaires et du cancer, la hantise du cholestérol, et l'idéal de la minceur, qui n'est son complément qu'en apparence — c'est plutôt un effet de la mode depuis la Première Guerre mondiale. On découvre ainsi les effets pervers de l'abondance. Mise à part la disparité choquante entre les sociétés occidentales gavées jusqu'à l'indigestion et le Tiers-Monde sous-alimenté, les excès de nourriture qui sont les nôtres génèrent toutes sortes de maladies dites de civilisation. Les boulimiques mangent avec excès pour compenser des difficultés psychiques, puis vomissent ce qu'ils ont ingéré pour rester minces. Les anorexiques à la recherche d'un idéal filiforme se privent du strict nécessaire. Les uns et les autres finissent leur carrière lamentable chez le psychiatre ou à la division de médecine psychosomatique et psychosociale des Institutions universitaires de psychiatrie de Genève.
Sans aller jusqu'à ces extrémités dramatiques, la vogue des régimes amaigrissants est grande à Genève, sans que l'on puisse dire si la proportion des personnes qui s'y adonnent est plus importante ici qu'ailleurs. On relèvera seulement la présence, depuis 1975, du mouvement très efficace des "Weight Watchers", créé aux U.S.A., qui agit sur les personnes désireuses de maigrir par un soutien psychologique et des conseils diététiques. Les "Weight Watchers" diffusent en outre des produits "light" tels que yaourts ou menus tout préparés à basses calories. Ce "pied dans la porte" de l'industrie agro-alimentaire leur assure une part de leur efficacité et consacre le pouvoir absolu de cette branche de l'économie sur notre société.
Du reste, on ne compte plus les produits diététiques, céréales, concentrés de vitamines, huiles pressées à froid, etc. vendues avec des arguments médicaux ou diététiques, qui améliorent non seulement la santé des consommateurs — du moins on l'espère —, mais encore les finances des producteurs.
[p. 200]
Le contrôle des aliments
Ainsi que nous l'avons expliqué au sujet de l'industrie alimentaire (voir tome VII de cette Encyclopédie, pages 140-142), les aliments que nous mangeons arrivent sur notre table après avoir subi une série de contrôles, obéissant à une stricte réglementation touchant à leur composition et leur contenu, les additifs chimiques, leur pureté, leur hygiène, etc. Une armée de fonctionnaires veille à ce que les produits contiennent bien les denrées énumérées sur les étiquettes, à ce que les éléments de base soient autorisés par l'ordonnance fédérale ad hoc, à ce que les parasites soient éliminés, les bactéries ramenées à des pourcentages inoffensifs et les produits radioactifs impitoyablement éliminés.
Certains experts contrôlent les marchés et les arrière-cuisines, traquent les champignons vénéneux, voire se livrent à des dégustations de truffes pour détecter les fraudes et les imitations, car en cette matière, il existe de nombreuses possibilités de tromperie, dont les olives noires, les champignons chinois et les "oreilles de Judas" ne sont pas les moins innocentes.
Au secours des animaux comestibles
Ce ne sont pas seulement la médecine et l'hygiène qui investissent l'art du bien-manger, mais l'idéologie. Aujourd'hui, les âmes tendres s'interrogent sur les souffrances de nos frères inférieurs servis sur notre table sous forme de cuisses de grenouilles, de foie gras, voire tout bonnement d'oeufs durs et bientôt de carré d'agneau.
Il y a très longtemps que les protecteurs des animaux protestent contre les plats de cuisses de grenouilles, arrachées à l'animal tout vivant qu'on rejette ensuite au fond de l'eau, les tripes dégoulinantes. Les campagnes d'information parlant d'élevage, d'exécution sans douleur des grenouilles, ne peuvent rien contre ces images gravées parfois dès l'enfance.
En août 1991, une émission de télévision montra aux Suisses alémaniques horrifiés le gavage des oies et des canards, la déformation des corps "habités" en quelque sorte par un énorme foie plus gros que l'animal lui-même. Aussitôt, les lettres affluèrent aux directions de la Migros, de Coop-Suisse, de Jelmoli (Grand-Passage) pour exiger et obtenir que les fruits de pratiques si cruelles ne soient plus mis en vente. Si les succursales alémaniques se montrèrent assez disciplinées à cet égard, à Genève, au contraire, ce furent les hédonistes qui l'emportèrent. Malgré quelques lettres de [p. 201: image / p. 202] protestations de source genevoise, Coop-Genève passa outre aux consignes de sa direction suisse. Quant aux petits traiteurs, ils réalisèrent de superbes ventes de fin d'année grâce au foie gras devenu introuvable dans les grandes surfaces.
Cet aspect de notre relation avec l'animal promet de beaux conflits économiques et politiques. Déjà en 1978, la nouvelle loi fédérale sur la protection des animaux a tenu compte des exigences des amis des animaux, en particulier des poules: dès 1986, les effectifs des pondeuses en batterie sont sévèrement limités et ce mode de production est interdit depuis 1992. Ce qui naturellement fait monter le prix des oeufs suisses et oblige les grossistes à un système de compensation assez compliqué avec les oeufs de provenance étrangère. Ce n'est là qu'un exemple de la puissance des âmes tendres dans notre société.
Quant aux gourmets, ils tremblent à l'idée qu'on pourrait leur interdire de manger les huîtres vivantes et de vérifier leur vitalité en les chatouillant avec un peu de jus de citron, de plonger les crustacés tout vivants dans l'eau bouillante, de consommer escargots, cuisses de grenouilles, poissons, volaille, petits veaux attendrissants, boeufs châtrés, etc. Déjà, la suppression de la chasse dans le canton de Genève en 1974 a condamné les amateurs genevois à manger du gibier d'importation ou d'élevage (voir tome I de cette Encyclopédie, pages 134-137). Y a-t-il une tendance végétarienne dans le petit monde genevois?
Les végétariens
Le végétarisme correspond à une tradition religieuse déjà ancienne. La plupart des jeûnes, déjà dans l'Ancien Testament, puis dans les règles monastiques, proscrivent avant tout la viande, le vin, parfois les oeufs.
Le végétarisme actuel, né dans le courant du XIXe siècle, est une des disciplines de la diététique. Délivré des contraintes religieuses, il correspond plutôt à un dégoût, physique ou raisonné, des animaux tués, du sang, de la graisse animale. Pour présenter les choses de manière plus positive, il répond aussi à une certaine idée de la nourriture saine et doit, en principe, s'accorder avec un style de vie simple, proche de la nature, comportant un minimum d'exercice physique et la renonciation à l'alcool et au tabac.
Le mouvement végétarien compte plusieurs écoles, privilégiant diverses tendances. On peut distinguer deux grands groupes: les "ovo-lacto-végétariens" suppriment tous les aliments tirés de l'animal mort (viande, graisse, sauces, [p. 203] bouillons, volaille), mais acceptent ceux tirés de l'animal vivant tels que les oeufs et les sous-produits laitiers, comme le fromage, mais cela en faible quantité. Les "végétaliens" ne consomment aucun sous-produit animal, sauf parfois le miel, et sont par conséquent menacés par certaines carences alimentaires, protéines et calcium par exemple: ils doivent compenser le manque de protéines animales par un recours massif aux légumineuses (haricots, petits pois, fèves) et au célèbre "tofu", pâte tirée du soja qui s'impose avec autorité sur les tables "progressistes" dès les années quatre-vingt.
Toutefois, les végétariens tiers-mondistes dénoncent l'utilisation du soja et du tofu, produit qui peut se cultiver sur une grande échelle et se stocker facilement, ce qui favorise la concentration et le monopole de sa production et de sa diffusion par les grandes entreprises de l'industrie agro-alimentaire et contribue donc à faire disparaître les petites unités paysannes et artisanales, à développer le prolétariat international soumis et mal payé, et donc, à détruire le tissu social dans les pays du Tiers-Monde.
Un débat important et assez vif chez les végétariens touche à la crudité ou à la cuisson des aliments. Les adeptes, nombreux à Genève, de Catherine Kousmine, doctoresse d'origine russe établie dans le canton de Vaud, privilégient les céréales crues, moulues et mélangées à de l'huile pressée à froid, à du séré maigre, à du sucre et à des fruits dans la célèbre "crème Budwig" qui fait le fond de leur petit déjeuner. Leur phobie des graisses animales, notamment du beurre, ne leur interdit pas absolument le recours à la viande ou au poisson — ce dernier est souvent servi dans les restaurants végétariens. Mais ils s'interdisent l'alcool, le tabac, le café. Sel marin, miel, sucre brut, "petites graines", huiles pressées à froid contenant des acides gras "polyinsaturés", aliments crus sont les maîtres mots de ce régime qui s'est imposé, malgré la résistance de la Faculté, dans plusieurs hôpitaux.
Le végétarisme, dans la mesure où il n'est pas une tentative d'un groupe ou d'une école de prendre le pouvoir sur des êtres et de les rendre dépendants, est un art de vivre. Il suppose une hygiène, lavements et bains de siège, ayant pour but de purifier le corps. Certains végétariens refusent, sauf en cas d'urgence, la médecine allopathique, pour recourir aux médecines douces telles qu'homéopathie et acupuncture.
Pratiquement, le végétarien tend à supprimer le petit déjeuner, ce qui permet à son corps de jeûner plus longtemps. S'il le prend, c'est sous forme, évidemment, de céréales complètes et non du classique café-pain-beurre-confiture, dès longtemps dénoncé comme dénué de vitamines et porteur de calories "mortes" et inutiles. Le déjeuner [p. 204] commence par un plat de crudités; ce début permet d'assimiler mieux les vitamines et "tapisse" l'estomac pour la suite, qui comprend des céréales, des légumineuses et des légumes, qui peuvent être enrichis de fromage et d'oeufs. On termine par un dessert cuisiné et non par un simple fruit, réservé aux collations entre les repas. Le repas du soir est composé de la même manière, mais en général plus léger.
La nouvelle cuisine à Genève
A Genève, au temps de la prospérité, un recueil médiatique de biographies intitulé "Ceux qui font Genève", énumérait une demi-douzaine de cuisiniers de haut vol, tenant l'affiche des plus grands restaurants, liés généralement à des hôtels à cinq étoiles. Issus de la "nouvelle cuisine" française, ils additionnent les "étoiles Michelin", les "toques Gault et Millau", cumulent les commentaires élogieux de la part des chroniqueurs gastronomiques en principe incognito, mais reconnus et choyés par eux, sans toutefois arriver aux sommets atteints par le Vaudois Frédy Girardet, de la prestigieuse auberge communale de Crissier, qui a son article dans le Petit Larousse depuis 1988.
Même à Genève, où la prospérité et l'abondance de l'argent favorisent le développement de cette gastronomie de luxe, il est difficile de réussir dans la haute cuisine. Des chefs talentueux ont obtenu, à force de travail et de créativité, les étoiles ou les toques convoitées. Le prix de revient des [p. 205] matières premières, sur lesquelles le cuisinier doit se montrer très exigeant, le coût des vins qui doivent accompagner de tels plats, le coût de la main d'oeuvre — car il faut une armée de marmitons pour réaliser les recettes nouvelles — tout cela oblige à pratiquer des prix très élevés, sans avoir pour autant de marges bénéficiaires correspondantes.
En temps de prospérité, les hôtes paient sans discuter. Ils croiraient même déchoir en commandant au "Béarn" une tête de veau vinaigrette. Mais que survienne la crise, la clientèle se rabat sur des tables moins prestigieuses. Avant que ne vienne la faillite, les chefs qui ne dépendent pas d'un palace cinq étoiles — lesquels peuvent se permettre de pratiquer le mécénat culinaire — se recyclent dans les "plats canaille" à prix bas et investissements minimes. Au reste, les palaces eux-mêmes doivent se populariser et rentabiliser leurs surfaces en créant un "bistrot de quai" ou un snack-bar à prix populaires, doublant ainsi le restaurant gastronomique.
Evolution de la nouvelle cuisine
Un chercheur, Claude Fischler, a étudié les spécialités annoncées par les restaurants "étoilés" dans le Guide Michelin, depuis 1926. Il a constaté, dans la gastronomie de haut de gamme, une remarquable continuité, confinant au conservatisme, jusque dans les années 1970, époque où s'impose la nouvelle cuisine avec ses cuissons courtes et exactes, ses combinaisons paradoxales... ses grandes assiettes, ses petites rations et ses longues additions. L'aliment-roi de l'ancienne cuisine est le crustacé: langoustes et écrevisses, avec des sauces crémeuses, incarnent alors le rêve du bien-manger dans les pays de langue française.
La poularde de Bresse et le canard se maintiennent au-delà de 1970, mais les préparations évoluent. En revanche, les gratins disparaissent, ou la technique s'applique à de nouveaux aliments: huîtres, fruits par exemple. Les truffes et le foie gras, qui n'étaient qu'accessoires, sont désormais valorisés. Les légumes triomphent, de même que le poisson.
Tout cela montre une tendance dans l'alimentation, tendance bien explicitée par les sociologues et par les historiens. A mesure que l'on s'éloigne de la triste période des restrictions (1940-1947) et que l'on s'enfonce dans l'abondance et les vaches grasses, les gourmets désormais repus s'attachent à des repas légers, qui ne font pas grossir. Seuls les gens simples, les ouvriers, les paysans, les petits bourgeois, les personnes âgées qui n'ont perdu ni la mémoire des mauvaises années... ni l'appétit, mangent encore pour se nourrir et ne [p. 206] rechignent pas devant les pommes de terre, le lard et le jambon, les haricots, les monumentales entrecôtes garnies d'une épaisse sauce béarnaise.
Cuisine internationale et goût du terroir
Les guides des restaurants genevois, les menus notés à l'occasion du réveillon, les critiques gastronomiques des quotidiens et des hebdomadaires font apparaître une cuisine genevoise passablement, mais pas exclusivement dépendante du goût français. Ville internationale, Genève compte de nombreux restaurants exotiques, auxquels il faut ajouter les cuisines communautaires organisées par et pour les requérants d'asile qui ne supportent pas les préparations suisses et savoyardes.
Ce n'est pas seulement la clientèle étrangère, fonctionnaires internationaux, hommes d'affaires ou touristes de passage, qui trouve à se satisfaire dans ces restaurants montés par des compatriotes, mais les Genevois et les Suisses. Preuve en soit les nouvelles préparations à la chinoise ou à l'indonésienne, les riz à l'espagnole ou les couscous, les sauces mexicaines ou les pizzas surgelées que l'industrie agro-alimentaire met sur le marché pour faciliter la tâche des ménagères. [p. 207]
En combinant les données de l'Office du tourisme avec celles du bottin du téléphone (au nom-vedette "Café"), on obtient la statistique suivante:
Mais en même temps, on observe un retour à la terre, soit à la cuisine régionale. C'est là aussi un des aspects de la "nouvelle cuisine", dont plusieurs maîtres valorisent l'héritage de leur grand'mère, la cuisine du marché, les produits apprêtés et consommés en leur saison, et le "goût du terroir", aussi bien pour le vin que pour les viandes et les légumes. Mais c'est aussi, paradoxalement, par réaction contre les côtés sophistiqués de la nouvelle cuisine et contre la toute-puissance des cubes, des boîtes de conserve et des surgelés uniformes qu'en mai 1992, six jeunes chefs genevois ont servi aux Lyonnais, dans le cadre d'une "semaine de partenariat" Lyon-Genève, le menu suivant, donné comme typiquement genevois, mais tout de même aménagé au goût du jour:
Les boissons
Comment décrire la façon dont les Genevois étanchent leur soif? Il y faudrait la perspicacité d'un psychanalyste et la plume d'un poète. On va tenter néanmoins, à l'aide des meilleurs auteurs et de quelques données statistiques, d'approcher quelque peu la réalité.
Et d'abord de distinguer les boissons sans alcool (naturelles: eau, lait, jus de fuits, sirops, café, thé, chocolat, ou industrielles: limonades, eau de Seltz et autres boissons sans alcool) des boissons alcoolisées (fermentées: vin, bière, cidre, apéritifs, etc., ou distillées: eaux-de-vie, liqueurs, cocktails).
Boissons sans alcool naturelles
L'eau
Certes, la ville est bien située, à la sortie du lac Léman, à la jonction du Rhône et de l'Arve, au centre d'un bassin riche en sources et abondant en rivières et ruisseaux s'écoulant des Voirons, des Salèves, du Vuache et du Jura. L'eau n'y manque pas. Encore faut-il la domestiquer, la puiser et l'amener là où on peut la consommer. Or, jusqu'au milieu du XIXe siècle, exception faite des faubourgs, notamment du faubourg Saint-Gervais, la ville est enserrée dans ses fortifications, au sommet de la colline, 27 mètres au-dessus du niveau actuel du lac.
Les Romains, qui consommaient une quantité considérable d'eau pour leurs thermes, ont construit, au milieu du Ier siècle de notre ère, un aqueduc de 11 km pour amener l'eau des Voirons jusqu'à un réservoir situé aux Tranchées. Cet aqueduc a été probablement abandonné après les invasions des Alémanes, dans la seconde moitié du IIIe siècle. Sommairement réparé, il aurait encore fonctionné, tant bien que mal, jusqu'au VIe siècle, après quoi on en fut réduit à puiser l'eau dans des puits et des citernes ou à la chercher dans les sources, le lac, le Rhône ou ses affluents.
A partir du XVIe siècle, on équipe la ville en fontaines où les habitants viennent le matin puiser de l'eau pour remplir la "pierre à eau" ménagée au-dessus de l'évier, à moins qu'ils s'adressent au marchand d'eau qui leur monte le précieux liquide dans leur appartement. Les fontaines sont alimentées par des sources situées aux Eaux-Vives, à Plonjon, à Frontenex, qui tarissent souvent lorsque l'été est sec. De plus, l'eau n'est pas exempte de bactéries et contribue à propager les maladies.
Il faudra attendre l'installation d'un dispositif, de plus en plus perfectionné, pour que les fontaines de la Haute-Ville, d'abord, puis les habitations, soient alimentées en eau [p. 209] potable. En 1708, c'est Joseph Abeille qui installe une roue à aubes à la pointe de l'Ile; en 1843, elle est remplacée par une machine hydraulique et en 1873, par l'usine de pompage de la Coulouvrenière. Aujourd'hui, l'eau que boivent les Genevois provient en partie du lac, en partie des nappes phréatiques, notamment celle de l'Arve (voir le tome I de cette Encyclopédie, pages 34 à 36).
Mais les Genevois sont gens délicats: malgré les efforts du Service des Eaux pour livrer une boisson de qualité, ils consomment des quantités croissantes d'eau minérale, au grand dam des services de la voirie, chargés d'éliminer les déchets ménagers. Une ordonnance fédérale du 22 août 1990 interdit, à dater du 1er novembre 1991, l'utilisation et l'importation d'emballages en PVC (polychlorure de vinyle). Sont seuls admis par conséquent depuis cette date les verres perdus, les verres consignés et les emballages en PET (polyéthylène téréphtalate), moins dommageables pour l'environnement. Il en est résulté des modifications profondes dans l'origine des eaux consommées en Suisse, certains fournisseurs ne s'étant pas convertis au PET. C'est le cas en particulier des eaux minérales françaises qui, du jour au lendemain, ont presque disparu du marché, à commencer par l'eau d'Evian qui y occupait une place très importante. A noter toutefois que beaucoup d'amateurs restent fidèles à leur marque préférée, qu'ils se procurent dans les grandes surfaces de Haute-Savoie et du Pays de Gex.
Le lait
L'élevage est pratiqué dans la région dès la plus haute antiquité et l'on peut être certain que le lait — lait de vache, de chèvre et de brebis — a constitué de tout temps une boisson appréciée de ses habitants, non exempte, certes, de germes de maladies, mais riche en principes actifs. Autre inconvénient: le lait tourne rapidement, surtout lorsqu'il est exposé à la chaleur, si bien que jusqu'à l'apparition de l'industrie du froid seules les fermes proches de la ville étaient en mesure d'en livrer. Dans les autres régions, on transformait le lait en beurre et en fromage.
D'après A.-M. Piuz, ce n'est qu'au XVIIIe siècle que le lait "cesse d'être un aliment exclusivement, ou presque, destiné aux enfants et aux malades". J.-J. Rousseau évoque les charmes d'un goûter avec du beurre frais, des fruits et du laitage. Le retour à la nature met le lait à l'honneur. Plus près de nous, le Premier ministre français Pierre Mendès-France a fait beaucoup, à travers la télévision, pour le prestige du lait dans les pays francophones. [p. 211]
A l'heure actuelle, l'approvisionnement de Genève en lait frais est assuré par les Laiteries Réunies. Genève a consommé, en 1990, 53.756.200 litres de lait, soit 140,5 litres par habitant. 10% provenaient du canton de Genève, 34% du canton de Vaud et 56% des "zones franches" de Haute-Savoie et du Pays de Gex. On trouvera, dans le tome VII de cette Encyclopédie, aux pages 132 à 134, une description du fonctionnement de cette entreprise et du rôle qu'elle joue dans l'économie de toute la région.
Les jus de fruits et sirops
La consommation de jus de fruits a pris une extension considérable au XXe siècle, à partir du moment où les procédés de conservation et d'emballage ont permis de les commercialiser sur une large échelle. Actuellement, les ventes ne progressent plus beaucoup. En revanche, le choix, sous forme de jus concentrés, de nectars ou de boissons "light", s'est fortement étendu: en plus des classiques jus d'oranges, de tomates, de pommes, de raisins, de pamplemousses, de citrons, on trouve des jus de pêches, d'abricots, de poires, de groseilles, de mûres, de framboises, de myrtilles, de pruneaux, des jus de carottes et de betteraves rouges et des jus de fruits exotiques tels que mangues, ananas, fruits de la passion, et des mélanges savants de différents parfums.
Quant aux sirops, ils sont encore souvent confectionnés par les ménagères, mais on en trouve aussi dans le commerce.
Les boissons chaudes (café, thé, chocolat)
L'apparition du café, du thé et du chocolat en Europe est relativement récente: c'est au XVIIe siècle que ces boissons, considérées à l'époque comme des excitants ou même comme des médicaments, se répandent à la Cour de France et de là, sur tout le Continent. Ainsi, à Genève, le Conseil, dans sa séance du 25 novembre 1700, délibère "s'il ne serait pas à propos, à cause des étrangers qui sont en cette ville, de rétablir quelques vendeurs de café, thé et chocolat, il a été dit qu'on en établisse six, qui seront distribués en six endroits de la ville, citoyens ou bourgeois de bonne réputation".
Le café vient d'Arabie après avoir été éthiopien. D'après Braudel, il aurait été lancé à Paris en 1669, par l'ambassadeur turc Soliman Mustapha Raca qui recevait beaucoup et en offrait à ses hôtes. A Genève, on en trouve vers 1690 et sa progression est si rapide, durant tout le XVIIIe siècle, que les établissements où l'on en sert en portent dorénavant le nom: on ne parle bientôt plus de cabarets, de tavernes ou d'estaminets, mais de cafés, où l'on trouve des membres de la "bonne [p. 212] société" et où l'on sert peu à peu toutes les boissons, alcoolisées ou non. Le goût du café gagne tous les milieux, même les ménages paysans: les inventaires après décès font état de plus en plus fréquemment de "grilloirs", de moulins à café et de cafetières et les ventes passent, du début à la fin du siècle, de 200 gr. à 2 kg. environ par habitant et par année. Aujourd'hui, la consommation de café est en moyenne à Genève de 2 kg. environ par ménage et par an, principalement sous forme de café au lait le matin et de café crème ou café noir après les repas et dans le courant de la journée. Il est vendu torréfié ou non, moulu ou en grains, et résulte du mélange, en proportions variables, de deux variétés: l'Arabica, qui provient d'Amérique latine et d'Afrique orientale, et le Robusta, cultivé dans les régions tropicales d'Afrique, de l'Inde et d'Indonésie.
Le thé est d'origine chinoise. De là, il se répand aux Indes, d'où il gagne la Hollande par les soins de l'Oost Indische Companie. Il ne devient réellement populaire qu'en Angleterre, aux Pays-Bas et en Russie. A Genève, la mode ne s'en généralise dans la bourgeoisie qu'à la fin du XVIIIe siècle, à la faveur de l'anglomanie qui y règne, mais sa consommation reste limitée à ce milieu. Il provient essentiellement de l'Inde (Darjeeling), du Sri Lanka (Ceylan) et de Chine. Depuis quelques années, la mode s'est répandue de thés aux parfums les plus variés. On compte, dans les magasins spécialisés, jusqu'à 70 variétés de thé. Il donne son nom, dès la fin du XIXe siècle, sous l'influence du tourisme anglais, aux "maisons de thé" appelées tea-rooms.
Quant au chocolat, originaire du Mexique, c'est en Espagne qu'il se répand en premier lieu, sous la forme d'une boisson épaisse, parfumée à la canelle. En Suisse, la vogue du chocolat, boisson destinée surtout aux enfants, semble être bien plus récente, liée au succès des Peter, Cailler, Kohler, Nestlé, Suchard, Favarger et autres fabricants qui ont fait du pays, dès la fin du XIXe siècle, la patrie du chocolat. On trouve aussi le chocolat mêlé à d'autres produits, tels le malt, vendu comme un fortifiant ou un stimulant pour les jeunes et les sportifs.
Boissons sans alcool industrielles
Chose curieuse, Genève est à l'origine de l'industrie des boissons dites gazeuses. A la fin du XVIIIe siècle, un pharmacien de la rue de la Croix-d'Or, Henri-Albert Gosse — qui fonda par la suite la Société suisse des sciences naturelles -, mit au point avec deux associés une boisson effervescente [p. 213] à base d'eau naturelle, de quelques sels minéraux et de gaz carbonique. Son invention n'eut aucun succès à Genève, mais l'un des trois compères, John Jacob Schweppes, s'installa en Angleterre et lança le produit sous son nom. Le succès n'a pas tardé et n'a fait que s'affirmer dans le monde entier. Aujourd'hui, la consommation des boissons sans alcool est dominée par celle du Coca-Cola et du Pepsi-Cola, d'origine américaine. On trouve aussi un choix considérable de boissons de table, dites aussi "eaux sucrées", mais leur volume de ventes est insignifiant en comparaison de celles de Cola.
Boissons alcoolisées fermentées
Le vin
Le vin est la boisson par excellence qui accompagne les bons repas, inspire les poètes et ne véhicule pas, comme l'eau et le lait, microbes et bactéries. Il est d'abord importé, de Grèce, d'Italie et du midi de la France. Posidonius constate, lors d'un voyage en Gaule, vers l'an 200 avant J.-C., que le peuple boit de la cervoise ou bière d'orge, alors que les gens riches font venir du vin d'Italie et de Marseille. A Genève, le commerce des vins étrangers a toujours été très actif, soit pour la consommation locale, soit pour le transit à destination de la Gaule, et les débuts de la viticulture, que l'on situe dans la seconde moitié du Ier siècle après J.-C., n'a guère eu d'influence sur ce négoce. On trouvera dans le tome II de cette Encyclopédie, aux pages 121 à 130, deux exposés très complets sur le vignoble genevois, ses origines, son développement, la crise du XIXe siècle et les progrès considérables qui ont été accomplis depuis lors dans l'organisation et les méthodes de la viticulture genevoise et dans les procédés de vinification. On se limitera donc pour l'essentiel à traiter, ici, de la consommation du vin, qu'il soit genevois, suisse ou étranger.
Avant l'époque romaine, on ne cultivait pas de vin au nord de la Durance. Il fallait donc en importer. Il traversait les Alpes, en provenance de Grèce et d'Italie, ou remontait le Rhône depuis Marseille. Genève était bien située pour bénéficier de ces deux trafics. Les Romains ont cherché à protéger leurs viticulteurs en interdisant la plantation de vigne en Gaule transalpine. Ils n'y sont pas parvenus, mais le dommage n'a pas été grand pour eux à Genève, car les vins n'y étaient pas fameux (on leur colle souvent le qualificatif de "verjus", surtout lorsqu'ils proviennent de vignes en "hutins"), et le vin des Allobroges avait un goût de poix prononcé. On continua donc à s'approvisionner à l'étranger. [p. 214]
Après les invasions barbares, les Burgondes font un grand effort pour reconstituer les vignobles du pays. Selon A. Babel, on plante de la vigne partout où elle peut pousser. "Certaines prescriptions de la loi Gombette prouvent l'importance de la vigne dans notre pays à l'époque burgonde". Les transports sont désorganisés, l'importation des vins étrangers est paralysée, il faut bien se contenter de la "piquette" genevoise.
La première des boissons
Dès le XIe siècle, l'importance du vin s'affirme, à la fois comme boisson, comme frêt et comme source de profit pour les finances publiques. Les Franchises d'Adhémar Fabri, en 1387, décrètent que le commerce du vin est le privilège exclusif des chanoines, des curés de la ville, des citoyens jurés et des bourgeois, et que son prix est fixé par l'évêque, son vicaire ou son official, assisté de deux chanoines et de quatre citoyens. Par la suite, au XVe siècle, ces prérogatives de l'évêque passent au Conseil et ses registres abondent en décisions concernant le prix des différents vins et les taxes perçues à leur entrée et lors de leur vente. Le vin apparaît réellement, avec le blé et le sel, comme l'un des éléments de base de l'alimentation, ou en tous cas comme l'un des plus contrôlés et des plus productifs.
Dans ses Chroniques de Genève, François Bonivard, prieur de Saint-Victor (vers 1493-1570) écrit: "De tous côtés le pays y est fertile et abondant pour l'entretenement des habitants;... de vin (sinon si fort et si puissant comme en plusieurs autres lieux) au moins pur et net, avec ce que l'on en apporte de non loin dillec de fort bon et puissant. Du côté occident, l'on en amène par charroi de Seyssel et de Chautagne qui ne doit guère à celui de Beaune. L'on en apporte aussi par le lac, des deux côtés, à savoir de Sousmont et de Thonon, de blanc et rouge, fort bon et puissant, mêmement le vin rouge Servagnin de Thonon qui sent sa framboise, comme celui de Beaune, a voiture à bon marché à cause de l'eau".
D'après J.-F. Bergier, l'habitude de boire du vin tend à se développer dans tout l'Occident à la fin du Moyen Age. En 1484, il s'est consommé à Genève 28.665 hl de vin, ce qui équivaut à 239 litres par habitant et par an. Les Foires y sont probablement pour quelque chose, mais une autre information vient confirmer l'importance de la consommation de vin à Genève aux XVe et XVIe siècles: après la Réforme, les pasteurs recevaient un salaire en espèces et en nature; or, pour l'année 1541, le Conseil attribua à Calvin, comme aux autres pasteurs, 648 litres de vin destinés à la consommation familiale. [p. 215]
L'origine du vin
On distinguait le vinum patriae, petit vin du pays provenant soit de plantations en rangs serrés sur les coteaux, soit de butins en terrain plat. On le buvait coupé d'eau. Les vins "importés" étaient le Sousmont, qui n'était autre que du La Côte — nombreux étaient les Genevois qui possédaient des vignes à La Côte —, la Semine et la Chautagne, vins de la région de Seyssel, dont le prix atteignait à peu près le double de celui du vin du pays. Quant au Salvagnin, il s'agissait d'un vin rouge produit à Genève dans des vignes en hutins, mais aussi, de bien meilleure qualité, importé de la région de Thonon.
Au XVIIe siècle, selon A.-M. Piuz, on importait les vins rouges de Savoie (Semine, Chautagne et Montmélian) et de la région lyonnaise, et des vins fins de Franche-Comté, d'Arbois, de Bourgogne, de Provence, de Bordeaux, d'Espagne et du Portugal. Quant aux vins de liqueur comme la malvoisie et le muscat, qui venaient à l'origine de Grèce et de Crête, on les importait dorénavant d'Espagne et du Languedoc.
Au fur et à mesure de l'accroissement de la prospérité, on néglige les vins du terroir et donne la préférence aux vins vaudois, valaisans et étrangers. Ainsi les surfaces du Canton plantées en vigne diminuent au début du XIXe siècle du fait de cette concurrence. Puis vient, dans la seconde moitié du siècle, la terrible crise due à l'apparition, dans toute l'Europe, de l'oïdium, du mildiou et surtout du phylloxéra qui oblige à arracher les vignes et à les replanter en plants américains greffés. Ce drame, prolongé par l'augmentation des importations et par la crise économique des années trente, étend ses effets jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale pour faire place, alors, à un remarquable renouveau: les viticulteurs s'organisent, ils renouvellent les cépages et perfectionnent les méthodes de vinification, en sorte que l'amélioration de la qualité des vins genevois leur permet de lutter à armes égales et à prix inférieurs avec leurs concurrents vaudois, valaisans et neuchâtelois. Aujourd'hui, à côté du classique chasselas, on trouve en raisins blancs du riesling-sylvaner, du chardonnay, de l'aligoté, du pinot blanc et gris et, en raisins rouges, essentiellement du gamay et du pinot noir.
Quels vins consomment aujourd'hui les Genevois?
Pour répondre à cette question, nous nous sommes adressés à deux maisons de commerce: Coop-Genève, entreprise à succursales multiples connue pour le choix et la qualité de ses vins, et Bignens Vins S.A., commerce spécialisé dans la [p. 216] vente de boissons. Les conclusions qui ont pu être tirées des statistiques de ventes de ces deux maisons diffèrent notablement en raison, d'une part de leurs politiques d'achats et d'"actions" respectives, d'autre part des goûts et des habitudes de leur clientèle.
D'une façon générale, on constate dans les achats des Genevois une nette prédominance des vins rouges et une progression des vins rosés. Autre constatation: la clientèle jeune, jusqu'à 35 ans, achète de préférence des vins en bouteilles, alors que les vins en litres sont consommés par les personnes plus âgées et que leurs ventes baissent, depuis le milieu des années quatre-vingt, de 5 à 10 pour cent par année. Cette préférence pour les vins de qualité et de prix élevés explique la disparition presque complète des vins d'Algérie. Enfin, les statistiques de ventes de vin des grandes surfaces genevoises sont faussées par la tendance des consommateurs à se fournir directement chez les producteurs genevois et en France voisine.
Ces réserves étant faites, il est possible d'esquisser un tableau approximatif des vins consommés actuellement à Genève, en se fondant sur les ventes de Coop-Genève en 1991 (voir ci-contre).
Les statistiques de Bignens Vins S.A. font apparaître, pour les vins en litres, une proportion bien plus forte de vins français au détriment des vins espagnols et, pour les vins en bouteilles, une prédominance marquée des Beaujolais et Bordeaux pour la France et des vins vaudois et genevois pour la Suisse. Les ventes de vins italiens sont faibles. En revanche, les ventes de Champagne et de vins mousseux atteignent des chiffres respectables.
La bière et le cidre
La bière était connue dans les anciennes civilisations, notamment en Babylonie et en Egypte. L'Empire romain ne l'aimait guère, tandis que les Gaulois utilisaient l'orge pour fabriquer la cervoise. Selon Braudel, c'est "la boisson des pauvres et des Barbares", mais "au temps de Charlemagne, elle est présente à travers tout son empire". Faut-il admettre avec J.-F. Bergier qu'elle aurait disparu par la suite? Il écrit en effet qu'elle n'était guère produite aux XVe et XVIe siècles, au sud du Rhin, en précisant qu'elle n'est pas mentionnée à Genève avant le milieu du XVIIe siècle. On trouve, en effet, dans les Sources du droit du canton de Genève du 23 mai 1640, le texte suivant: "Les fermiers de l'impost sur les revendeurs du vin s'estant pourveus ceans par requeste, par laquelle ils auroyent representé qu'ils souffroyent grand perte en leur ferme par la vente qui se fait de quantité de bière en ceste [p. 217] ville, dont neanmoins il ne revient aucun proffict dans la bourse publique, puis qu'on n'en paye aucun impost, ils auroyent esté renvoyés à la Chambre, où l'affaire ayant esté examinée, elle trouve bon, si tel est le bon vouloir de la Seigneurie, de faire payer à l'advenir six sols d'impost pour septier de la bière qui se vendra en ville ou au territoire. A quoy on est demeuré". Il semble donc qu'en 1640, il se consommait déjà "quantité de bière en ceste ville", mais le phénomène devait être récent puisque le fisc n'y avait pas encore mis son nez! Par la suite, il est arrêté, le 21 mai 1649, qu'un commerçant payera la gabelle de la bière "comme du vin rouge".
Une première brasserie aurait été installée à Carouge par Georges-Frédéric Dürr, tonnelier et brasseur de bière, en vertu d'un contrat passé le 5 octobre 1790, à Carouge, avec Jean-Pierre Gröttzch, cordonnier natif de "Chefelle", en Saxe. Au XIXe siècle, de très nombreuses brasseries se sont installées à Carouge et à Genève, parmi lesquelles la brasserie Duboin, à Carouge, qui fut à l'origine des chopes de trois décilitres nommées "carougeoises", la brasserie de Grange-Canal, la brasserie Hardt à la Terrassière, Recordon, rue Caroline à Carouge, les brasseries Ursenbach, Veuve et Nusser à la route de Carouge, la brasserie Treiber à Chêne-Bougeries, transférée par la suite à la Terrassière, les brasseries de Corsier, des Pâquis, de Tivoli, de Saint-Jean et du Bois de la Bâtie. La plus importante fut la brasserie de Saint-Jean, fondée en 1872, qui fut reprise, en 1927, par la brasserie Feldschlôsschen, de Rheinfelden, et ferma ses portes en 1969. Quant à la brasserie Tivoli, elle a été reprise, en 1927, par la brasserie du Cardinal, à Fribourg, qui y installa un dépôt.
Aujourd'hui, la bière n'est plus produite dans de petites brasseries de caractère artisanal, mais dans d'immenses fabriques conçues à l'échelle nationale. Genève ne participe pas à cette industrie, mais bien à la consommation de ses produits, qui varie fortement en fonction des conditions météorologiques, mais reste néanmoins bien inférieure à celle du vin.
Le cidre n'est pratiquement pas connu à Genève. Le jus de pommes ou de poires qu'on y boit n'est pas alcoolisé.
Les spiritueux
Sont classées dans cette catégorie toutes les boissons qui, par leur contenance en alcool, satisfont à d'autres habitudes de consommation que le vin: apéritifs, vins à fort degré d'alcool, boissons fermentées et distillées.
La coutume de boire un apéritif avant les repas n'est pas très ancienne à Genève. Tout au plus buvait-on dans les grandes occasions, jusqu'à la Première Guerre mondiale, un verre de vin pour se mettre en appétit. [p. 218]
Aujourd'hui, les vins doux importés de France, d'Italie et surtout d'Espagne et du Portugal sont fréquemment servis en apéritifs, de même que différentes espèces de vermouths. Ils ont habituellement 15 à 18 degrés d'alcool. Mais la boisson qui, à Genève, bat tous les records de vente de spiritueux est le whisky: il en représente plus du tiers chez Coop-Genève.
Quant aux autres boissons fermentées, qu'il s'agisse de blé, de riz, de pommes de terre, de fruits ou d'autres végétaux, elles ont été éliminées dans nos régions par le procédé de la distillation. Les Gaulois en faisaient largement usage. Dans son Histoire de la Gaule, C. Jullian écrit: "Quelle que fût la nature de leur boisson, les Gaulois trouvaient toujours le secret de l'ivresse".
Les boissons distillées sont obtenues à l'aide d'un alambic, dont l'invention remonte au XVIe siècle. Braudel parle en termes lyriques de "la grande novation, la révolution, ... l'apparition de l'eau-de-vie et des alcools de grains, d'un mot: l'alcool. Le XVIe siècle le crée pour ainsi dire, le XVIIe le pousse en avant, le XVIIIe le vulgarise".
A Genève, on distingue les eaux-de-vie de vin (cognac et armagnac), les alcools de grains (whisky, gin, vodka), les alcools blancs (kirsch, pruneau, mirabelle, poire, pomme, etc.) et les liqueurs. La consommation est variable selon les milieux. A partir des années vingt, l'installation des organisations internationales et des missions diplomatiques qui leur sont liées, avec les nombreuses réceptions qu'elles organisent, a eu pour effet un accroissement notable de la consommation d'alcools importés et de cocktails, au point que les associations antialcooliques se sont émues devant les cas de plus en plus fréquents d'alcoolisme mondain.
Comment chiffrer la consommation?
Il n'est pas facile d'évaluer la quantité des différentes boissons consommées par la population genevoise: les statistiques de production et d'importation ne sont pas utilisables parce que les articles produits ou importés ne font souvent que transiter par Genève. On est donc réduit à utiliser les résultats d'une enquête de l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail (OFIAMT) sur les budgets des ménages, publiés, en ce qui concerne le canton de Genève, depuis 1985, par le Service cantonal de statistique dans ses Données statistiques. Ce service reconnaît que les chiffres qu'il publie sont d'une "représentativité limitée" en raison du faible nombre de ménages interrogés (environ 50). Cet échantillon ne peut que difficilement être élargi, car les [p. 219] conditions imposées sont sévères: les ménages qui participent à l'enquête doivent inscrire chaque jour, durant douze mois consécutifs, toutes leurs recettes et toutes leurs dépenses sur un carnet de comptes. Malgré ces limites, le Service cantonal de la statistique estime que l'enquête apporte des renseignements importants sur l'évolution des habitudes de consommation.
Le tableau reproduit ci-dessous donne une idée de la consommation des ménages genevois entre 1985 et 1989. Sur un total de dépenses de Fr. 74.248.- en moyenne par ménage et par an, l'alimentation et les boissons représentent Fr. 8.227.- ou 11,1%.
[p. 220]
On ne relève pas de tendance bien marquée, sauf une augmentation des dépenses pour repas et boissons consommés hors du ménage (+33%), de même que pour les achats de fromage, d'aliments précuisinés, de vin et de boissons sans alcool, et une diminution des dépenses pour les oeufs, les fruits, les huiles, graisses et margarine, le sucre, miel, confiture et chocolat, de même que pour le lait. Les achats de café soluble en poudre ont diminué de 47%, en raison probablement de la prolifération des machines à café (le poste de dépenses "machines et apppareils électroménagers" a augmenté, dans le même temps, de 62%).
Parler de la nourriture
Les études scientifiques sur l'alimentation sont généralement ennuyeuses. Seuls ceux qui aiment manger et cuisiner savent parler de l'objet de leur amour. Les critiques gastronomiques, à l'affût de la moindre imperfection, calculant le rapport qualité-prix, attribuant les toques, les étoiles ou les autres distinctions avec parcimonie, ne mettent pas toujours les lecteurs en appétit. C'est Georges Haldas qu'il faut citer pour terminer. Dans sa Légende des repas, l'écrivain genevois célèbre, autant que les repas, le souvenir de "la Petite Mère", qui "mettait tous ses dons, pour ainsi dire, ses qualités [p. 221] d'esprit et plus encore de coeur, et par là même sa délicatesse de sentiments et, plus que tout, son admirable fidélité à nous tous, aux Philosophes; mettait donc tout cela au service de la cuisine, en ces heures matinales, et à la confection de ces plats qui arriveraient, à midi, modestes, mais pas timides, sur la table de la Salle à Manger.
"Ainsi le soin extrême que mettait la Petite Mère à préparer pour nous une soupe aux légumes: ah! cette soupe aux légumes, avec un peu de beurre, qu'on y déposait au dernier moment, quel arôme, quel bouquet d'arômes; c'est toute la campagne et notre enfance et l'époque même où on vivait qui, avec son fumet, montait de l'assiette jusqu'à nous; nous faisant trouver riche le monde. Ou encore la peine qu'elle prenait, la Petite Mère, à effeuiller avec vigilance une salade ou à peler les pommes de terre pour composer une purée onctueuse, conciliante, apaisante! Tout en poursuivant, on le sentait, une méditation sur mille choses, qui se traduisait, le moment venu, par de petites remarques pertinentes, sagaces, pleines d'humour. Tout cela, bien sûr, elle l'accomplissait en vue de la meilleure qualité possible du repas à venir. Mais ce qu'elle visait, en fait, au-delà de cette meilleure qualité du repas, et qui lui conférait une plus haute qualité encore, et plus secrète, c'était avant tout — j'en ai pleine conscience aujourd'hui — de faire plaisir à tous et à chacun."
C. S. et J. de S.
haut
[p. 222]
La santé, la responsabilité des citoyens
L'Organisation mondiale de la santé, sise à Genève, définit la santé comme "un état de complet bien-être physique, mental et social". Selon cette conception, "la santé ne réside pas seulement en l'absence de maladie ou d'incapacité, mais implique que tous les individus, quelles que soient les circonstances du moment et quel que soit leur âge, puissent accéder au bien-être, en tirant pleinement parti de leurs capacités fonctionnelles". Dans un document de 1985 où sont énumérés les moyens à mettre en oeuvre pour assurer aux Européens, d'ici l'an 2000, la santé ainsi définie, on postule un avenir où les petits Européens auront une bien meilleure chance:
— de naître en bonne santé de parents qui les auront désirés et qui auront le temps, les moyens et les aptitudes voulus pour les élever et les soigner convenablement
— d'être éduqués dans des sociétés qui auront intégré les valeurs fondamentales d'un mode de vie sain, qui encourageront le choix individuel et lui permettront de s'exercer librement
— de se voir assurer les préalables essentiels de la santé et d'être efficacement protégés contre la maladie et les accidents.
Quant à l'ensemble des habitants de l'Europe, on voudrait leur offrir une chance égale:
— de vivre dans un environnement stimulant d'interaction sociale, à l'abri du risque de guerre, en étant pleinement en mesure de jouer un rôle économique et social satisfaisant
— de vieillir dans une société qui les aide à préserver leurs capacités, leur garantit une retraite confortable et enrichissante, leur offre des soins quand ils en ont besoin, enfin, leur permet de mourir dans la dignité.
Belle utopie! Mais dont on peut tirer au moins une idée, pas si évidente et admise qu'on pourrait le penser, à savoir que la santé, avant d'être l'affaire de la médecine et des médecins, relève d'abord de notre responsabilité d'individus et de citoyens.
Des attentes contradictoires
Sans doute faut-il distinguer deux domaines: celui, d'une part, des lois et règlements, du système économique, social et sanitaire qui en résulte. A cet égard, et mesurées à l'aune des ambitions de l'OMS, les conditions qui prévalent en Suisse, et singulièrement à Genève, sont loin d'être défavorables, même si de nombreux progrès restent à accomplir (que l'on songe, pour ne prendre qu'un exemple, à la protection de la maternité). Reste le deuxième domaine, celui des comportements, [p. 223] des valeurs individuelles et collectives, de ce qu'on appelle les moeurs. Et c'est là, à l'évidence, que le bât blesse, tant il est vrai qu'y règnent l'inconséquence, l'irrationalité, les attentes contradictoires: nous attendons de l'Etat qu'il supprime tous les risques collectifs, qu'il nous protège de la violence d'autrui, qu'il assure la pureté de l'eau, de l'air, des aliments; nous demandons aux médecins de repousser toujours plus loin l'affreuse obligation de mourir; cela ne nous empêche nullement de glorifier l'exploit sportif extrême, de tolérer sans broncher les morts, le plus souvent jeunes, fauchés chaque week-end sur la route, de revendiquer hautement la liberté de détruire sa santé (lentement il est vrai) par l'excès de fumée et d'alcool.
Il est vrai aussi, cependant, que les efforts de prévention entrepris, notamment pour décourager le tabagisme, semblent commencer à porter certains fruits. Mais il est à craindre qu'y soient surtout sensibles les mieux éduqués, les mieux intégrés, donc les privilégiés de notre société. Ceux qui, par tradition calviniste ou par choix éclairé, ont les moyens de mener une vie frugale et équilibrée, qui savent quand consulter un médecin, à quel examen se soumettre. La floraison de centres de "fitness" et de "body-building", la vogue du "jogging" ou du "montain-bike" (pardon pour le franglais) sont, elles, à notre sens plus ambiguës. Elles témoignent certes d'un intérêt sans précédent pour le corps, mais qui relève essentiellement de préoccupations esthétiques et narcissiques: le look, le rêve d'une éternelle jeunesse ne sont-ils pas les obessions du jour? D'où d'ailleurs des excès [p. 224: image / p. 225] qui finissent, à leur tour, par devenir des problèmes de santé publique. A preuve, la mort récente d'un jeune Genevois dopé aux anabolisants et les tentatives en cours pour tenter d'enrayer la propagation, dans les centres de body-building genevois, de ces "engrais musculaires" extrêmement dangereux pour la santé.
Un esprit sain dans un corps sain
"Mens sana in corpore sano": après les internistes, les psychiatres forment, à Genève, la spécialité la plus nombreuse. On y compte en effet 130 psychiatres privés (dont une vingtaine pour les adolescents et les enfants), qui s'ajoutent aux psychiatres travaillant en institution. Les troubles psychiques ne sont pas plus fréquents à Genève qu'ailleurs, mais il semble qu'on y éprouve moins de gêne à consulter un spécialiste lorsque "quelque chose ne tourne pas rond". On parle aujourd'hui beaucoup de la dépression. De fait, les épidémiologistes estiment que, dans les pays industrialisés, huit personnes sur cent souffrent de dépression majeure, c'est-à-dire d'une dépression d'origine interne. Le nombre des dépressions dites réactionnelles, soit qui sont liées à des événements vécus, doit être au moins égal. Pour des raisons qui restent à élucider, mais qui tiennent peut-être à leur rôle dans la société, les femmes sont deux fois plus touchées que les hommes. Des chercheurs genevois tentent d'établir les liens éventuels entre l'origine sociale, le statut familial et professionnel et la dépression. On sait déjà que l'âge joue un rôle. Vieillissement de la population aidant, on peut prédire que le nombre des dépressions va augmenter. Il est donc heureux que l'on sache désormais mieux les diagnostiquer et, dans la majeure partie des cas, les soigner, le plus souvent en combinant médicaments et psychothérapie.
Mais, au reste, comment donc s'y prendre pour mesurer l'état de santé d'une collectivité telle que Genève? A défaut d'"indicateurs de santé" au sens précis du terme, il faut recourir à la statistique qui, elle, ne s'intéresse pas à la santé, mais bien à son contraire, la maladie.
Une forte densité de blouses blanches
Avec, en 1990, un médecin en pratique privée pour 426 habitants, Genève est, avec Bâle-Ville, le canton suisse bénéficiant de la plus forte densité médicale. On peut donc affirmer qu'à cet égard les besoins de la population sont pourvus, [p. 226] et cela dans toutes les spécialités. A terme, et si l'on sait que chaque année voit s'installer une cinquantaine de jeunes médecins (chiffre dont il faut cependant soustraire les départs et les retraites), il n'est pas exclu que la profession finisse par souffrir d'une pénurie de patients. Mais la santé étant l'un des rares domaines où l'offre crée la demande, il n'est pas exclu que les exigences sanitaires des Genevois croissent à la mesure du nombre de leurs médecins.
La proximité d'un nombre considérable de blouses blanches n'immunise hélas pas les Genevois contre la maladie et la mort. Faute cependant de statistiques complètes de morbidité, impossible de savoir exactement qui souffre de quoi à Genève: combien de rhumatismes, combien d'ulcères, de psoriasis, combien d'infarctus ou de maladies d'Alzheimer. S'agissant cependant du cancer, ce flou fait place à une photographie d'une grande netteté grâce à la remarquable activité du Registre genevois des tumeurs. Créé en 1970, à l'instigation du professeur Gustave Riotton, ce fichier permanent de tous les cas de cancers affectant les habitants du Canton avait pour objectif initial de suivre l'évolution de la fréquence des nouveaux cas de cancers féminins, en particulier ceux du col utérin. Parallèlement, se développait en effet la première action d'envergure destinée à prévenir ce type de cancer, grâce à un contrôle périodique permettant le dépistage des cas à un stade précoce, auquel ils sont aisément traitables et curables. Le dénombrement des cas, année après année, a, en l'occurrence, démontré le bien-fondé de cette démarche préventive puisqu'il a mis en évidence, entre 1970 et 1985, une réduction de plus de 70% des cas graves. [p. 227]
Malgré les progrès réalisés dans le traitement de nombreuses formes de cancer, cette maladie continue d'être, juste après les maladies cardio-vasculaires, la deuxième cause de décès des Genevois. En chiffres absolus le nombre des affections cancéreuses est croissant. Effet des nuisances et des pollutions dues à la civilisation industrielle? Peut-être. Plus sûrement, effet du vieillissement de la population: l'âge est, en matière de cancer, un facteur de risque prépondérant et la probabilité d'être atteint d'un cancer croît de façon vertigineuse avec l'âge. Ainsi, à Genève, toutes formes de cancer réunies, le risque d'être atteint entre 20 et 25 ans se situe autour de trente à quarante cas pour cent mille personnes. Entre 75 et 80 ans, ce risque passe à deux ou trois mille cas pour cent mille personnes. Il n'est donc pas étonnant que le nombre des patients cancéreux dans nos hôpitaux augmente plus vite que la population totale; augmentation qui vaut aussi pour les autres maladies chroniques ou dégénératives.
A l'échelle de la Suisse entière et si l'on fait abstraction du vieillissement démographique, il semble que l'on s'achemine vers une légère diminution de la fréquence du cancer. Diminution qui serait plus marquée n'était l'ampleur prise, chez les hommes surtout, par le cancer du poumon, imputable dans 90% des cas au tabac.
Les mesures contre le Sida
Seconde maladie dont on connaît avec précision l'incidence: le Sida (syndrome d'immunodéficience acquise) qui, comme d'autres maladies infectieuses contagieuses, doit être déclaré à l'Office fédéral de la santé publique. Genève, à cet égard, a mauvaise mine. Fin janvier 1992, on y dénombrait 368 cas de Sida déclarés, soit 90,9 cas sur cent mille habitants, ce qui place le canton très largement en tête, pour la densité des malades (moyenne suisse: 34,3). Sur les 15.366 personnes séropositives recensées en Suisse à la même date, 2.697 étaient en outre des Genevois.
Non pourtant que les autorités sanitaires genevoises se désintéressent du problème. Depuis l'automne 1991, un BIPS (pour Bus itinérant de prévention du Sida) financé par le Canton et la Confédération, mais géré par le Groupe Sida Genève, stationne chaque soir dans divers points chauds de la ville avec, à son bord, deux professionnels (infirmier ou travailleur social) et un volontaire. Mission: établir le contact, de la manière la plus anonyme et la plus discrète, avec cette population à hauts risques que sont les toxicomanes, leur dispenser conseils, soins, adresses utiles, [p. 228] soutien. Procéder, enfin, à la distribution de préservatifs et à l'échange de seringues usagées (échange auquel consentent également de nombreuses pharmacies, à titre gratuit ou non). Par l'intermédiaire de ce bus, dont l'activité est soumise à évaluation de l'Office fédéral de la santé publique et s'exerce sous l'oeil vigilant de la police, soucieuse d'éviter tout rassemblement propice au trafic, la direction de la santé publique espère, d'autre part, toucher un nombre croissant de toxicomanes de façon à pouvoir leur offrir l'aide indispensable lorsque leur vient le désir de sortir de leur enfer.
L'Etat et les toxicomanes
Ajoutons qu'un Programme interinstitutionnel de prévention (PRIP) s'adresse, lui, aux plus menacés et aux plus marginaux d'entre les marginaux, soit les toxicomanes prostitués(es). Quatre travailleurs sociaux, détachés de leurs institutions respectives, parcourent les quartiers (boulevard Helvétique, place du Molard notamment) où on peut les trouver, afin de leur offrir les mêmes services que le bus mobile et de tenter d'enrayer la propagation du virus du Sida, pour eux-mêmes et pour leurs clients.
Quant à la toxicomanie elle-même, la canton de Genève ne se veut ni laxiste ni uniquement répressif. Face à l'échec, partout constaté, d'une politique purement répressive, les cantons tâtonnent pour tenter d'enrayer un phénomène qui non seulement clochardise et détruit un nombre croissant de jeunes vies, mais pousse à la délinquance et à la prostitution: sait-on en effet que le prix d'un gramme d'héroïne — dose quotidiennne d'un "accro" — varie entre 150 et 300 francs?
A Genève, le Conseil d'Etat a opté pour une politique fondée sur deux principes: le toxicomane qui est prêt à accepter le sevrage doit trouver les possibilités et les institutions qui l'aideront à se libérer de sa dépendance; le toxicomane qui n'est pas (encore) capable d'envisager un sevrage doit recevoir l'aide qui lui permettra de survivre. Dans ce cadre, trois seuils ont été définis: un seuil haut, offrant des programmes de sevrage et de réintégration, un seuil moyen offrant une prise en charge médico-psycho-sociale structurée, avec des objectifs thérapeutiques précis, avec distribution, sur prescription médicale, d'un produit de substitution (méthadone), un seuil bas, enfin, où il s'agit d'offrir aux drogués une aide médicale et sociale de base. Il serait souhaitable de compléter cette offre en donnant aux nombreux toxicomanes incarcérés en préventive, à Champ-Dollon, la possibilité de suivre une cure de sevrage dans une institution telle que le Tram.
[p. 229]
Causes et âges de mortalité
Parce qu'ils occupent le devant de la scène médiatique, des fléaux comme le Sida ou les toxicomanies illégales tendent à occulter d'autres phénomènes, bien plus importants par le nombre des personnes qu'ils concernent, mais sur lesquels il paraît bien plus difficile d'agir, tant en raison des intérêts économiques engagés qu'en raison d'attitudes culturelles lentes à évoluer. Nous voulons parler, le lecteur l'aura deviné, de ces toxicomanies légales que sont l'alcoolisme et le tabagisme, ainsi que de la violence accidentelle (route, travail et loisirs). Pour en mesurer l'ampleur, il faut, là encore, interroger les statistiques, singulièrement les tables de mortalité qui indiquent, avec une relative précision, de quoi meurent, et à quel âge, les Genevois.
Remarque préliminaire: ces tables de mortalité ne prennent en compte que les problèmes de santé se traduisant par un décès, prématuré ou non; les maladies chroniques, qui ne cessent de prendre de l'importance, n'y apparaissent pas. Leurs répercussions, tant individuelles (psychologiques et sociales) que collectives (socio-économiques) restent donc ignorées.
La première information d'importance révélée par l'examen de la mortalité, c'est l'extraordinaire gain de longévité acquis par la population genevoise depuis le début du siècle: en moyenne et à leur naissance les hommes ont aujourd'hui vingt-cinq ans de plus à vivre et les femmes vingt-huit ans. A noter que loin de se combler, l'écart entre l'espérance de vie des deux sexes se creuse, au bénéfice des femmes. Trois raisons paraissent rendre compte de la surmortalité masculine: les accidents (de circulation ou de loisirs), de même que les suicides frappent davantage de jeunes hommes que de jeunes femmes: il en va de même en ce qui concerne, à l'âge mûr, le cancer du poumon et les maladies cardio-vasculaires.
Sexes et âges confondus, on meurt, à Genève, au rythme de trois mille deux cents personnes par an environ. Mille deux cents décès sont imputables à l'ensemble des maladies de l'appareil circulatoire (cardio-vasculaires et cérébro-vasculaires), quelque neuf cent cinquante sont dus au cancer. Viennent ensuite les morts violentes: environ trois cent trente par an, dont un tiers par suicide, une cinquantaine suite à un accident de la route, près de cent cinquante suite à d'autres accidents. Les maladies de l'appareil respiratoire (grippe, pneumonie, bronchite, asthme) causent quelque cent cinquante décès par an, tandis que la cirrhose du foie emporte une cinquantaine de personnes et le diabète une quarantaine.
[p. 230]
Les années de vie perdues
Cette image du poids relatif des causes de mort change singulièrement lorsqu'on prend en compte l'âge auquel surviennent les décès. Si l'on établit, arbitrairement, la durée d'une vie normale à soixante-quinze ans, on peut comptabiliser les années de vie perdues en soustrayant l'âge au décès de 75. Ainsi un décès survenant à cinquante-cinq ans donne vingt années de vie perdues. Les statistiques fondées sur cette notion d'années de vie perdues font apparaître que l'impact des maladies cardio-vasculaires, dans la mesure où elles tuent à un âge avancé (les femmes surtout), n'est peut-être pas aussi important que le laisse supposer la fréquence des décès. Elles soulignent en revanche le lourd tribut payé au suicide et aux accidents.
Un comportement suicidaire
D'une manière générale, il a été établi qu'en Suisse 85% des décès survenant entre trente et soixante-cinq ans, décès que l'on définit comme prématurés, sont imputables à six causes majeures: cancers, maladies cardio-vasculaires, maladies de l'appareil respiratoire, cirrhose alcoolique, accidents et suicides. Dans ce groupe d'âge, l'incidence de ces six causes est le plus souvent liée aux principaux facteurs de risque que constituent l'usage de l'alcool et du tabac, sans parler d'autres aspects du mode de vie: alimentation, stress, [p. 231] manque d'exercice, pollution. Si l'on met de côté les problèmes (considérables) liés au vieillissement de la population, ces causes de décès représentent des souffrances et une mortalité en partie au moins évitables. Elles sont à l'origine d'une grande part des coûts de la santé. Si leurs manifestations constituent la charge principale des services de soins, la réduction de leur incidence est du ressort de la prévention, de la promotion de comportements et d'un environnement favorables à la santé. D'aucuns estiment qu'un système de santé qui concentrerait son action sur ces domaines exclusivement produirait la plus forte amélioration possible d'un niveau de santé déjà enviable.
Prévenir vaut mieux que guérir
En matière de prévention justement, Genève n'est pas en reste: doté d'une semi-remorque de onze mètres de long, d'un coût total de six cent mille francs, un bus baptisé "Santé 2000" sillonne désormais le Canton, en lieu et place de l'antique camion gris de radiophoto. Comme celui-ci, "Santé 2000" poursuivra la tâche de dépistage de la tuberculose, dont l'incidence à nouveau semble croître (trente et un cas en 1991), mais son action vise surtout la prévention des maladies cardio-vasculaires. On y mesurera donc le poids, la tension artérielle et le cholestérol sanguin, tous trois indicateurs d'une susceptibilité accrue aux maladies de l'appareil circulatoire. Le bus visitera d'abord les entreprises, mais stationnera également en ville les lundis et mardis et contrôlera, chaque année, mille personnes tirées au sort dans la population. Par ailleurs, la direction de la santé publique coordonne un vaste projet de dépistage du cancer du sein par mammographie, en collaboration avec les gynécologues et les radiologues privés. Comme cela s'est fait dans le canton de Vaud, toutes les femmes entre cinquante et soixante ans seront convoquées. Des études ont en effet montré qu'un dépistage systématique et régulier de cette population permettait de réduire de 30% la mortalité due au cancer du sein. Par ailleurs, les cantons de Vaud et de Genève préparent, en collaboration avec la Télévision romande, une série de douze spots télévisés contre le tabac et destiné au public adolescent. Signalons enfin que Genève participe, avec Montana, Davos, Wald (ZH), Payerne, Bâle et Lugano, à un vaste projet de recherche sur les rapports entre pollution et maladies respiratoires, sous l'égide du Fond national de la recherche scientifique. A noter que le responsable genevois de l'enquête s'arrache les cheveux: sur les deux mille cinq cents personnes choisies par [p. 232] l'ordinateur, moins de la moitié ont accepté de participer aux tests et de répondre au questionnaire. Une indifférence qu'on ne retrouve nulle part ailleurs...
"Ils ne mouraient pas tous mais tous étaient frappés"
Il est d'autre part assez étonnant de constater qu'au moment où l'on interroge les gens eux-mêmes, leurs soucis de santé se révèlent souvent fort éloignés des problèmes majeurs évoqués ci-dessus. Un sondage de 1987, portant sur un échantillon de mille Genevois âgés de quarante à soixante-cinq ans, a ainsi montré que sur 377 maladies citées, les plus fréquentes étaient les maladies de l'appareil locomoteur et ostéo-articulaire (rhumatismes) (26%), les maladies de l'appareil circulatoire (19,9%), les maladies et troubles mentaux (dépressions) (9,3%), les maladies de l'appareil digestif (9%).
Le coût de la santé
Le système de santé genevois et, avec lui, le système suisse et, au-delà, celui de tous les pays industrialisés riches, se caractérise par des coûts de plus en plus élevés confrontés à des ressources budgétaires de plus en plus limitées. Il faut donc rechercher une allocation optimale des ressources disponibles. A cet égard, mentionnons deux tentatives, pour l'instant encore dans l'oeuf: lancé par les chefs respectifs des départements vaudois et genevois de la santé, un projet de collaboration intercantonale, notamment entre les hôpitaux universitaires des deux cantons, dans certains domaines "pointus" et coûteux comme la greffe du foie ou la neuro-chirurgie. Pour gérer les ressources de la façon la plus rationnelle possible et pouvoir procéder à des analyses de type coût/bénéfice, il est par ailleurs nécessaire d'avoir une vision claire de l'état de santé de la population. D'où le second projet, qui vise à compléter les statistiques existantes par un système d'information fondé sur trois piliers: d'une part, la mise au point d'indicateurs de santé, éléments d'information simples, mais renvoyant à une réalité complexe. Ainsi, par exemple, des fractures du col du fémur (quatre cents environ par an à Genève), qu'on peut utiliser comme un indicateur des conditions de vie et de santé des personnes âgées; ou encore le taux des naissances prématurées et le taux des vaccinations, qui peuvent tous deux être utilisés comme indicateur [p. 233] des conditions de vie des femmes et des enfants, en même temps qu'ils peuvent renseigner sur le plus ou moins bon fonctionnement des services de soins (publics et privés).
Autres sources d'information, le recensement des cas peu fréquents, mais graves et donc lourds du point de vue de leur prise en charge: psychoses, démences, invalidité motrice grave, mongolisme; enfin les sondages ponctuels concernant une maladie ou une autre.
Des patients satisfaits de leur médecin
C'est justement au sondage qu'il faut recourir pour savoir ce que les Genevois eux-mêmes pensent de leur système de soins. Selon un sondage réalisé en 1991, à la demande de la Tribune de Genève, plus de 77% des Genevois s'affirment ainsi fort satisfaits de leur médecin traitant. Un peu plus de 3% se déclarent au contraire mécontents. La cote des spécialistes, avec 63% de satisfaits, est à peine moins brillante, mais il faut relever que si, dans l'échantillon sondé, neuf personnes sur cent n'avaient jamais mis les pieds chez un généraliste, elles étaient plus de 26% à n'avoir jamais recouru aux services d'un spécialiste. Les établissements hospitaliers publics, comme les cliniques privées recueillaient également de bons indices de satisfaction, quand bien même, et heureusement, une forte proportion des sondés n'avait jusqu'alors séjourné ni en clinique privée (57,2%) ni en hôpital public (37,6%).
Selon le même sondage, il apparaît que près de 33% des Genevois consultent un médecin au moins une fois l'an, que 18% le font deux fois et près de 30% se rendent trois fois chez le médecin. On peut imaginer qu'il s'agit là de la consommation médicale de gens en bonne en santé, les personnes malades rendant à leur médecin des visites bien plus fréquentes!
Et pourtant des exigences illimitées à l'égard du médecin
Nos arrière-grands-parents ne voyaient jamais un médecin. Etre en bonne santé voulait dire pour eux être capables de survivre aux maux qu'inévitablement la vie inflige. Ces maux — alors, il est vrai, le plus souvent sans remède —, ils les supportaient avec une équanimité dont les douillets que nous sommes seraient bien incapables. Il faut dire aussi qu'en moyenne, ils mouraient moins vieux que l'on ne meurt [p. 234] aujourd'hui. Pour l'homme contemporain, la santé n'est plus ce capital de vitalité qui doit lui permettre d'accomplir le parcours terrestre assigné par la Providence. Il la voit comme un état de bien-être, mesurable à tout moment, donc amendable à tout moment par le recours à l'homme de l'art ou à la substance idoine. Les consommateurs invétérés que nous sommes tendent à considérer les médicaments et les soins médicaux comme des biens et des services identiques aux autres, à cette différence près que leur coût réel nous est masqué par le système (aujourd'hui mal en point) d'assurances et de subventions. La santé, comme l'on dit, ça n'a pas de prix, mais, sommes-nous tentés de croire, cela s'achète. A preuve, l'auto-médication, c'est-à-dire la consommation de médicaments non prescrits, fortifiants, vitamines, calmants, anti-douleurs, potions magiques de toutes sortes, qui fait le bonheur des pharmaciens, en même temps qu'elle témoigne d'une sorte de vigilance inquiète. D'avoir été repoussée dans le temps, d'avoir été dans de nombreux domaines (que l'on songe par exemple aux maladies infectieuses) combattue avec succès par la médecine, la mort nous paraît plus inacceptable que jamais. D'où, sans doute, une angoisse profonde, dont les médecins se retrouvent dépositaires, en lieu et place du pasteur ou du prêtre.
[p. 235]
Une politique active de la santé
Riche d'un passé glorieux, de l'héritage de spécialistes que l'on venait consulter de fort loin, la médecine genevoise reste excellente. La qualité et la densité de l'offre médicale contribuent également au phénomène actuel de médicalisation de la santé. Or, il semble bien que cette médicalisation, qui absorbe pour l'heure l'essentiel des dépenses de santé, soit en train d'atteindre sa limite: les coûts ne sauraient augmenter davantage et ne peuvent plus guère améliorer la santé publique. Il est temps de rappeler ce que nous disions au début, à savoir que si une bonne médecine est indispensable pour traiter les maladies, elle n'est qu'un déterminant parmi d'autres de la santé des individus: le patrimoine biologique (inné et acquis), le genre de vie, l'environnement matériel, social, affectif, tels sont en effet les déterminants pour ainsi dire premiers de notre santé et qui ne sont pas du ressort de la médecine curative, mais des individus et de la collectivité.
La prévention des maladies, des accidents, des suicides, l'éducation à un mode de vie plus sain, devraient être, avec la protection de l'environnement, les concepts-clés de la politique de santé de demain, cela d'autant plus que nous devons nous préparer à un vieillisement démographique sans précédent. Sait-on ainsi qu'en Suisse les plus de 65 ans seront, en l'an 2025, 1,6 million (1 million en 1992) et qu'on devrait y compter plus de 500.000 octogénaires? Pour faire face aux besoins correspondants, il faudrait, avant cette date, doubler le nombre de lits d'hôpitaux et de homes. Seule alternative, le maintien au domicile. Il semblerait donc que la population genevoise ait fait le bon choix en adoptant la loi cantonale du 16 février 1992 sur l'aide et les soins à domicile. Cette loi, qui fait suite à une initiative populaire lancée en 1985, veut réorganiser et développer l'aide au domicile, en groupant les services privés existants — le Service d'aide et de soins communautaires de la Croix-Rouge, l'Aide ménagère au foyer et le Service d'aide familiale — dans des centres de quartiers et de communes. Une Commission cantonale de l'aide à domicile est chargée de veiller au bon fonctionnement du système. Date d'entrée eu vigueur de la loi: 1er janvier 1993; financement: une augmentation d'impôt d'un centime additionnel.
Est-il absurde d'imaginer qu'en adoptant cette loi, qu'en soulignant ainsi la prééminence du domicile face à l'hôpital, les Genevois aient pu vouloir manifester aussi l'amorce d'un changement d'attitude, le souhait de recouvrer, sur leur santé, un peu de la responsabilité et de la maîtrise perdues?
F. Bl.
haut
[p. 236]
Le sport à Genève
Le sport appartient aujourd'hui à la civilisation des loisirs, du moins dans une approche sommaire. Il n'en a pas toujours été de même. Autrefois, le concept de jeu, par exemple dans les Jeux Olympiques, possédait une connotation de sérieux, lié à l'honneur national ou civique, qui le cède aujourd'hui aux ambitions politiques et économiques. Toutefois, le but premier de la pratique du sport n'était pas de fouetter le sentiment national, ni de se distraire par le jeu, mais de développer harmonieusement le corps et les facultés physiques et psychomotrices des humains. Par le sport, l'homme devait être physiquement autonome, augmenter ses forces pour pouvoir se défendre et défendre la cité en cas d'attaque ou de guerre. L'émulation, la compétition sont un puissant ferment de ce développement et du progrès des exercices. C'est pourquoi les concours, les "jeux" dotés de prix, de signes honorifiques pour les vainqueurs ou d'autres distinctions, devinrent le lieu où les performances des athlètes furent encouragées, voire magnifiées, et devinrent une manifestation de l'honneur national et du chauvinisme. Des règles éthiques étaient là pour rappeler qu'il s'agissait d'un jeu et que les concurrents se mesuraient en toute amitié et loyauté.
Le Moyen Age a aussi connu des concours de tir à l'arc, de tir à l'arquebuse, les entraînements au Champ de Mars ou de Mai — époque où l'on réunissait tous les hommes en âge de porter les armes. Au XVIIIe siècle, l'abondance des documents permet de constater les progrès du sport dans les prescriptions médicales ou pédagogiques.
Ainsi, le fameux docteur Théodore Tronchin (1709-1781), dont on a conservé de nombreux textes de médecine et d'hygiène, préconisait le mouvement, l'exercice — même en cellule pour les nonnes — et pestait contre la vie sédentaire que menaient à son époque trop d'intellectuels. "Certainement, écrit-il en 1765, si Dieu avait fait l'homme pour le repos, notre corps tel qu'il est n'eût pas été fait avec sagesse, les veines auraient dû avoir une cause motrice qui leur fût propre. Or, puisqu'elles ne l'ont pas, ne sommes-nous pas en droit de conclure que la vie sédentaire n'est pas dans l'ordre de la nature?"
Quant à Jean-Jacques Rousseau, les exercices physiques font partie de l'éducation qu'il préconise pour son élève dans L'Emile: "Voulez-vous donc cultiver l'intelligence de votre élève, cultivez les forces qu'elle doit gouverner. Exercez continuellement son corps, rendez-le robuste et sain pour le rendre sage et raisonnable; qu'il travaille, qu'il agisse, qu'il courre, qu'il crie, qu'il soit toujours en mouvement, qu'il soit homme par la vigueur et bientôt il le sera par la raison".
[p. 237: image / p. 238]
Le phénomène sportif
Le sport apparaît tantôt comme un spectacle fascinant pour un public amateur de prouesses, tantôt comme une vaste entreprise financière où s'engagent des sommes faramineuses, tantôt aussi comme une occasion de détourner l'agressivité naturelle des peuples vers des activités pacifiques où la compétition tient lieu de stratégie, tantôt encore comme une occupation saine qui développe les facultés physiques et morales et constitue pour ceux qui s'y adonnent un facteur d'équilibre, tantôt enfin comme une activité de loisir qui relève du jeu et en possède les attraits.
Dans un volume consacré à l'art de vivre, c'est ce dernier aspect qui a surtout retenu notre attention.
Pourquoi pratiquer le sport?
Le sport, en tant que jeu, est avant tout manifestation de vitalité: un enfant, un adolescent, garçon ou fille, dans un terrain ouvert, dans un préau d'école, court, saute; s'il dispose d'un ballon, il s'exerce à le lancer à ses camarades. Il obéit à une sorte de besoin intérieur, inné ou acquis par l'éducation. Et puis très vite, il est gagné par l'esprit de compétition: arriver le premier au but, sauter plus haut, plus loin que ses compagnons, placer le ballon dans le but adverse. Vient un moment où il s'agit de se surpasser, où l'alpiniste cherche à vaincre une paroi de rocher, où le navigateur se mesure avec les éléments et où le risque se mêle au plaisir de la performance. [p. 239]
Toutes ces motivations se retrouvent, à des degrés divers, dans les différents sports dont il sera question plus loin. Même les "sports" guerriers, lorsqu'ils sont pratiqués sans contrainte, font intervenir un élément ludique. Les sports nautiques, le ski, l'alpinisme sont pour les Genevois une seconde nature, même si, sur les statistiques de l'armée, ils figurent parmi les moins bien entraînés des Suisses. Et si, pour lutter contre une "brioche" envahissante, les intellectuels et les employés de bureau se procurent un équipement de "jogging" ou de ski de fond, le plaisir n'est pas totalement absent de leur appétit de santé.
Les sports d'équipe joignent, à l'idéal de la forme physique, la culture de l'amitié, la loyauté à l'égard du groupe et contribuent, du moins le pense-t-on, à entretenir l'esprit civique. Il y a un entraînement collectif qui conduit à constituer des équipes locales, cantonales, nationales, portant l'honneur national.
C. S.
haut
Le sport est d'abord préparation à la guerre
Tout au long de son histoire, Genève s'est sentie menacée par son voisin savoyard. La préparation à la guerre était donc pour ses citoyens une impérieuse nécessité: marche, culture physique, entraînement au tir (à l'arbalète, à l'arc, à l'arquebuse, à la couleuvrine, au canon), escrime, équitation sont des sports à forte connotation militaire.
Mais peut-on parler de sport à propos de la marche et de la culture physique au Moyen Age et sous l'Ancien Régime? De même que M. Jourdain faisait de la prose sans le savoir, de même la vie quotidienne, jusqu'à la mécanisation des transports et du travail, comportait beaucoup d'efforts physiques. C'est le règne de la machine qui a entraîné, comme corollaire, la pratique du sport. La marche n'est plus une nécessité, elle est remplacée par les randonnées, le tourisme pédestre, le "jogging". Et l'on se rend dans des salles spéciales de musculation, de "body building", d'aérobic, de "fitness" pour donner au corps l'exercice qu'il ne fournit pas dans ses activités courantes.
[p. 240]
Le tir, une vieille tradition genevoise
Il a déjà été question, dans le tome II de cette Encyclopédie, pages 92 à 95, des sociétés de tir et des autres sociétés sportives du Canton, dont certaines sont très anciennes et qui contribuent à créer des liens, non seulement entre leurs membres, mais entre tous ceux d'une commune ou d'un quartier.
Flèches et fléchettes
La pratique du tir à l'arc remonte à l'antiquité. A Genève, la première mention de cet exercice dans les registres du Conseil date de 1460 et les désignations d'un Roi du tir à 1568, mais le célèbre retable de Conrad Witz, "La pêche miraculeuse", de 1444, montre des archers s'exerçant au Pré l'Evêque. C'est la date officielle à laquelle le Noble Exercice de l'Arc fait remonter sa création. Le percement de l'avenue Pictet-de-Rochemont l'oblige à émigrer et c'est dans la campagne Richemont, route de Chêne, qu'il se réunit depuis 1900, dans un hôtel de style XVIIIe siècle, entouré d'arbres majestueux.
Faisant parler de lui au XIVe siècle déjà, le tir à l'arbalète prend ses assises en 1520, entre la rue de Rive et le bord du [p. 241] lac. Il émigre au Pré l'Evêque trente-cinq ans plus tard, avant de se mettre, en 1556, à couvert, sur ce qui allait être la place des Volontaires.
Savoir faire parler la poudre
La Société des Exercices de l'Arquebuse voit le jour en 1474. Dès l'année suivante, il est ordonné "de chercher un lieu où arbalétriers et arquebusiers puissent s'entraîner". Ce lieu est désigné derrière l'école de Rive. Mais le 12 janvier 1515, Philibert Berthelier est chargé par le Conseil de choisir un terrain d'exercice pour les arquebusiers. Il le trouve à la Coulouvrenière, près de l'hôpital des pestiférés. Dans un quartier si marqué par sa destinée qu'il arbore aujourd'hui encore des noms de rues évocateurs: rue du Stand, rue de l'Arquebuse, rue de la Coulouvrenière, rue des Rois, rue du Tir.
En 1580, de nouveaux règlements sont imposés aux arquebusiers, contraints de s'exercer au tir "à bras franc, c'est-à-dire sans utiliser la fourchette de leur arme, autant pour les arquebuses à rouet qu'à serpentin".
Le tir au fusil
Au début du XVIe siècle, une centaine de jeunes de 11 à 15 ans se groupent et forment l'Exercice des Petits Volontaires, animés du désir d'apprendre à manier une arme pour défendre leur patrie. Ils sont suivis, en 1677, par leurs aînés, les Grands Volontaires, ou Exercice au Fusil, qui occupent, place des Volontaires, le local des arbalétriers, dont le corps a été dissous, et y construisent un stand de tir qui subsistera jusqu'à la fin da XVIIIe siècle.
En 1828, Genève accueille, après Aarau et Bâle, le troisième Tir fédéral sur la vaste prairie dite Pré de Vincy, où trône aujourd'hui la gare Cornavin. Fête grandiose qui réunit les sociétés de tir de toute la Suisse, elle se répète à Genève en 1851 et en 1887.
Fusion avec l'Exercice de la Navigation
Genève a entretenu, jusqu'au milieu du XIXe siècle, une flotte de combat assurant sa défense du côté du lac, d'où l'existence d'une société de tir nommée Exercice de la Navigation, qui pratiquait ce sport sur le Léman. En 1855, la [p. 242] flotte ayant été dissoute, la fusion est opérée entre les Exercices de l'Arquebuse et de la Navigation qui achètent, en 1878, le terrain de l'ancien prieuré de Saint-Georges. Le stand de Saint-Georges y est inauguré en 1895 et accueille, l'année suivante, le tir de l'Exposition nationale. On signale encore, de 1618 à 1782, un Exercice du Canon qui avait lieu à la Servette. Aujourd'hui, et depuis 1852, c'est à Carouge que se pratique le tir au canon.
Fier, fort, franc, frais
Tels sont les quatre F qui, aujourd'hui encore, désignent la gymnastique, enseignée à Genève dès 1823 par un Bavarois, Christian Rosenberg. Dans un élan patriotique inspiré par la Société d'étudiants de Zofingue, la Société fédérale de gymnastique est créée à Aarau, en 1832, et c'est pour les mêmes motifs que la Section genevoise de Zofingue fonde, en 1845, la Société de gymnastique de Genève, qui organise, en 1852, la troisième Fête fédérale de gymnastique. Quant à l'Association genevoise de gymnastique, qui groupe 26 sections locales, elle voit le jour en 1873, suivie, en 1923, de l'Association cantonale de gymnastique féminine.
La gymnastique plonge ses racines dans de très anciennes traditions, telles la Fête des bergers d'Unspunnen, qui date de 1805; elle s'est implantée en Suisse, on l'a vu, dans une atmosphère de ferveur patriotique, mais elle procède aussi, comme le tir, du souci de la défense nationale. C'est la seule discipline scolaire qui soit du ressort de la Confédération: [p. 243] la loi fédérale du 13 novembre 1874 sur l'organisation militaire rend l'enseignement de la gymnastique obligatoire dans toutes les écoles de garçons du pays. L'égalité des sexes, ce sera pour plus tard: bien que dès la fin du XIXe siècle, l'enseignement de la gymnastique ait été pratiqué dans les écoles de filles, il a fallu attendre l'article 27quinquies de la Constitution, adopté le 27 septembre 1970, pour que la Confédération soit autorisée à "rendre obligatoire l'enseignement de la gymnastique dans les écoles", sans distinction de sexe. En vertu de cette disposition constitutionnelle, la Confédération a pu légiférer dans le domaine du sport: la loi du 17 mars 1972 a créé l'institution Jeunesse et Sport qui, pour le canton de Genève, est gérée par le Service des loisirs de la jeunesse. Quant à l'Ecole fédérale de sport de Macolin, elle a été fondée, dans le cadre du Département militaire fédéral, en 1944.
Faut-il, dans un chapitre consacré au sport, mentionner la gymnastique rythmique de Jaques-Dalcroze? Il s'agit plutôt d'une discipline artistique proche de la danse, qui sera traitée dans le tome X de cette Encyclopédie.
L'athlétisme suisse né à Genève
C'est en 1892 que l'Athletic-Club carougeois et le Racing-Club Genève ont organisé la première course à pied: Genève — Préverenges et retour, soit 100 kilomètres. Depuis lors, il y eut bien d'autres courses, à commencer par la Course du Châble, autour du Salève, avant même le début du siècle et, dès 1978, la Course de l'Escalade, événement à la fois sportif, folklorique et festif qui bat tous les records d'affluence de ce genre de manifestations en Suisse. Ce sont en effet plus de 10.000 personnes qui parcourent les rues de la Vieille Ville, professionnels de classe internationale, amateurs de tous âges, groupes costumés, dans une atmosphère de fête où règne à la fois l'émulation et la bonne humeur.
Genève a même eu son champion du monde: en 1924, lors des Jeux olympiques de Paris, Joseph Imbach, du Club athlétique de Genève, remportait le 400 m en 48''1/4... mais ne conservait son titre que 24 heures!
De taille et d'estoc
La Société d'escrime de Genève a vu le jour le 17 mars 1862. Dès le début, les escrimeurs se sont inspirés des Grecs, les premiers à avoir réglementé ce sport. Leurs préceptes ont [p. 244] été interprétés de trois manières successives en Europe: entre 1531 et le milieu du XVIIe siècle, les auteurs incitent à frapper plutôt de taille que de pointe; dès le milieu du XVIIIe siècle, les coups de taille sont abandonnés au profit des coups de pointe, pied droit en avant; enfin, au XIXe siècle, le port du masque devient obligatoire et les assauts reproduisent fidèlement les combats passés.
Le cheval à la conquête de Genève
Monter à cheval était, jusqu'il y a peu, une nécessité dans l'armée. C'est devenu un sport, de plus en plus populaire (on compte actuellement dans le Canton 1.500 chevaux de selle et deux ou trois fois plus de cavaliers), qui fait l'objet de compétitions spectaculaires. Les courses de chevaux semblent avoir été introduites à Genève, par des touristes anglais, dès le XVIIIe siècle. Elles s'y implantèrent si bien qu'un champ de courses fut installé à Plan-les-Ouates en 1881, remplacé en 1902 par l'hippodrome des Charmilles qui dura jusqu'en 1934. Mais c'est surtout le Concours hippique international, aujourd'hui Concours de saut international de Genève, qui, dès 1926, attire à Genève l'élite des écuyers du monde entier. D'abord organisé au Palais des Expositions, à Plainpalais, il émigre à la Patinoire des Vernets, en 1975, pour s'installer, à partir de 1991, à Palexpo.
[p. 245]
Le sport est aussi une forme de jeu
Le sport est aussi, à Genève, l'un des aspects essentiels de l'art de vivre. Le lac invite à la baignade et à la navigation, les montagnes toutes proches à l'alpinisme et au ski, et ainsi se développe un esprit sportif qui se manifeste dans toutes les autres disciplines, qu'il s'agisse de sports individuels ou d'équipe. Cet attrait pour les exercices physiques ne date pas d'hier. Les habitants des "stations lacustres", dès 3.000 av. J.-C., éprouvaient comme nous le besoin de se plonger dans l'eau du lac lorsqu'il faisait chaud et utilisaient des embarcations creusées dans des troncs d'arbres pour naviguer et pêcher. Toutefois, on ne saurait parler de sport, en tant que divertissement, que comme l'une des manifestations de la civilisation des loisirs. Les classes aisées se sont adonnées, dès le XVIIIe siècle, à certains sports introduits par des visiteurs anglais, mais la généralisation des loisirs est récente. Il a fallu, d'une part que la durée du travail diminue, d'autre part que la rémunération de ce travail augmente. C'est pourquoi la pratique des sports remonte, dans la plupart des cas, à la fin du XIXe siècle.
Les sports nautiques
La natation est aussi ancienne que la marche, la chasse et la guerre. En été, par les grosses chaleurs, on se baigne, de préférence dans le Rhône et l'Arve, plus rafraîchissants que la lac. Jusqu'à la démolition des fortifications, vers 1850, les enfants se baignent dans les fossés qui communiquent avec le Rhône, entre la Coulouvrenière et la porte Neuve. Le 17 mai 1789, le Journal de Genève publie un appel de Merle d'Aubigné qui lance une souscription en faveur d'un établissement de bains aux Eaux-Vives. Le succès est tel que l'ouverture peut avoir lieu le 29 juin déjà, au Pré Mallet.
C'est en 1885, qu'une équipe de nageurs établit ses bases sur la rive droite du lac et crée le Stade helvétique, devenu aujourd'hui Genève-Natation. Quatre ans plus tard, à l'initiative de la Société genevoise d'utilité publique, les Bains de Genève s'établissent aux Pâquis. Mais la natation et la navigation, en se généralisant, sont causes d'accidents, si bien que cette même Société crée, en 1904, la Société de natation et de sauvetage; ses objectifs sont à la fois l'enseignement et les secours. [p. 246]
De son côté, la rive gauche s'équipe et se dote d'un Cercle des nageurs: après les Bains Brise-lames, mentionnés en 1890, Eaux-Vives-Plage s'installe en face de la Maison royale en 1916, puis Genève-Plage est inauguré au Port Noir, en 1932. Et, dernières étapes, les bains du Vengeron, qui datent de 1938, et la piscine olympique couverte des Vernets, mise en service le 22 novembre 1966.
Sport d'agrément et de compétition, la natation donne lieu, dès le début du siècle, à des championnats et des courses. La plus curieuse est sans doute la Coupe de Noël qui voit une cinquantaine de nageurs affronter l'eau glacée du Rhône, sous l'oeil stupéfait des badauds.
Le water-polo a eu ses heures de gloire: le Polo-Club de Genève a été champion suisse en 1928. Quant à la plongée sous-marine, elle connaît une vogue certaine parmi les jeunes.
Les voiles du Léman
Le lac se prête idéalement à la navigation à voile. Tantôt calme, avec de petites brises qui rident à peine la surface de l'eau, tantôt creusé par la brise ou la vaudaire, sujet aux brusques coups de joran qui vous surprennent lorsqu'on y pense le moins, il fait appel aux qualités des plus habiles navigateurs, dont les embarcations hérissent de leurs mâts les quais et les jetées, jusqu'à Hermance sur une rive et à Céligny sur l'autre.
C'est en 1872 que fut créée la Société Nautique de Genève, nommée tout d'abord Société de Navigation de Genève, et en 1933 qu'elle trouva son emplacement actuel.
La plus fameuse des régates est sans conteste le Bol d'Or. Couru pour la première fois en 1939, avec 26 bateaux au départ, il en compte aujourd'hui plus de 600. Il faut avoir assisté à un départ de cette course, avec cette multitude de voiliers de toutes dimensions et de tous styles entassés entre la Nautique et la Perle du lac, pour mesurer la place que tient à Genève la navigation à voile. Ce ne sont pas seulement les voiliers les plus rapides, susceptibles de remporter la victoire, qui se pressent au départ, mais une quantité de bateaux plus modestes, dont l'équipage est attiré par la perspective d'un joyeux tour du lac.
En 1940, le gagnant naviguait sur un 6m jauge internationale et parcourait la distance Genève — Bouveret et retour en 27h07'05". Les "Toucan" font leur apparition en 1971, avec un temps de 15h28'. Dès 1980, ce sont les multicoques qui occupent les premières places. En 1992, un catamaran a franchi la ligne d'arrivée après 10h50'02" de course. [p. 247: image / p. 248]
Un nouveau sport est apparu à Genève en 1974, venu de Californie: le Wind surf, ou planche à voile, qui compte chaque année plus d'adeptes. Exercice exigeant, qui suppose des qualités physiques accomplies, sans entraîner de gros frais, il s'adresse avant tout aux jeunes.
Des galères du duc de Savoie aux courses d'aviron
La navigation à rames n'a pas toujours été une occupation pacifique. Jusqu'au milieu du XIXe siècle, des chaînes barraient l'accès de la rade contre les incursions ennemies, car la Maison de Savoie entretenait des galères qui constituaient une menace permanente pour Genève.
Ce qui n'empêchait pas les amateurs de soleil et de grand air de se livrer au canotage, avec ou sans attirail de pêche. Lorsque ce type de navigation prend le nom d'aviron, il passe de la catégorie des passe-temps à celle du sport. La Section de l'aviron de la Société Nautique de Genève, créée en 1892, a inscrit à son palmarès un grand nombre de victoires, aussi bien à l'échelon national que mondial.
Comment ne pas être sensible à l'élégance d'un skiff qui glisse silencieusement sur l'eau ou au rythme puissant d'une équipe d'"outrigger" luttant jusqu'à l'extrême limite de ses forces?
Quant aux membres du Canoë-Club de Genève, créé en 1935, c'est dans les rapides de la Versoix qu'ils s'entraînent.
La navigation à moteur
A fin 1990, Genève comptait 2.728 bateaux à moteur, 3.164 bateaux à voile et 222 bateaux à rames. Les premiers vont des barques de pêcheurs, dont en entend à peine le doux murmure, aux monstres échappés des "marinas" de St-Tropez ou de la grande Motte et aux hors-bords de compétition.
C'est en 1901 que Genève s'éveille au motonautisme, par la création d'une Section hélice de l'Automobile Club de Suisse. Trois ans plus tard, la Section passe, avec armes et bagages, sous les couleurs de la Société Nautique de Genève.
Quant au ski nautique, il faudra attendre la fin de la Deuxième Guerre mondiale pour le voir prendre pied à Genève, avec panache puisque Marina Doria, future princesse de Savoie, sera 25 fois championne de Suisse, 12 d'Europe, 4 du monde, et remportera 3 médailles d'argent olympique.
[p. 249]
Des varappes du Salève aux sommets de l'Himalaya
Pour le commun des mortels, le Salève est une barrière qui cache les Alpes aux Genevois, à la rigueur un but de promenades dominicales, tandis que pour les grimpeurs, c'est un terrain d'exercice, une préparation aux grandes excursions dans le massif du Mont-Blanc et au-delà. Le mot même de varappe provient d'un lieu-dit sur la paroi du Salève. Chaque rocher a son nom, les difficultés en sont étalonnées et l'on acquiert, à cette école de grimpe, une force et une agilité qui permet de vaincre ensuite les pires difficultés des Aiguilles de Chamonix et des Dolomites.
La passion de la montagne remonte, à Genève, à Horace-Bénédict de Saussure qui, à partir de 1779, publie ses Voyages dans les Alpes, avant de gravir lui-même le Mont-Blanc, le 3 août 1787, un an après qu'il ait été conquis pour la première fois par Jacques Balmat et le Dr. Michel-Gabriel Paccard, pour y effectuer certaines expériences de physique (voir le tome VI de cette Encyclopédie, pages 136-137). Elle a été entretenue par le Club Alpin Suisse, dont la Section de Genève a été fondée en 1865, et par de nombreuses sociétés plus spécialisées, telles la Fédération montagnarde genevoise, l'Androsace, l'Allobrogia, le Club des grimpeurs, les Amis montagnards, l'Arole, le Piolet-Club, etc... Les alpinistes genevois se sont illustrés par des "premières" dans les Alpes, l'Himalaya, les Andes, partout où les sommets dépassent 4.000 mètres d'altitude.
Le Salève constitue aussi un merveilleux "tremplin" pour les amateurs de deltaplane et de parapente.
Enfin, le plus récent des sports de montagnes est le mountain bike ou vélo de montagne, qui permet, grâce à ses 18 vitesses, de gravir les chemins les plus escarpés.
Les sports d'hiver
Avant d'être un sport, le ski était utilisé, en Norvège, pour se déplacer sur la neige. Il a été introduit à Genève à la fin du XIXe siècle: en 1873, le pasteur Hagbart Kicer, de Christiania, envoie une paire de skis à Gustave Revilliod pour le remercier de l'accueil qui lui a été reservé à Genève. Il écrit le 10 février 1873: "... Je vous prie de m'excuser que je n'ai pas fait jusqu'ici ce que je vous ai promis, savoir de vous envoyer de Norvège quelque chose qui pourrait être utile aussi en Suisse. C'est pourqoi je vous envoie une paire de "ski", on les appelle ainsi chez nous. On les emploie pendant l'hiver, [p. 250: image / p. 251] quand les champs sont couverts de neige et ils sont très utiles pour marcher... C'est aussi, chez nous, un grand amusement pour les jeunes gens aves les skis de descendre les collines. On peut descendre une colline de cette manière assez vitement et quelquefois, on tombe dans la neige à plaisir des spectateurs... J'ai envoyé avec les ski (sic) un bâton qu'on use pour s'appuyer".
On ignore l'usage que Gustave Revilliod, alors âgé de 56 ans, a fait de ce cadeau. Ce n'est que vingt ans plus tard, en 1893, que Georges Thudicum, qui possède un institut à Pregny, et le Dr Weber-Bauler lancent réellement la pratique du ski à Genève, où le premier ski-club est fondé en 1902.
Aujourd'hui, par l'effet des classes de neige, des vacances d'hiver, des courses du jeudi et de fins de semaines, et grâce aux efforts des clubs de ski, rares sont les Genevois qui ne savent pas skier, qu'il s'agisse de ski alpin ou de ski de fond ou de randonnée. Les clubs de ski sont nombreux, mais le sport se pratique surtout à titre individuel, entre amis ou en famille.
Quand les étangs sont gelés
Genève entretient, depuis la Réforme, des relations étroites avec la Hollande. Tout porte à croire, par conséquent, que le patinage, sport répandu aux Pays-Bas au Xlle sièle déjà, s'est implanté de bonne heure à Genève. En 1714, Jacob Vernet, élève du Collège, prononce à Saint-Pierre, à l'occasion des promotions, un discours intitulé "Oratiuncula pro hiberno ludo quem Gallice vocant aller aux patins". Les étangs n'étaient pas rares, à Meyrin, à Rouelbau, sur les bords de l'Arve, à la Pallanterie, et les ruisseaux se prêtaient, les jours de grand froid, aux exploits des patineurs. On jouait même au hockey sur glace, dès 1884, sur ce qui est devenu la place des Nations, à Varembé.
Le patinage connaît une grande vogue dans les années 1880, en raison d'hivers particulièrement rigoureux. Il se crée une Association pour l'encouragement du patinage, avec la participation de la Société genevoise d'utilité publique, qui construit, en 1887, un "bassin de patinage" à Florisssant. Mais avec le réchauffement de l'atmosphère en ville, une patinoire naturelle est destinée à disparaître. C'est en 1957-58 qu'a été construite la patinoire artificielle des Vernets, seule installation de ce type existant actuellement à Genève.
Qui dit patinoire, dit "curling". Il se pratique à Genève depuis 1946 et le club de Genève compte des joueurs de classe internationale. [p. 252]
La luge et le bobsleigh ont aussi leurs adeptes. En 1906, a lieu la Coupe du Salève qui remporte, disent les chroniqueurs, un grand succès, la qualité de la neige étant excellente. Aujourd'hui, les compétitions se déroulent dans des "couloirs" de glace artificielle qui n'ont plus rien à voir avec les pistes de luge de cette époque.
Autres sports individuels
Genève n'est pas fermée à l'exercice d'autres sports, mais, n'étant pas spécifiquement genevois, ils nécessitent moins de commentaires.
On mentionnera d'abord le golf, qui a de très nombreux adeptes. Il se pratiquait à Onex, dès 1923, jusqu'à son installation dans la propriété de Bessinge, cinquante ans plus tard. Malheureusement le golf d'Onex, repris par la Ville, a été laissé à l'abandon et de très nombreux golfeurs en sont réduits à jouer à Divonne, Bonmont, Gland ou Bossey, faute de pouvoir utiliser les greens de Vandoeuvres.
Succédant au jeu de paume, pratiqué à Genève depuis le XVIlle siècle, le tennis a été introduit en Suisse, en 1885, par des joueurs britanniques. Il a rapidement trouvé à Genève un terrain d'élection. En 1903 déjà, le parc des Eaux-Vives abritait trois courts de tennis; le titre de champion suisse est revenu, pour les cinq premières années du siècle, au médecin genevois Georges Patry. Aujourd'hui, on suit avec passion les exploits d'un autre Genevois, Marc Rosset, qui s'est distingué aux Jeux olympiques de Barcelone, en août 1992. [p. 253]
Mais c'est surtout un sport pratiqué par plus de 20.000 amateurs, qui ont à leur disposition 400 courts de tennis publics et un grand nombre de courts privés.
Le badminton et le tennis de table ont eux aussi leurs adeptes. De plus, Genève compte, depuis 1948, un Squash Club qui réunit 600 membres. Ce sport, d'origine américaine, est de plus en plus prisé dans cette ville, où il est pratiqué par 1.500 personnes environ.
Quant aux autres jeux, tels que le croquet, le billard et la pétanque, ils ont, comme partout ailleurs, leurs amateurs.
La petite reine
Le cyclisme a eu ses heures de gloire à Genève. Fondé en 1869, le Vélo-club genevois fut un précurseur. On doit à Genève l'organisation du Tour du Léman, dès 1880, et la fondation de l'Union cycliste suisse, qui groupe la Suisse romande et le Tessin, en 1897. C'est le pendant du Schweizer Radfahrer Bund, créé en 1908. Genève se prête particulièrement bien à l'exercice de ce sport; relief relativement plat, routes de campagne ou de montagne adaptées à tous les goûts. On y compte 150 cyclistes de compétition et plusieurs dizaines de milliers de cyclistes amateurs. Au début, un vélodrome installé à Varembé servait aux essais des vélocipédistes. Il est remplacé en 1896, à l'occasion de l'Exposition nationale, par le vélodrome de la Jonction, auquel s'est substitué, en 1922, celui de Plan-les-Ouates, lui-même abandonné en 1967.
Le motocyclisme a ses fanatiques, émules de James Dean et des chevaliers du Moyen Age, adeptes d'une vie dangeureuse, qui chevauchent des machines terrifiantes et en retirent des sensations fortes. La Fédération motocycliste suisse a été fondée à Genève en 1914 et compte actuellement, dans cette ville, 1.372 membres. 300 d'entre eux participent à des compétitions. Mais ces nombres sont loin de représenter la totalité des motocyclistes genevois qui, d'après l'Annuaire statistique du canton de Genève, étaient 17.852 au 31 décembre 1990.
Aujourd'hui, l'Association pour des pistes cyclables (ASPIC) exerce une forte pression sur les autorités pour que les cyclistes puissent pratiquer leur sport sans risquer d'être écrasés par des automobilistes.
Quant au sport automobile, il a été très actif à Genève à l'époque des pionniers. L'Automobile Club Suisse a été fondé à Genève le 6 décembre 1898, peu après le première course automobile organisée en Suisse, Genève — Meillerie [p. 254] et retour; il se nomme alors Société d'encouragement pour le développement de l'automobile en Suisse. Il organise, en 1901, la première course de côte, Trélex — Saint-Cergue, et en 1905, la première exposition d'automobiles, ancêtre du Salon international de l'automobile, né en 1924. Aujourd'hui, ce sont les collectionneurs de voitures anciennes qui organisent un Rallye des Alpes de 2.800 km, réservé à leurs trésors.
Sports d'équipe
Chose curieuse, le premier sport d'équipe à s'être implanté à Genève fut le cricket, importé au XVIlle siècle par des touristes britanniques.
L'histoire du football genevois commence le 20 mars 1890, date qui marque la création du Servette FC par une poignée de jeunes qui décident, dans le préau de l'Ecole professionnelle, rue de la Prairie, de se constituer en équipe. Premier terrain, un pré entre la rue de la Poterie et le chemin Liotard, près de l'actuel parc Geisendorf. La concurence ne tarde guère à se manifester sur l'autre rive du lac: des gosses des Eaux-Vives aperçoivent dans le ciel un ballon portant l'inscription "Urania" — il participait vraisemblablement à une démonstration à l'occasion de l'Exposition nationale de 1896 — et fondent le club rival: Urania Genève Sport, qui sera vainqueur de la coupe suisse de 1929, tandis que le Servette se couvrait de gloire dans les années 1918-1950. [p. 255] Le championnat genevois démarre en 1897, deux ans après la fondation de l'Association suisse de football. Y participent l'Union athlétique de Genève, Champel FC, Olympia, Helvétique, l'Athlétic-Club de Carouge, Stellula, le FC Genève, et bien entendu le Servette FC et l'UGS. Un peu partout, des clubs se fondent dans le Canton: Chênois en 1907, Vernier en 1908, Saint-Jean en 1910, Plainpalais en 1915, Meyrin en 1916; Etoile-Carouge, qui sera champion genevois en 1929 et en 1932, résulte de la fusion de trois clubs au lendemain de la Première Guerre mondiale.
Voici comment Georges Haldas vit le phénomène du football dans son livre La légende du football: "Tout est comme si rien n'avait été. Comme si, gosse, il se rendait pour la première fois à un match. Et voici de nouveau qu'il ne pense plus au travail, à la famille, aux emmerdements. Les moindres choses ont soudain la grâce lumineuse qui devait être celle du monde au septième jour de la création. Et quand la foule sera venue, que le stade sera bondé, avec son charivari habituel, ses remous, son attente fiévreuse, c'est avec la même émotion juvénile qu'il verra, le moment venu, apparaître sur le terrain, dans une effervescence indescriptible, le onze tout frais des Rouges et celui de la grande équipe étrangère. Et l'arbitre, l'homme en noir, avec un ballon blanc. Virginal. Tout match, sur le point de commencer, ouvrant sur l'inconnu, est un matin du monde. Un ciel nouveau qui fait comme descendre sur chacun une eau lustrale. Et je le déclare ici posément: quiconque n'a pas vécu cela, ne peut rien saisir de ce qui se passe à l'intérieur du stade. Ni comprendre «ce qu'on peut bien trouver à une partie de foot-ball»... l'amateur de football, en dépit de toutes les déceptions et déconvenues dues au pourrissement du spectacle, aujourd'hui, à la corruption, aux trafics éhontés autour du «transfert» de certains joueurs, se retrouve, à chaque fois, dans l'arène, avant une rencontre «sensationnelle», comme un enfant. Cet enfant qui subsiste en lui malgré tout, pour le meilleur et pour le pire: l'enthousiasme naïf — sans bienveillance aucune d'ailleurs — et la cruauté."
Genève berceau européen du basketball
Le football n'est pas le seul sport-spectacle, mais il est celui qui constitue, au XXe siècle, un véritable fait de société. On ne parle plus guère de handball ni de hockey sur terre, qui se disputaient un temps les faveurs du public. Le rugby n'est pas très joué à Genève, bien que selon la tradition, il y ait précédé le football. En revanche, le basketball jouit dans cette ville [p. 256] d'un solide prestige, peut-être parce qu'elle a été le berceau européen de ce sport. En effet, c'est l'YMCA, Union chrétienne de jeunes gens qui, en 1928, l'a introduit à Genève, venant des Etats-Unis. L'année suivante était fondée l'Association cantonale genevoise de basketball, suivie la même année de la Ligue suisse de basketball amateur. On compte actuellement 200 installations de basketball à Genève, 2.500 joueurs réguliers et environ 10.000 amateurs, et la coupe suisse prend bien souvent le chemin du Canton.
Plus récemment, en 1955, le volley-ball a fait son apparition à Genève; il y est très apprécié et réunit 3.000 joueurs environ.
On trouve encore, à Genève, un Rink-Hockey Club, ou hockey sur patins à roulettes, créé en 1939, qui compte à son palmarès de très nombreux titres de champion junior et senior, y compris quatre coupes suisses. De plus, Genève abrite une équipe de football américain, le Geneva Seahawks, fondé en 1985, et un club de baseball, le Hound Dogs Base-ball Club Geneva, qui date de 1986.
Il convient, enfin, de mentionner la Fédération sportive suisse SATUS, organisation corporative de sport populaire céée en 1874, en vue de promouvoir tous les sports, spécialement dans la jeunesse. Elle compte, en Suisse, 645 clubs, 54.000 membres et publie un hebdomadaire Satus-Sport, tiré à près de 20.000 exemplaires.
[p. 257]
Pour conclure
En se popularisant, les pratiques sportives ont en général amélioré l'état sanitaire de la population. Le ski en fin de semaine, le football, le tennis ont vidé les bistrots. Plus d'ivrognes zigzagant sur les routes le dimanche soir. Mais le sport n'est pas toujours innocent: les défenseurs de l'environnement s'en prennent aux terrains de golf qui portent atteinte à la nature, au ski hors piste et au ski de fond et même à l'alpinisme qui constitueraient un danger pour la faune. Puis les accidents de sport, les coups de pied que l'on reçoit, les chutes parfois mortelles à ski grèvent les assurances-accident, dont les primes sont calculées en conséquence et contribuent à ruiner les clubs.
Les commentaires qui précèdent sur les différents sports pratiqués par des Genevois se sont concentrés sur le sport-loisir, le sport amateur. Il a malheureusement tendance, dans notre civilisation de loisirs, à céder la place au professionnalisme et à perdre ainsi son caractère ludique et gratuit.
Les émissions sportives, à la télévision, intéressent de très nombreux spectateurs, mais nécessitent des investissements substantiels; les professionnels du sport savent que l'excellence s'obtient par un effort prolongé, ne dure que peu d'années et mérite de ce fait des sacrifices financiers de la part de ceux qui entendent les exploiter. Ainsi l'argent a pris une importance croissante dans les jeux du stade: il fausse les rapports entre acteurs et spectateurs et fait peser sur le sport, en général, un arrière-goût de scandale, aggravé par les révélations périodiques des médias sur le dopage de certains champions.
Que ces aspects négatifs ne fassent pas oublier les bienfaits du sport amateur, élément de santé et d'équilibre lorsqu'il est pratiqué raisonnablement.
J. de S.
haut
[p. 258: image / p. 259]
L'habillement
Se couvrir et paraître
Pourquoi s'habille-t-on? Pour se protéger du froid, des intempéries et des ardeurs du soleil, répond la sagesse populaire. Et pourtant. A ne définir le vêtement que par sa fonction utilitaire, on risque de passer à côté de sa dimension essentielle, qui est sociale et symbolique. Soulignant l'importance, insuffisamment reconnue à ses yeux, des tailleurs et des couturières, Balzac écrivait, en 1830: "Qui dit homme, dans la civilisation, dit homme habillé; l'homme sorti nu des mains de la nature est inachevé, pour l'ordre des choses où nous vivons". Et de poursuivre, en lançant dans son Traité de la vie élégante: "Voilà l'habit frais du dandy, l'elbeuf du rentier, la redingote courte du courtier marron, le frac à boutons d'or sablé du Lyonnais arriéré, ou le spencer crasseux d'un avare".
S'habiller est donc un acte à deux facettes, indissociables l'une de l'autre: se couvrir et transmettre une apparence sociale. Jusqu'à la fin du Moyen Age, cette apparence est l'exact reflet de son rang et de sa condition. Avec le déclin de la féodalité et la montée de la bourgeoisie, on assiste aux prémices d'une mise en question des codes et des hiérarchies vestimentaires que le phénomène de la mode — Haute couture, puis confection et prêt-à-porter — va achever de brouiller. A l'habillement minutieusement et strictement réglementé des sociétés traditionnelles s'opposent ainsi les multiples et subtiles nuances individualisées du vêtement moderne.
La mode est donc beaucoup plus que l'institution futile et frivole à laquelle on l'assimile souvent. En permettant cette personnalisation des apparences qui trouve son aboutissement dans la société occidentale d'aujourd'hui, elle a été, au-delà de sa versatilité, de ses excès et de ses outrances mêmes, un instrument essentiel de la montée de l'individualisme et de l'essor de la modernité.
Les Ordonnances somptuaires
L'austérité des moeurs, liée à une modestie vestimentaire et à une pingrerie qui serait quasi naturelle, font partie des stéréotypes les plus fréquemment évoqués de l'identité genevoise. D'aucuns y voient la marque exclusive de Calvin, auquel ils attribuent l'invention des Ordonnances somptuaires visant à limiter et à réglementer les dépenses des particuliers dans les domaines de la table et de l'habillement. C'est aller un peu vite en besogne. Si, durant tout l'Ancien [p. 260] Régime, la vie matérielle des Genevois a bien été l'objet d'une préoccupation majeure de la part des pasteurs et des autorités en place, le cas genevois n'est ni unique ni même le premier. De nombreux pays ont en effet devancé la petite République en promulgant des lois pour restreindre les dépenses quand la situation économique l'exigeait ou quand on estimait que le déploiement du luxe portait atteinte aux bonnes moeurs. Dès l'Antiquité, des édits somptuaires sont promulgués en Grèce et à Rome. L'Empire d'Occident en publie sous le règne de Charlemagne, l'Allemagne et l'Angleterre au XIVe siècle, et certains cantons suisses, comme Berne, précèdent Genève en la matière de plusieurs décennies.
L'exemple de la Cité de Calvin
Il n'en reste pas moins que, par rapport aux mesures prises dans d'autres Etats, les ordonnances genevoises constituent, tant sur le plan de leur durée — elles seront maintenues jusqu'à la Révolution — que sur celui de la volonté et de la détermination des autorités à les faire respecter, un exemple inégalé. De là vient sans doute le fait qu'elles ont pris une telle importance devant la postérité. Dans son Histoire du luxe, H. Baudrillart constate qu'à la différence de nombreux pays où, à peine un édit est publié, on trouve immédiatement les moyens d'en éluder les dispositions, "seul le petit Etat de Genève conserva l'empreinte de l'esprit et du caractère de Calvin". En dépit d'innombrables difficultés d'application, les lois genevoises constitueront de fait, et durant des décennies, un cas suffisamment remarquable et remarqué pour servir de modèle de base à d'autres villes: les ministres de l'Eglise de Metz demanderont ainsi à leurs homologues genevois des conseils sur la façon de procéder. Ils seront suivis par les pasteurs de Schaffhouse, qui réclameront une copie des ordonnances genevoises en vue d'en promulguer de semblables dans leur cité.
1558, 1564: deux dates charnière
Faute de documents, il est très difficile de déterminer précisément à quelle date les lois somptuaires proprement dites ont été publiées à Genève. Les historiens retiennent néanmoins l'année 1558 comme étant marquée de la volonté très nette de la Compagnie des pasteurs d'accentuer la lutte contre le luxe et les dépenses excessives (cf. le tome V de cette Encyclopédie, p. 133). Certes, dès l'établissement de la [p. 261] Réforme en 1536, les ministres firent pression sur le Petit Conseil pour qu'il s'occupât d'amender les moeurs et la vie spirituelle de la population. En adhérant à la Réforme, les Genevois avaient accepté de vivre selon l'idéal d'un Etat chrétien, soumis à la seule autorité de Dieu. Dans ses sermons, Calvin ne manquait pas de fustiger "ceux qui cherchent accoustremens nouveaux et estranges et qui appettent toute nouveauté". La façon de se vêtir, prêchait-il, témoigne de nos sentiments envers Dieu. Il faut s'habiller pour se protéger du chaud et du froid et non pour se "déguiser", en s'affublant de toutes ces "superfluitez", dont le seul but est d'attirer le regard et l'envie d'autrui. Reste que les premières réglementations concernant les pratiques vestimentaires étaient intégrées dans le cadre général des ordonnances de police qui faisaient l'objet de proclamations sur les places publiques, interdisant notamment l'adultère, les mascarades et tout divertissement susceptible de provoquer la débauche. Du fait de leur relative imprécision, elles ne furent que peu appliquées.
Ville refuge dès la Réforme, Genève voit sa population augmenter considérablement en quelques années. L'arrivée de ces réfugiés qui, tout en étant de "pauvres affligés" fuyant les persécutions, n'en amènent pas moins ces "superfluitez" tant redoutées, serait-elle, en 1558, à l'origine d'un durcissement du Consistoire? Le fait est en tout cas que cette période est marquée par un essor du luxe suffisamment important pour qu'il constate que "les excès [...] tant en habitz que ès banquetz et viandes", non seulement "augmentent de jour en jour", mais résistent aux remontrances, et qu'il intervienne auprès du Petit Conseil pour qu'un remède soit rapidement apporté à ces abus. Le 11 octobre, une commission composée de ministres et de membres de ce même Petit Conseil publie, sous l'appellation de "Cries des habits et banquets", un édit dans lequel on défend tout port de "vertugales, doreures sus testes, coiffes d'or, chaînes d'or et d'argent, brodeures sus manchons et généralement tous excès en habitz, tant d'hommes que de femmes". Pour la première fois, on entre donc dans certains détails vestimentaires. Mais pas suffisamment encore, semble-t-il, pour que les Genevois se plient aux règlements. Le 8 juin 1564, soit quelques jours après la mort de Calvin, survenue le 25 mai, le Petit Conseil et le Conseil des Deux-Cents promulguent une nouvelle ordonnance qui ne s'occupe, cette fois, que de l'habillement, laissant de côté les banquets qui, deux ans plus tard, feront l'objet d'une loi spécifique. Dans ses applications pratiques, la politique somptuaire genevoise est donc davantage l'oeuvre de Théodore de Bèze que celle de Calvin. [p. 262]
Les Ordonnances somptuaires de 1564 serviront de modèle de base à toutes celles qui seront publiées par la suite. Tissus, fabrication et façons, ornements, accessoires, coiffure, maquillage, bijoux, vêtements de cérémonies (mariage, baptême, deuil), mais aussi équipages et livrées, seront ainsi, et jusqu'à la Révolution, l'objet de réglementations minutieuses et de sanctions précises envers les contrevenants. A chaque révision (on en compte vingt-six entre 1558 et 1747, puis deux à la fin du XVIIIe siècle, en 1772 et 1785), on tente de s'adapter aux nouveautés de la mode, en particulier à celles qui viennent de la France voisine.
La Chambre de la Réformation
On a vu que, dès la Réforme, le Consistoire intervient à intervalles réguliers auprès des autorités politiques pour dénoncer des dépenses excessives. Ce tribunal de moeurs, créé au XVIe siècle par Calvin, est composé de pasteurs et de laïcs. Il a pour double fonction de maintenir la pureté de la doctrine dans une stricte orthodoxie (invoquer, par exemple, le nom des saints est assimilé au blasphème) et de soumettre la vie matérielle des Genevois à une sévère discipline. Le Consistoire convoque, réprimande, voire exclut de la Cène ceux qui, par leur comportement, font preuve de moeurs relâchées. Il semble pourtant que, dans le domaine spécifique de l'habillement qui nous intéresse ici, son rôle se soit surtout limité à "faire remontrances" auprès du gouvernement, lui enjoignant de renforcer son propre contrôle.
En 1646, à la suite d'une "remontrance" particulièrement vive du Consistoire, le Petit Conseil décide de créer une Chambre de la Réformation, (appelée Chambre de la Réforme dès 1724) qui sera chargée de veiller au respect des lois somptuaires. Ce tribunal pénal, entièrement laïc et devant lequel les contrevenants aux ordonnances devront désormais comparaître, est composé à l'origine de sept membres issus du pouvoir oligarchique: trois appartiennent au Conseil des Deux-Cents et quatre au Petit Conseil. S'y ajoutent un officier de justice et un secrétaire chargé du procès-verbal des séances. Ils décident de se réunir une fois par semaine à la Maison de Ville, dans le but d'établir, sur la base de leur propres observations et des éventuelles dénonciations des officiers de police, des pasteurs ou des particuliers, la liste des personnes qui, ayant enfreint les ordonnances, devront se présenter au cours de séances tenues à huis clos. Après avoir relevé le nom et parfois l'activité professionnelle de l'inculpé, les membres de la Chambre écoutent ses excuses [p. 263: image / p. 264] ou ses justifications et prononcent alors la sentence sous forme d'avertissements, d'amendes, voire, dans certains cas, de quelques jours d'emprisonnement. "Jamais on en viendroit à bout et il faudroit venir jusques à une esplingue", avait prévu Calvin. La tâche se révélera en effet quasiment insurmontable. Moins, comme le pensait le Réformateur, du fait de cette "cupidité féminine" qui pousse la femme à se parer et qui fait d'elle "une beste enragée", qu'à cause des ambiguïtés inhérentes aux lois somptuaires elles-mêmes, puisque ceux qui seront chargés de les faire respecter se verront fréquemment contraints de poursuivre leurs propres parents et amis. Et puis, comment résister concrètement à toutes ces nouveautés vestimentaires qui affluent de la France toute proche?
L'engouement pour les paniers
Le combat que la Chambre mena, au XVIIIe siècle, contre la mode nouvelle des "juppes de baleines et paniers" est exemplaire des ambiguïtés et de l'impuissance de la politique somptuaire genevoise. Dès le début du siècle, la banque et le négoce amènent la prospérité dans la petite République et les Genevoises sont alors très sensibles à la nouvelle mode française des jupes à large circonférence qui exigent une grande quantité de tissu. Le 20 janvier 1727, la Chambre de la Réforme délibère sur "la largeur excessive et l'enflure des paniers et juppes de baleines des femmes" et décide de les proscrire dans les temples. Deux ans plus tard, face à un goût toujours plus marqué pour cette mode et afin d'être plus efficace dans son combat, elle décide de fixer la largeur des jupes à "2 aunes de Genève de circonférence" (environ 2,37 m.) et d'interdire en ville les "juppes de baleine" confectionnées à l'étranger. Rien n'y fait: l'engouement pour ce type de vêtement prend toujours plus d'ampleur et les jupes suivent le même mouvement. Certains membres de la Chambre font alors remarquer qu'il est impossible de supprimer entièrement la mode des paniers, d'autant que les "juppes à timbales, aussi enflées dans le haut que dans le bas" viennent de faire leur apparition. Genève étant dans le voisinage immédiat de la France, ce serait "mettre les dames dans un équipage ridicule" que d'interdire a priori toute forme d'ajustement. D'autres rétorquent que précisément, "ce voisinage ne doit point authoriser a en adopter toutes les modes" et qu'il "doit, au contraire, tenir [les Genevoises] en garde contre leur introduction". Ils remarquent, en outre, que les paniers prennent une place toujours plus considérable dans les [p. 265] temples. A l'immodestie et aux dépenses excessives s'ajoute donc l'indécence "qu'il y a de voir relever ces juppes a droitte et a gauche pour les enfiler avec peine dans les passages des bancs des Temples". L'argument a dû porter, puisque, aux dames de haute qualité, on demande de modérer la largeur de leurs robes, tandis qu'on interdit aux personnes de médiocre condition, et notamment à toutes les servantes, de porter des paniers "quels qu'ils soient, même s'ils ont été donnés par leur maîtresse". En 1737, la Chambre constatera, une fois de plus, que "les femmes ne mettent aucunes bornes à la grandeur de leurs paniers, et que cet abus se repend sur les personnes d'une qualité inférieure et sur les domestiques". En dépit des sévères remontrances et des amendes, celles-ci multiplient, en effet, les subterfuges pour faire gonfler leur robe!
Du combat religieux à la lutte politique
Au-delà de ses ambiguïtés et de sa totale inefficacité, le combat contre la mode des paniers révèle bien l'évolution de la politique somptuaire genevoise. Fondée au départ sur des motivations essentiellement religieuses et morales (la modestie des apparences ne constitue-t-elle pas l'un des signes les plus visibles de cette Genève "cité de Dieu" qu'il s'agit d'édifier?), la lutte contre le luxe prend, avec l'essor économique, un tour toujours plus politique et social, marqué par la volonté de maintenir coûte que coûte une société figée dans une étroite hiérarchie des conditions. "Sous l'Ancien Régime, remarque l'historienne Corinne Walker, la ville est un théâtre dans lequel fonctionnent toute une série de signes distinctifs, reflets de la visibilité d'un ordre social stable et strictement hiérarchisé où la valeur de chaque individu doit s'affirmer par son appartenance de classe et non par sa capacité de dépense; avec l'essor du luxe, l'ordre des signes est perturbé et la valeur exhibée n'est plus l'être mais l'avoir. Aussi une des principales fonctions des ordonnances somptuaires fut-elle de limiter les comportements mimétiques de chacun dans une hiérarchie immobile et codifiée, [...] en affirmant au gré de chaque nouvelle publication, la distinction entre ceux de haute, de médiocre et de basse qualité, sans que ces catégories ne soient jamais explicitement définies, sauf dans le cas des domestiques qu'on précise être de basse qualité..."
Les excuses et prétextes avancés à la Chambre par les contrevenants aux lois somptuaires révèlent, beaucoup mieux que n'importe quel discours, les bouleversements de l'ordre social qui s'annoncent. Ainsi ce jeune homme, fils d'un [p. 266] membre du Conseil des Deux-Cents à qui la Chambre de la Réforme défend le port d'un cordon d'or à son chapeau et de boutons d'argent à son manteau, et qui rétorque qu'en tant qu'écuyer qui fréquente la noblesse étrangère, il passera outre. Son "irrévérence" et sa résistance acharnée aux injonctions de la Chambre lui vaudront 25 écus d'amende et une condamnation à la prison. Et ce mari dont la femme a été condamnée à une amende de 15 florins pour avoir porté des vêtements défendus aux personnes de sa condition et qui proclame haut et fort que, sauf ces Messieurs du Conseil d'Etat, il est d'aussi haute qualité que n'importe qui en ville. Une amende de 25 florins aura finalement raison de ses prétentions. Ou cette veuve d'un cardeur de soie condamnée à une amende de 60 sols pour avoir porté une coiffe interdite aux personnes de sa qualité et qui en rachète immédiatement une autre, en précisant qu'elle ne méprise pas les lois, mais qu'elle tient "seulement se maintenir belle et honneste".
La "distinction" du vêtement bourgeois
La lutte contre les hiérarchies par le brouillage des apparences vestimentaires ne cessera de s'intensifier au cours du XVIIIe siècle. Le phénomène est général en Europe: institution au départ purement mondaine et de cour, la mode suit la montée de la bourgeoisie qui cherche d'abord à copier la noblesse, avant d'instaurer ses propres normes du paraître. A la fin du siècle, il est déjà plus difficile d'identifier au premier coup d'oeil l'appartenance sociale au type de vêtements. "Sous l'ancien régime, constate Balzac, on reconnaissait à l'habit le seigneur, le bourgeois, l'artisan. [...] Enfin, les Français devinrent tous égaux dans leurs droits, et aussi dans leur toilette, et la différence dans l'étoffe ou la coupe des habits ne distingua plus les conditions".
La révolution du paraître atteint d'abord le costume masculin qui, par la suppression des couleurs et des ornements, se différencie désormais radicalement du vêtement féminin. Philippe Perrot, qui a examiné à la loupe "Les dessus et les dessous de la bougeoisie", remarque qu'en "se substituant à la multiplicité des habillements d'autrefois, le costume bourgeois intègre, par-delà son uniformité apparente, une dimension où surgissent de plus subtiles différences, où se révèlent et se cultivent d'inédites qualités". A la "grâce" et au "bel air" d'antan succède la "distinction", cette manière nouvelle de paraître qui ne doit sa valeur ni à la naissance, ni même à la richesse, mais tout au "savoir vivre", aux "bons usages" et à ses multiples et délicates nuances.
[p. 267: image / p. 268]
Le costume folklorique genevois
Tous ceux qui voient dans le port du costume folklorique genevois un attachement à une manière ancestrale et authentique de se vêtir devront déchanter. Non seulement ce costume est composé d'un ensemble d'éléments vestimentaires d'origines différentes (ce qui est d'ailleurs le propre de la plupart des vêtements régionaux traditionnels), mais encore son aspect actuel a été l'objet d'une complète et tardive reconstitution. Il faut en effet attendre 1930 pour que les Genevois, chargés d'organiser la première Fête fédérale des costumes prévue pour l'automne de l'année suivante, se préoccupent de jeter les bases d'une tenue "typiquement genevoise".
Bien entendu, il existait auparavant un costume genevois. Dans un article qu'il rédige, en 1937, pour l'Almanach du Vieux Genève, Marc Odier en situe même l'origine précise à l'année 1820. Mettant en parallèle le contexte historique de la Restauration et une forme vestimentaire spécifique, il constate dans un lyrisme militant: "Vous pouvez vous rendre compte combien national est notre costume. [...] Il évoque avec bonheur l'aspect riant de notre territoire, les teintes chaudes de nos horizons. [...] Il est en somme un produit de la campagne genevoise et de notre indépendance reconquise". Dès la fin du XIXe siècle pourtant, et à l'instar de la plupart des costumes régionaux de Suisse, le costume genevois tombe complètement dans l'oubli, au point d'ailleurs de ne même plus figurer dans les recueils de costumes des 22 cantons publiés à cette époque.
En 1930 donc, les Genevois reprennent les choses en main. La soeur d'Emile Jaques-Dalcroze fonde une Association du costume genevois. Le peintre Edouard Baud est chargé d'en réaliser la maquette. On se penche alors sur les documents et les archives, en privilégiant le début du XIXe siècle qui voit à la fois la Restauration et l'entrée de Genève dans la Confédération. Les tableaux de Adam-Wolfgang Tôpffer (1766-1847) représentant différentes scènes de la vie genevoise (marchés, noces et fêtes villageoises) sont examinés à la loupe. Le costume de campagne et des jours ordinaires — en général une robe simple à petits carreaux (soit bleus et blancs, soit bruns et blancs) au corsage croisé, protégée d'un tablier rayé et réchauffée d'un châle de laine tissé et non brodé — s'inspire ainsi directement de la "Vendangeuse" de Tôpffer. Pour les costumes de ville et du dimanche, on observe également avec attention les peintures des nombreux petits maîtres représentant des élégantes vêtues de la robe Empire à taille haute, très en vogue au début du XIXe siècle, et on étudie les documents relatifs aux indiennes, dans le but de recréer ces cotonnades aux tons pastel et aux impressions de fleurs ou de ramages qui ont fait la renommée de l'industrie genevoise. Un grand chapeau de paille, sous lequel on aperçoit une coiffe blanche bordée d'une ruche, ainsi qu'un fichu imprimé ou brodé, forment ainsi les caractéristiques principales du costume féminin du dimanche. Quant aux costumes masculins, on s'efforce surtout de les accorder aux différentes tenues féminines, en privilégiant les pantalons longs à fines rayures, la redingote de drap foncé (pour le dimanche), le gilet de soie, fantaisie ou rayée, ainsi qu'un grand chapeau de feutre souple pour compléter l'ensemble.
[p. 269]
La Fédération cantonale du costume genevois
En 1933, l'Association du costume genevois se scinde en quatre groupes folkloriques différents qui décident de fonder la Fédération cantonale du costume genevois. La Fédération compte aujourd'hui 19 groupes distincts. Certains n'ont pas d'autre activité que celle de porter le costume aux grandes occasions. D'autres groupes, tels "Genève chante", "Notre Genève" ou "La Colombière", mettent l'accent sur la chorale ou sur la danse, à l'exemple de "L'Onésienne", de "La Champagne" ou du groupe de Plan-Les-Ouates, "Le Feuillu". Fondé en 1956 par Jo Baeriswyl (un élève de Jaques-Dalcroze), "Le Feuillu" se distingue des groupes folkloriques traditionnels par des danses plus rythmiques et plus élaborées. D'où le port d'un costume différent — pantalons aux genoux pour les garçons, jupe et corsage au lieu d'une robe pour les filles — qui, tout en respectant les traditions, permet davantage les mouvements. Autre groupe de la Fédération: le club d'aînés "Artisans et costumes" qui, par ses activités dans les domaines de la broderie, du tissage et de la dentelle, s'est donné pour tâche de créer des costumes et leurs accessoires.
[p. 270]
La naissance de la Haute couture
Avec l'industrialisation et le déplacement des populations de la campagne vers les villes, on assiste aux débuts de la confection et de la fabrication standardisée du vêtement. Bien qu'elles soient encore rudimentaires et essentiellement destinées aux classes populaires, c'est d'elles que va naître la Haute couture. En 1857, l'Anglais Charles Frédéric Worth fonde, rue de la Paix, à Paris, une maison de couture qui affiche "Robes et manteaux confectionnés, soieries, hautes nouveautés". Pour la première fois, on y présente à intervalles réguliers des modèles inédits, conçus à l'avance, et qui seront exécutés aux mesures des clientes après qu'elles auront effectué leur choix. Jusqu'alors les élégantes élaboraient personnellement, avec leurs couturières, des modèles à leur seul usage. En faisant présenter ses modèles par des "sosies" (les futurs mannequins!), en instituant l'alternance des collections, Worth inaugure un nouveau système de production qui sépare le professionnel de la cliente (les femmes n'auront désormais plus de contrôle direct sur la fabrication de leurs vêtements), et fait ainsi entrer la mode dans l'âge moderne. La Haute couture, cette "industrie dont la raison d'être est de créer la nouveauté", comme la définira plus tard le couturier Paul Poiret, n'est réalisable que grâce à l'abolition des corporations. Tant que la politique réglementaire d'Ancien Régime empêchait le tailleur et la couturière de stocker et de vendre du tissu, il était impossible en effet de fabriquer des vêtements à l'avance.
Durant près de cent ans, les grands couturiers parisiens vont présenter à une presse spécialisée, venue du monde entier, et au cours de défilés au cérémonial aussi spectaculaire que figé, leurs mutations vestimentaires bisanuelles. Paul Poiret, l'un des premiers, révolutionne la silhouette féminine en supprimant le corset et en créant cette ligne fluide et libre, sans ornements excessifs ni falbalas, que Coco Chanel va encore épurer.
En 1947, Christian Dior célèbre la fin de la guerre en anticipant les désirs de dépense de la société de consommation qui s'annonce avec le "new look", ses nouvelles longueurs et ses débauches de tissu. En 1965, la Haute couture bouleverse une dernière fois la silhouette féminine avec Courrèges, qui impose un style ultra court — la fameuse minijupe apparue en Angleterre deux ans auparavant — et très architecturé. Il inaugure ainsi l'ascension irrésistible de la jeunesse dans l'univers de la mode. La jeune fille, quand ce n'est pas l'adolescente, devient alors le modèle de référence privilégié qu'elle est encore aujourd'hui.
[p. 271]
Le triomphe du prêt-à-porter
C'est à ce moment que naît la seconde révolution de l'histoire de la mode avec l'apparition du prêt-à-porter, formule tirée de l'expression américaine "ready to wear". Ce nouveau mode de production de vêtements, qui connaîtra très rapidement un grand essor, occupe la voie intermédiaire entre le prestige de la Haute couture et la qualité souvent médiocre de la confection. Après avoir rechigné un certain temps, les grands couturiers eux-mêmes décident que la mode doit descendre dans la rue et occupent ce nouveau créneau. Mais c'est surtout une nouvelle génération de créateurs, les "stylistes", non issus, pour la plupart d'entre eux, du sérail de la Haute couture, qui vont désormais donner le ton de la mode. En même temps que la Haute couture entre dans les musées et voit sa clientèle diminuer comme peau de chagrin (moins de deux mille clientes dans le monde entier à la fin des années 80), le prêt-à-porter multiplie ses griffes et ses marques auxquelles on s'identifie désormais. C'est elles qui vont déterminer en grande partie en effet le "style", terme fétiche qui, de la décoration à l'art, en passant par le vêtement, désigne l'idéal esthétique de cette fin de siècle. "La couture, proclame la styliste d'origine zurichoise Christa Furrer (dite Christa de Carouge, où elle possède une boutique), est un art de vivre. Je ne dis pas «aujourd'hui noir et long, demain violet et court». En aucun cas le vêtement ne doit devenir un gadget. Les femmes viennent chez moi non pour être à la mode, mais parce qu'elles se sentent bien dans mes vêtements qui, comme pour moi, correspondent à un style de vie".
[p. 272]
Le look plutôt que l'élégance
A la différence du règne de la Haute couture, la mode actuelle ne se définit plus par un ensemble de codes vestimentaires homogènes et intangibles. Sans doute trouve-t-on encore, au gré des collections, des éléments similaires de formes et de longueurs, mais d'impératifs qu'ils étaient, ils sont devenus facultatifs et c'est à chacun de les réinterpréter en fonction de son humeur et de ses envies. Comme le remarque le philosophe Gilles Lipovetsky, il n'y a plus une mode, mais des modes, et c'en est "fini de l'âge consensuel des apparences".
Le but suprême de cette "mode ouverte", n'est plus l'élégance, mais la présentation d'un "look", qui, dans l'idéal, peut se définir par une individualisation extrême et une sophistication hors normes de l'apparence. Il ne s'agit plus de se rapprocher de la perfection d'un modèle, mais de valoriser au contraire et jusqu'au bout, sa propre personnalité, en jouant à fond sur la singularité et la différence. Autremement dit, l'apparence vestimentaire vise beaucoup moins à manifester ou à se rapprocher d'une "excellence sociale" que de montrer que l'on "s'accepte soi-même" et que l'on en tire un maximum de profit. A la dictature de la condition a succédé la tyrannie douce-amère de l'auto-contemplation et de l'auto-surveillance narcissiques.
Une mode d'appartenance
Bien entendu, les signes apparents de la division sociale n'ont pas totalement disparu pour autant, mais ils sont devenus plus ténus et donc plus difficilement identifiables au premier coup d'oeil. Ils résident moins dans la forme ou les couleurs du vêtement lui-même que dans la façon de le porter, dans la qualité de la coupe et du tissu employé, cette fameuse patine que prennent certains vêtements de luxe et qui fait une grande partie de la "distinction" sociale d'aujourd'hui. De nouveaux clivages d'âge et de sexe contribuent, eux aussi, aux brouillages des hiérarchies. D'un côté, on constate des écarts vestimentaires moins tranchés: les pantalons — avec l'usage généralisé des jeans —, les pullovers et les blousons se portent de l'adolescence à l'âge mûr et sont devenus quasiment interchangeables entre hommes et femmes. De l'autre, on remarque la persistance ou l'apparition de groupes minoritaires qui, au travers de leur apparence vestimentaire, revendiquent leur attachement à une identité sociale spécifique: les zazous d'avant-guerre, les hippies des [p. 273] années 60 et les punks de la décennie 80, constituent des exemples célèbres de ces différents styles vestimentaires d'appartenance.
Le loden du banquier privé genevois
La jeunesse n'est d'ailleurs pas la seule concernée. Tous ceux qui, à Genève, s'occupent de mode et travaillent dans le domaine de l'habillement le constatent: les anciennes familles genevoises ont une manière particulière de se vêtir, caractérisée par une préférence marquée pour les coupes hors-mode, les tissus inusables et les couleurs passe-partout. Réponse parfaite à ce triple critère, le manteau de loden constitue l'"uniforme" favori du banquier privé genevois. A la différence de la grande bourgeoisie zurichoise qui aime paraître et dépense sans compter pour s'habiller, le "vieux" Genevois refuse toute ostentation vestimentaire et se montre particulièrement sensible au rapport qualité/prix. Cette attitude résulte sans doute moins d'un esprit d'avarice qui lui serait naturel que du fait qu'il tient à manifester ses liens à son groupe d'appartenance, en affichant une tenue spécifique. Dans une récente enquête sur l'empreinte de Calvin dans la Genève d'aujourd'hui, un banquier privé exprimait fort bien les modalités de cet attachement: "Calvin à Genève, je pense que c'est surtout un état d'esprit; on est plus ou moins aisé, plus ou moins riche, mais ça n'est pas une raison pour le montrer, au contraire. On reste en-deçà, on garde un esprit d'économie, même si, chiffres en mains, ces économies ne sont pas nécessaires. (...) On ne va pas au théâtre avec une rivière de diamants même si on peut se l'acheter, cela ne se fait pas. Et surtout, [on refuse] l'apparence, ce qu'on appelle vulgairement l'aspect nouveau riche. (...) Les signes extérieurs de la richesse sont exclus dans la mesure où ils deviennent trop évidents".
N'est-ce pas là le triomphe caché de la politique somptuaire genevoise? A défaut d'avoir eu des effets concrets sur l'ensemble de la population, elle aura permis à ses principaux protagonistes de préserver intacts, à travers les siècles et en dépit des vicissitudes de l'histoire, ce paraître et ce style de vie qu'ils conçoivent comme les meilleurs et plus sûrs garants de leur propre identité.
M. M.
haut
[p. 274]
Du luxe réprouvé au luxe utile et profitable
A Genève, comme partout, le luxe est objet de controverses passionnées. A travers les écrits des moralistes ou à l'écoute des sermons, le luxe apparaît, depuis toujours, comme le principal corrupteur des moeurs. La vie luxueuse entraîne la paresse, la perte du goût du travail, l'amollissement, le gaspillage et la ruine. Les dépenses de luxe provoquent "le refroidissement de la charité", "l'empêchement de fournir à la subvention des pauvres", l'égoïsme et aussi le libertinage; ainsi le "luxe vestimentaire nuit à la vertu et facilite la débauche".
Ce discours contre le luxe traverse les siècles, à Genève comme ailleurs. Les pasteurs tonnent en chaire contre "les vices" qu'engendrent la prospérité et le luxe: la mollessse, l'oisiveté, l'orgueil, les folles dépenses, la pompe mondaine (E. Gallatin, 1720). Très tôt, les habitudes de luxe ont été perçues comme une menace pour l'ordre social. Le goût des dépenses somptuaires conduit à vivre au-dessus de son "état", de sa "qualité". Déjà, au XVIe siècle, est régulièrement proclamé "que chacun ait à s'accoustrer honnestement et simplement, selon son estat et qualité", étant entendu que "accoustremens de soye, estouffes et fourreures precieuses sont défendus aux hommes et femmes mecaniques et artisans" (1575, 1581). Cent cinquante ans plus tard, la réprobation subsiste contre ceux qui veulent singer les gens d'une qualité supérieure à la leur. Ainsi, un ouvrier ou un artisan, s'il s'élève par sa dépense en habits ou en table, "au-dessus de sa condition", donne dans un luxe coupable (E. Gallatin). Il est condamnable celui qui se pare des signes d'un rang social qui n'est point le sien. Qui ne voit là une menace pour la société d'ordres?
Autre souci des moralistes et des conservateurs de la hiérarchie sociale: les dépenses de luxe conduisent à la ruine des patrimoines et des familles. Durant les XVIe et XVIIe siècles, la préoccupation des autorités a été de prévenir "l'apouvrissement de ceux qui n'ont esgard à leurs facultez". Il est urgent de régler, voire d'interdire, les dépenses superflues aux particuliers, car la ruine des particuliers est aussi la ruine de l'Etat. Aussi les lois somptuaires commandent-elles de proscrire certains biens, objets, décors, festins, meubles "comme estans de trop grandes dépenses". La préoccupation de maintenir les familles dans leur patrimoine relève aussi, d'une certaine manière, de la nécessité de sauvegarder l'ordre des rangs et conditions de la société traditionnelle, mais aussi de la crainte de voir des gens devenir — à la suite de dépenses de gaspillage — des "pauvres honteux" et tomber à la charge du public.
Contre la stratification sociale fixée par les ordonnances somptuaires, la prospérité économique et la mode vont se jouer des règles. La mode est déjà accusée, dans les années trente du XVIIe siècle, de pousser à de "nouvelles façons d'habits, contraires à la bienseance, honnesteté et modestie chrestienne" (1631). Elle s'impose à des couches de plus en plus larges de la population. En 1693, le pasteur Louis Tronchin fulmine devant le Conseil contre la mode qui pousse les artisans à imiter les riches, notamment dans leur goût de "changer souvent d'habits". Vers 1720, la Chambre [p. 275] chargée d'appliquer les ordonnances somptuaires est débordée par la "mode de Paris", ravageuse, contre laquelle on ne peut agir efficacement. Si bien qu'en 1725, on constate que le luxe est si grand "qu'on distingue mal la condition des gens". Rien n'arrête la mode, ni les ordonnances ni les protestations des moralistes et des conservateurs de l'ordre social. Dans la suite du XVIIIe siècle, les contraintes de la mode semblent atteindre la société tout entière, l'ignorer n'est plus que le lot des pauvres.
De leur côté, les "mercantilistes" locaux, les "bons artisans" obtiennent des dérogations pour les "fabriques de la ville". Les "dentelles faictes en ceste ville" seront autorisées (1668, 1698). Les exceptions vont se multiplier "en vue d'encourager les manufactures de la ville", comme des velours "en permettant de porter celui qui se fabriquera parmi nous".
Et en 1725, le pasteur Jacques Vial tient un grand discours, au nom de la Vénérable Compagnie, devant le Conseil, où il ne peut que constater l'échec des ordonnances somptuaires, incapables de freiner les débordements de la vie fastueuse des riches Genevois en infraction aux lois. "Il évoque ces magnifiques maisons... d'un prix si excessif qu'il se trouve peu de pères qui puissent en faire le partage d'un seul de leurs enfans quand ils viennent à mourir"; riches tapisseries, grands miroirs, meubles somptueux, étoffes éclatantes, carrosses souvent "à double dans plusieurs maisons", multitude de festins, abus de bons vins étrangers, beauté exquise du linge, de la vaisselle d'argent ou de porcelaine.
Et pourquoi pas? écrit Jean-François De Luc en 1746: "Les métaux les plus estimés, les pierres précieuses, les riches fourrures, la soie, la pourpre, le fin lin, les arts, l'industrie, toutes choses en un mot, ayant été faites pour le plaisir ou l'utilité de l'homme... il est évident qu'il peut en faire un usage légitime". Il y a donc un luxe licite qui répond au goût du plaisir, à l'aspiration au bonheur individuel et qui incite à de nouveaux comportements de consommation et d'acquisition d'objets, autrefois de luxe, maintenant de confort (Corinne Walker).
La relativité de la notion de luxe est rappelée par Jean-François Butini dans son Traité du luxe (1774), quand il évoque le roi Henri II lorsqu'il porta pour la première fois des bas de soie si communs aujourd'hui.
Entre temps, la perception de l'utilité du luxe a fait son chemin. La notion n'est pas neuve, mais elle s'impose devant les moralistes. Sans les industries de luxe, se demande-t-on, que deviendraient les arts, les manufactures et la multitude des ouvriers qui en vivent?
C'est Jean-F. Butini qui plaide les avantages d'un luxe modéré; il soutient les arts et les manufactures; par les emplois qu'il crée, il évite la misère: "il n'est pas d'autre ressource pour arracher la plus grande partie des citoyens aux horreurs de la mendicité".
Dans la dernière partie du XVIIIe siècle, on finit par se demander s'il y a un sens à vouloir réprimer le luxe par des lois. Quoique constamment renouvelées, les ordonnances somptuaires ne sont plus guère appliquées. On l'avoue en Conseil, en décembre 1784: les règlements sur la réforme sont devenus inexécutables sur de nombreux points. La réponse est venue de Brissot de Warville; "on [p. 276] a publié (à Genève) des lois somptuaires pour empêcher le luxe de faire des ravages; mais il fallait plutôt proscrire la cause du luxe, c'est-à-dire les richesses" (Le Philadelphien à Genève, 1783).
Plutôt que de tenter, vainement, de proscrire ou de réglementer les dépenses somptuaires, l'intérêt de l'Etat n'est-il pas d'en profiter? C'est l'avis de nombreux auteurs, anglais ou français, du XVIIIe siècle. Butini s'en fait l'écho: "Il serait plus avantageux de jeter des impôts sur des objets de luxe. Ceux-ci ne tombent que sur des gens riches", ils sont payés insensiblement par des acheteurs pour qui les fantaisies ne sont jamais chères. Mais aucun auteur n'est plus clair que Rilliet de Saussure. Dans une Lettre sur l'emprunt et l'impôt (1778), il écrit: "Créez des impôts sur toutes les consommations propres aux riches", car c'est chez les riches qu'est l'argent! Imposez les parfums, les liqueurs, le thé, le cacao, le sucre, le café de Moka, les fruits étrangers, les étoffes d'or et de soie, les galons, les montres de diamants et de perles, la porcelaine... sans crainte de nuire au commerce, car dans peu de jours, on s'accoutume à l'impôt et l'on ne s'accoutume point aux privations".
A.-M. P.
haut
[p. 277]